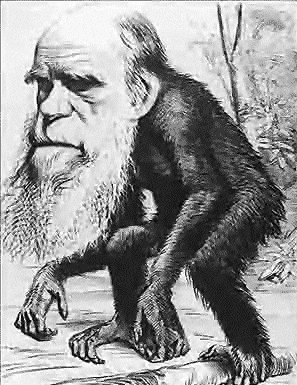Orthograve/Linguistique politique
Introduction
La linguistique est la science des langues et du langage.
Mais la langue est toujours la langue d’Ésope : la meilleure ou la pire des choses. Avec elle on peut « mentir comme on respire ». On peut même « se raconter des histoires ».
Par conséquent, pour nous aussi, ici, ce sera difficile d’être « objectif » en parlant d’elle ; qui tisse nos relations humaines, qui manifeste nos espoirs et nos désespoirs, nos succès et nos échecs ; qui nous permet d’agir, ou qui nous tente, au contraire, de transformer en illusion la dure réalité.
Il vaut mieux s’expliquer tout de suite à ce propos, avouer que ce discours de vulgarisation sera idéologique et partisan. Vous vous en apercevriez de toute façon très vite.
Je déclare donc, très tranquillement, que ce coup de phare « orienté » dans le brouillard est idéologique, sans aucune espèce de doute, mais qu’il atteindra son but s’il éclaire un instant son objet. Et je vais faire tout ce que je peux pour ça, en m’appuyant, pour être crédible, sur des citations de gens vraiment compétents.
Je m’adresse à mes amis, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas, engagés dans des combats associatifs, syndicaux ou politiques toujours aussi acharnés où « prendre la parole » (oralement ou par écrit) est à la fois une nécessité absolue et une tâche redoutée et épuisante.
Il est urgent, selon moi, qu’on les informe des réalités de la pratique du langage, c’est-à-dire, dans ce domaine aussi, de la complexité des problèmes et de la relativité des choses. Pas plus que moi, ils ne seront linguistes après avoir lu l’information qui va suivre. Mais la culture est à tout le monde. Que dire alors du langage, moyen d’accès obligé ?
Or, on peut comprendre la linguistique. La réputation qu’on lui a faite est un rideau de fumée, une manigance de plus pour éviter qu’on aborde le vif de la question.
Et quel ?
Élémentaire, chers camarades et amis, «élémentaire» : avoir ou non le droit de « l’ouvrir ». Car, sous prétexte de langage, on sait vous fermer la bouche à priori et de la façon la plus astucieuse qui soit : en vous conditionnant pour que vous vous la fermiez vous-mêmes. L’opération est assez remarquable. Elle est, historiquement, relativement récente. Si on y réfléchit bien, elle est proprement monstrueuse puisque le langage caractérise l’espèce humaine. Mais elle est peut-être en passe de réussir depuis que l’essentiel du temps libre (« le temps de cerveau disponible ») est consommé par la télé.
Mais c’est un scandale !
Quelles que soient les perspectives politiques, il importe donc de le dénoncer comme tel, afin que, sous votre pression, « on prenne des mesures » … celles du moins qui peuvent être prises.
Car il ne faut pas se faire trop d’illusions. C’est l’illusion, justement, qu’il faut d’abord traquer, au risque même que la « désillusion » soit un peu déprimante. Autant vous dire tout de suite qu’elle le sera. Mes propos et démonstrations seront critiques et acerbes, les conclusions par contre ne casseront pas les vitres.
Une première illusion serait de prendre au premier degré ce que je viens de déclarer. « On » veut vous faire taire. Qui « on » ? Cherchez, vous ne le trouverez pas. Ni caste, ni classe, ni parti, ni pouvoir politique … rien ; ou plutôt tout … et vous-mêmes, je l’ai dit.
… ainsi qu’en témoigne l’anecdote qui suit.
Depuis deux mois, notre ascenseur souffrait d’un mal semblait-il irrémédiable : le groom ou bien était trop lâche, et la porte claquait bruyamment, ou bien trop serré, et il ne repoussait pas assez la porte, empêchant le contact, et l’ascenseur restait bloqué au palier où on l’avait oublié.
Au point atteint de ce désordre essentiel, et après plusieurs révisions infructueuses, il semblait qu’il n’y avait d’autres recours qu’un échange standard de la cabine (fort coûteux) ou une discipline librement consentie entre les locataires ; en théorie facile, puisqu’elle consistait à s’assurer, avant de fermer la porte palière, que la fameuse « porte coulissante » était bien fermée. Hélas, la théorie est une chose et la pratique une autre chose. Fermer la porte coulissante, souvent on y pensait, et parfois on oubliait ; il y avait aussi les visiteurs, forcément pas dressés, qui, eux, oubliaient toujours. D’où, d’abord, une campagne d’affichettes, sans effet ; puis une guerre des communiqués dont voici un spécimen.

" Cette petite aventure urbaine pourrait passer pour simplement clochemerlesque si ce n’était pour beaucoup de locataires vivant soudain « au 6e sans ascenseur » … et au 2e, et au 4e, et au 8e aussi, en effet, « une vraie vie de misère » que de monter à pied.
Aussi, pour les habitants de cet(te) HLM, les conflits suscités par cette médiocre affaire mécanique entre des locataires (du 5e, et du 8e …), dans une ambiance de crise de société, commençaient à ne plus guère les faire sourire.
On voit, sur le document, où la malice allait se nicher, quelle forme elle prenait (comme si l’emmerdement par lui-même ne suffisait pas).
La forme orthographique et sémantique est tellement saugrenue qu’elle confine au délire. D’autant que la chasse aux fautes se fait – ça se voit tout à fait sur l’original- entre « mal orthographiés » : la correction sur « priées » est venue après celle sur « fermer », d’une main adverse. C’est à dire que le puriste agressé du 6e (on peut penser que c’est lui, n’est-ce pas, mon cher Watson ?) en corrigeant « fermer », et en dénonçant ainsi le caractère évidemment barbare de ses adversaires, s’est classé lui-même. C’est ce qu’on appelle ne pas avoir les moyens de sa politique !
Quant à la correction de vocabulaire, elle relève du même état d’esprit et de la même culture. On ne « descend » pas (bien sûr !) au 6e étage, on y « monte » pour ensuite « sortir de l’ascenseur » (faut-il être bas pour commettre des fautes pareilles !). Une aventure sémantique du même tonneau était du reste arrivée, quelque temps plus tôt, au syndic. Il y était allé lui aussi -devoir oblige- de son affichette. Celle-ci parlait « d’occupants » de l’ascenseur devant veiller, avant de quitter le véhicule, à la bonne fermeture de la porte coulissante. Eh bien, il convenait, parait-il, d’écrire « utilisateurs », sans doute parce qu’on ne peut agir sur la dite porte qu’en étant hors de l’ascenseur, on n’est donc plus alors en train de « l’occuper », et subséquemment, seul un nom de sens plus général, peut légitimement vous désigner, etc.
Et ainsi de suite pendant des semaines et des mois.
On doit, en toute logique, conclure de ces comportements linguistiques que quiconque s’exprimera en France à propos d’une porte d’ascenseur, sans une maîtrise suffisante de ce que l’opinion moyenne estime être du français respectable, ne sera pas respecté.
Nous vivons en fait une situation parfaitement imbécile, mais qui, chacun le sait, est d’une grande banalité ; Elle n’est donc pas aussi « innocente » qu’elle en a l’air.
C’est ce que je veux démontrer dans ce « livre ». Ce livre est indispensable. Il procède à l’inverse de la première moitié du site tout à fait pragmatique, dont « l’étayage linguistique » est en libre service. Le livre au contraire est un long discours finalisé par ses conclusions. La sociologie est un sport de combat disait Bourdieu. La linguistique aussi. Du moins elle peut l'être.
Je tenterai donc d’abord de vous « déstabiliser ». L’épreuve risque d’être parfois désagréable. Cependant, sous des apparences de patchwork, l’ouvrage que je vous soumets forme un tout organisé (selon son objectif). En particulier, les deux annexes lecture et lexique qui accompagnent chaque chapitre sont non seulement des contrepoints qui laissent plus libre le discours polémique, mais constituent aussi les contreforts qui l’étayent, plus solides, plus argumentés. Mes textes de référence confirment linguistiquement mes propos de vulgarisateur amateur (tout en ouvrant des horizons scientifiques vertigineux), ou bien illustrent mes pires méchancetés.
Mes questions politiques sur l’usage du langage au XXIe siècle sont alors « incontournables ».
À propos de nécessité scientifique, voici une première Lecture
« Le déplacement d’un millimètre d’un objet sur une table n’est pas encore une opération scientifique. L’opération scientifique commence à la décimale suivante. Pour déplacer un objet d’un dixième de millimètre, il faut un appareil, donc un corps de métiers. Si l’on accède enfin aux décimales suivantes, si l’on prétend par exemple trouver la largeur d’une frange d’interférence et déterminer, par les mesures connexes, la longueur d’onde d’une radiation, alors il faut non seulement des appareils et des corps de métiers, mais encore une théorie et par conséquent une Académie des Sciences. L’instrument de mesure finit toujours par être une théorie et il faut comprendre que le microscope est un prolongement de l’esprit plutôt que de l’œil. »
— Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, 1938, Chapitre XII, § 1, Vrin, 1967, p. 242.
Écolo
[modifier | modifier le wikicode]
« Toute langue change à tout instant »
– Martinet (célèbre linguiste)
« Une forêt constitue une communauté organisée, vivante : un « écosystème ». chaque être vivant contribue à son équilibre. »
Voici, pour faire le premier pas, un dessin de ma petite-fille, et une citation tirée de "Pif Gadget" en un temps déjà lointain où l’écologie commençait à peine à faire son chemin dans les esprits. Un "système" est une notion scientifique moderne désormais bien vulgarisée … grâce notamment à l’écologie.
Quel rapport avec notre sujet ?
Le rapport est direct et immédiat : la langue est un système. On dit aussi une structure, mot clef de la linguistique. C’est le premier concept et le plus essentiel.
Plus précisément, la langue est un système de systèmes comme l’est aussi le petit bois.
Expliquons-nous donc sur ce petit bois, faisons les comparaisons immédiates et, si votre peur des mots a fui, la langue suivra "naturellement" de chapitre en chapitre.
Dans le petit bois, par exemple, on trouve des fourmilières qui sont elles-mêmes des systèmes. On sait qu’une fourmi isolée ne survit pas, elle n’existe que par la fourmilière, quoique la fourmilière soit faite uniquement de fourmis qui s’affairent, de façon apparemment autonome, ici et là avec diligence et opiniâtreté. Les fourmis ne sont que des éléments du système, entièrement dépendantes de lui ; dont elles assurent le fonctionnement cependant (y a-t-il des philosophes fourmis qui méditent sur le thème : "condition fourmilienne" et liberté ?)
Passons à l’étude du petit bois lui-même. La fourmilière est intégrée à des ensembles bien plus vastes qu’elle. La fourmilière ne peut fonctionner que quand certaines conditions sont réunies, par exemple dans un petit bois de tel ou tel type et sous tel ou tel climat ; et le petit bois, quant à lui, ne peut fonctionner sans ses fourmilières qui le nettoient (ou sans tel ou tel autre système vivant jouant un rôle équivalent pour son équilibre).
Cette façon écologique de voir les choses donne évidemment très vite le vertige : tout se tient, tout réagit sur tout. Quand quelque chose change, ou disparaît, ou apparaît à un bout de la chaîne, tout le reste est obligé, à plus ou moins long terme, d’en tenir compte … Ce qui n’achève pas l’aventure, car, quand tout s’est enfin ajusté à l’élément perturbateur (à vrai dire, non pas "quand", mais en même temps que l’ajustement s’opère) l’objet nouveau subit en retour les conséquences de l’ajustement, et change de nouveau ; et ça repart pour un tour.
À vouloir saisir d’un seul coup, dans son esprit, le mouvement de chaque chose, on se dit que, c’est sûr, on va se perdre. Mais on sait bien pourtant que les inter-relations d’un système sont intelligibles, qu’on peut y trouver des lois, lois de la structure. Et c’est heureux, car si les hommes ne pouvaient pas penser les lois complexes, si leur cerveau, par nature, était incapable de le faire, ils n’auraient vraiment pas grands pouvoirs sur le monde.
Ceux qui ont essayé de penser la complexité dans leur vie de citoyen, par exemple en essayant d’être marxistes, adeptes de la dialectique, même s’ils sont bien conscients que cette façon d’appréhender le monde n’est pas facile et en plus, de tragique expérience, ne garantit pas le succès, ne doivent être, cependant, ni surpris, ni démoralisés par la linguistique ; ils doivent en outre être bien convaincus que, s’ils ne s’en occupent pas, elle s’occupera d’eux. Si nous nous mettons à parler du langage, c’est pour agir sur sa réalité en tant que donnée essentielle de notre vie sociale. Nous soutenons l’idée qu’être maître du langage, en notre temps plus que jamais, ne confère pas des pouvoirs anodins. Par conséquent, il faut oser s’y confronter.
Il y a une première conséquence immédiate à notre affirmation écologique :
Une langue, c’est autre chose qu’un dictionnaire avec un catalogue de règles. On la présente ainsi à l’école pour des raisons pratiques et semble-t-il de bon sens, et on installe ainsi des préjugés tenaces qui se perpétuent de génération en génération. C’est fort dommageable pour l’intelligence (et le plaisir de vivre) parce que si c’est beaucoup plus compliqué qu’un catalogue, une langue, c’est aussi beaucoup plus intéressant.
Les langues "vivent", écologiquement. Donc elles changent ? Elles « se modifient sans jamais, pour cela, cesser de fonctionner » (Martinet - Éléments de linguistique générale - 2.2 p.29)
Mais comment cela peut-il être ?
Une fourmi, si élémentaire que soit cet animal, est un être vivant ; et un mot n’est qu’une chose. Les mots, à l’évidence, en tant que tels ne vivent pas, ce serait assez surnaturel. Ce n’est que par métaphore que l’on peut dire que les mots vivent. La «vie des mots» ne peut signifier qu’ils sont vivants. (Il faut toujours se méfier de tels glissements de sens plus ou moins innocents qui, de proche en proche, peuvent fausser complètement un jugement).
Les mots ne vivent pas, ce sont les hommes qui vivent. Et, pour vivre ensemble, ils communiquent, ils parlent, sans arrêt. C’est ce qui fait que les mots fonctionnent, sans arrêt. Nous ne parlerons d’abord que des mots, mais tous les autres rouages du système de la langue sont concernés.
Dans une langue, il y a d’autres éléments que les mots : il y a des «sons» et, quand on écrit les mots, des lettres ; il y a aussi des «règles de grammaire» pour agencer et "accorder" les mots entre eux, pour les faire changer d’aspect, de forme, de "morphologie" selon le genre et le nombre, selon la personne et le temps. (Nous examinerons tout cela dans ce livre.)
C’est à cause de l’activité langagière des hommes que les langues évoluent ; si l’on veut qu’elles "vivent" et quand on les laisse vivre.
Prenons un exemple, dans le dictionnaire (Quillet. Flammarion , édition 1956) :
« métropole, n.f. 1- État considéré relativement à ses colonies. 2- Ville qui possède un siège archiépiscopal. 3 - Capitale d’un Etat.
adj. Église métropole, église métropolitaine.
métropolitain (e) adj. 1 - qui appartient à la métropole. gouvernement métropolitain. 2 - archiépiscopal. Église métropolitaine. 3 - qui appartient à la capitale d’un État. Chemin de fer métropolitain N.M. l - Archevêque par rapport à ses suffrageants, les évêques 4 - chemin de fer, partiellement ou totalement souterrain, à l’intérieur d’une grande ville.
métropolite, n.m. Dignitaire de l’église orthodoxe, intermédiaire entre le patriarche et les évêques.
métro, n.m. abrév. fam. pour chemin de fer métropolitain »
Vous notez tout de suite que "métro", en 1956 encore, n’existe qu’à la limite du français. C’est une abréviation et « familière » de surcroît ; autant dire le sort qu’on lui réservait à l’école.
Dans l’édition de 1936 du petit dictionnaire français Larousse, on a même circonscrit le mal, on écrit: "À Paris, abréviation de métropolitain".
Plus tard, ça s’arrange semble-t-il. Dans le petit Larousse de l968, métro est indiqué seulement "abréviation de métropolitain". ( Mais "télé" est toujours « abréviation familière »). Nous arrivons ainsi au micro Robert de 1980. « Métro » est reconnu pour ce qu’il est et « métropolitain » est déclaré "vieux". Mais « télé » ? Nous retrouvons "abréviation familière".
Évidemment, le dictionnaire fait ce qu’il peut, et on ne peut lui tenir rigueur de prendre un peu de recul, de ne pas courir après l’évènement linguistique qui, à notre époque où tout évolue si vite, galopera encore plus vite. Mais on sait bien aussi que "familier" égale "pas vraiment français" dans l’opinion populaire qui se respecte, car c’est justement ça qu’on corrige à l’ école, pêle-mêle avec le « grossier » (On connait l’étrange culpabilité des adultes cherchant à se justifier quand ils dérapent et disent « merde » : c’est français, après tout, « c’est dans le dictionnaire ». La culpabilité sur « c’est grossier » est déplacée sur « français-pas français »).
Au lieu de pleurer sur notre laisser-aller, regardons plutôt ce qui s’est passé dans l’évolution et le pourquoi de l’invention d’un mot. Il faut distinguer le plan de la langue et le plan des évènements extérieurs.
| réalité (changements extérieurs à la langue) | langue (changements intérieurs à la langue) |
|---|---|
| Le développement de la civilisation crée des cités et des États de plus en plus complexes. Les villes se hiérarchisent (l’Église devient une force politique) Métropole devient un mot essentiel du discours de l’État (et de ses serviteurs) |
Métropole, PR : « bas latin métropolis, grec mêtêr « mère » et polis « ville » 1 relig. Ville pourvue d’un archevêché où réside un [archevêque] métropolitain » |
| Le « chemin de fer métropolitain » souterrain de Paris connaît un succès foudroyant | Les ingénieurs et énarques baptisent un nouveau moyen de transport. |
| Des millions de personnes l’utilisent chaque année (ce ne sont pas des énarques) | Tous ces gens ne peuvent pas l’appeler (au risque même d’apparaître incultes) chaque jour par son « vrai nom » |
| Un mot nouveau s’impose contre vents, marées et certificat d’étude : le mot « métro » |
Quand une réalité nouvelle apparaît, il faut lui fournir une désignation. Pour que cette désignation s’impose dans la pratique langagière, il faut qu’elle soit commode. Ou bien elle l’est, ou bien elle doit le devenir; ou bien elle doit céder la place à une autre qui présente cet avantage.
Dans le cas de métro, le processus de transformation est particulièrement limpide. Les ingénieurs ont désigné l’objet : « che min de fer mé tro po li tain »
Sans blague ! Pourquoi pas : « véhicule auto-tracté et souterrain destiné au transport commode et économique des classes laborieuses dans les grandes villes industrielles ».
Répétons tous ensemble: « Dimanche, pour aller à la Samaritaine avec maman, j’ ai pris, le véhicule … »
Bon, la cause est entendue : on règlera l’affaire nous-mêmes.
Donc, il y aura
" l’métro",
" l’train" (d’banlieue) (alias èreuher ; alias reureu),
" l’bus"
et l’tram.
C’est clair et bien contrasté, on ne confondra pas.
À l’inverse du raccourcissement commode, la possibilité existe aussi de pouvoir bien faire ressortir son propos avec de « grands mots », avec le « mot le plus long », fut-il … « abracadabrantesque ». Tous les coup sont permis (quand ils sont autorisés).
Voilà comment elle "vit", la langue !
Mais si nos considérations sur "métro" ont pu vous sembler un peu caricaturales et désuètes, nous complétons aussitôt par un exemple plus récent qui vous convaincra vraiment que l’attitude de soumission à l’égard de ce qui est permis ou interdit dans la langue, de par le dictionnaire, est l’attitude commune - c’est certainement la vôtre - et que cette attitude mérite au moins d’être considérée avec quelque recul. Non que, derrière le tabou, il n’y ait aucune raison valable pour justifier qu’on s’efforce sans fin de "surveiller" le français (derrière tous les tabous, on trouve des raisons), mais parce que la politique du tabou constitue un obstacle scandaleux à l’appropriation réelle de la langue par chacun d’entre nous et qu’elle empêche d’aborder lucidement les vraies questions du "bon usage" ou de « la sauvegarde du français dans le monde ». (Questions qui seront traitées plus loin. Rappel : ce livre n’est pas un pamphlet anarchiste.)
Voici ce nouvel exemple (nous précisons encore qu’on pourrait en trouver cent autres, tant les préjugés qu’on nous a inculqués agissent fortement ; et nous répétons que le but poursuivi dans notre manière d’exposer est de vous inciter à les traquer vous-mêmes.)
Le célèbre chef jardinier de Versailles qui tient rubrique à la radio, explique à un auditeur qu’il faut « tuteurer » certaines plantes. Le journaliste qui l’accompagne sur les ondes s’étonne de ce mot. « Ce mot existe », affirme le jardinier. Peut-être craint-il une réaction des puristes toujours à l’affut. Il veut dire sans doute simplement : il est dans le dictionnaire. En effet, il y est, et depuis assez longtemps. Il n’y était pas dans le « Nouveau dictionnaire illustré Larousse » de 1911, non plus dans celui de 1918 (nous l’affirmons : nous avons tout ça chez nous). Mais il y serait, parait-il, dans le supplément du nouveau Larousse illustré de 1907 en 7 volumes, selon le « Trésor de la langue française informatisé » (peu de chance de pouvoir vérifier : 7 volumes, c’est un peu gros pour des achats culturels modestes sur les quais!) Il est visible en tout cas dans le « Petit dictionnaire français Larousse de 1936 » ; tout petit pourtant. Et puis, ça a suivi. Donc, tout va bien : il est dans les dictionnaires. Mais c’est justement cette clause de garantie qui amuse (ou inquiète) dans la réaction du jardinier. Si le mot n’avait pas été enregistré dans un dictionnaire, aurait-il, lui, le droit de « tuteurer » et d’en parler ainsi avec ses compagnons de labeur ? Ce n’est pas « tuteurer » qui pose problème, c’est de l’affirmer. On ne peut pas mettre tous les mots dans un dictionnaire ; les mots peuvent « exister » hors des dictionnaires.
Nous voyons déjà mieux comment il faut aborder les problèmes du langage, non à partir du dictionnaire, mais à partir de la vie. À partir de la question honnête et modeste qu’il faut à chaque fois se poser : à quoi servent aux gens les mots et les expressions qu’ils emploient ici et maintenant.
Quand on décide de changer ainsi de point de vue, toutes les données linguistiques restent présentes, aucune ne disparait, aucune n’est niée, l’anarchie ne triomphe pas, mais tout se trouve cependant métamorphosé. Car ce qui devient premier, essentiel, ce n’est plus la prétendue langue française achevée, parfaite, immuable et sacrée qu’il faut adorer sans réfléchir, mais les décisions que les hommes doivent prendre, au fil des jours, de façon nécessaire, pour traiter pertinemment, c’est à dire efficacement, leurs affaires. À un moment donné, dans une société donnée (et même dans une fraction donnée d’une société : ici les jardiniers, après les usagers des transports en commun) les mots utilisés doivent pouvoir être au service de la vie qu’on mène. Et non l’inverse : la vie au service des mots (en réalité, nous le verrons, au service d’autres réalités également sociales, plus "dominantes"). La signification d’un mot est ainsi interdépendante de celle des autres mots avec lesquels il cohabite dans cette structure vivante dont nous avons parlé, structure de l’usage elle-même déterminée « en dernière instance » par l’usage pratique des "choses de la vie ».
Ainsi pour : réfrigérateur, frigidaire, frigo; bicyclette, vélocipède, vélo ; automobile, voiture, auto, moto … aéroplane, aréoplane ?… et zut ! avion ; etc.
Le travail des hommes sur le langage se produit constamment, obstinément, en tout lieu où l’on vit et où l’on parle pour vivre. Et ceci explique que les langues changent tout le temps ; malheureusement aussi (mais d’un autre point de vue) en divergeant selon les lieux et les catégories sociales. Ce qui ne laisse pas de poser d’autres problèmes redoutables qu’il faut aussi prendre en compte.
D’autant que le processus d’évolution peut être également complètement interne à la langue. Dans ce deuxième cas d’évolution, l’idée ou la chose désignées ne changent pas, mais le mot qui les désigne se fatigue de servir trop souvent et la nécessité d’en changer s’impose en conséquence.
Exemple: "Sot" a beaucoup servi, il est devenu vieux et faible. Il faut chercher ailleurs pour être un peu injurieux. Heureusement, la psychologie médicale a des appellations savoureuses pour les catégories d’humains qu’elle classe par le moyen de ses tests. C’est un réservoir tout trouvé. Nous aurons donc, dans la pratique langagière du terme méprisant : « imbécile », « idiot » (catégories de niveau intellectuel en effet assez mal situées dans les tables de QI). Mais ces mots eux-mêmes s’émoussent, si féroces en eux-mêmes soient-ils. Un restait libre, pas terrifiant pourtant : « débile », il est soudain devenu très à la mode. Mais sa cote est elle aussi en train de baisser. Que trouver d’autre? On a fait diverses tentatives (des recherches linguistiques). Nous avons eu "gogol" (de "mongol", alias "mongolien"). Atroce ! Trop c’est trop, il incline à la pitié, donc à l’affection; il se transforme en son contraire : « je t’écris, ma gogole, pour te dire que je t’aime beaucoup ». On a essayé "handicapé". Ça, comme dérision, c’est pas mal ! "La loi cadre sur les handicapés », "L’année des handicapés"… Et tiens! attrape l’handicapé ! On a, semble-t-il, déniché un petit dernier : « autiste ». À priori ambigu puisque la science psychiatrique en diagnostique plusieurs sortes ; à vue de nez : l’autiste crétin et l’autiste génial. Toutefois, en situation d’insulte, on ne peut pas se tromper. À suivre …
Il y a des exemples beaucoup plus banals. Les anciens se souviennent sans doute de Jean Nohain, le célèbre présentateur radio-télé des années cinquante et son fameux : « C’est absolument merveilleux »
Après ça, qu’est-ce qu’on pouvait mieux dire sur la qualité du spectacle ? Quand tous les gratteurs de guitare seront passés, que restera-t-il pour Django ?
Il faudra évidemment, "merveilleux" ne valant plus rien : stupéfiant, fracassant, flashant, super planant et hyper-sidérant … ou tout ce que vous voudrez dans le genre maxi bonus pour s’éclater.
Ainsi les langues bougent aussi de l’intérieur, « quand elles servent et parce qu’elles servent » (Le Français sans fard – autre livre de Martinet p190)
C’est très rigolo.
Et qui prétendra les arrêter ?
Nous vous conseillons de lire :
- « Éléments de linguistique générale », petit livre (édité en collection de poche) que nous vous conseillons vivement d’acheter. Il est très clair ; mais aussi très «dense» comme on dit, c’est à dire qu’une première lecture vous apprendra beaucoup mais ne vous dira pas tout ce qu’il contient. D’autant plus qu’il prend parti dans le débat savant sur les questions abordées. Et toutes les questions sont abordées : c’est un manuel fondamental.
Nous vous conseillons aussi le livre de Henriette Walter « Le français dans tous les sens ». Henriette Walter est une linguiste très rigoureuse elle-aussi, dans la lignée de Martinet avec qui elle a travaillé, lequel d’ailleurs a préfacé ce livre. Les notions savantes servent à éclairer l’histoire du français jusqu’au temps présent. C’est un récit vivant et passionnant. Mais aussi un cours magistral qui rend joyeux.
Lexique
Structure, c’est :
- un système dont les éléments constitutifs ne tiennent que par leurs relations entre eux
- un système qui fonctionne en se réglant lui-même
- Diachronie/synchronie
- Si on considère l’évolution historique du système, l’étude est dite diachronique. Si on considère son fonctionnement à un moment donné, elle est synchronique.
ex : métro - synchroniquement : moyen de transport urbain électrique souterrain.
Il n’y a plus souvenir de l’étymologie (diachronie).
- Créativité
- « La créativité est l’aptitude du sujet parlant à produire spontanément et à comprendre un nombre infini de phrases qu’il n’a jamais prononcées ou entendues auparavant … »[……]
« On peut distinguer deux types de créativité, la première consistant dans des variations individuelles dont l’accumulation peut modifier le système des règles (créativité qui change les règles) , la seconde consistant à produire des phrases nouvelles au moyen des règles de la grammaire (créativité gouvernée par les règles); la première dépend de la PERFORMANCE (ou parole) la seconde de la COMPETENCE (ou langue) » — DLL
DLL = Dictionnaire Larousse de Linguistique (il sera désormais toujours désigné par ses initiales. Nous n’allons pas nous faire à nous-mêmes le coup du « chemin de fer métropolitain ».)
(performance, parole, compétence, langue, voir ch. VI (lexique))
Créativité (suite)
Les simples gens, les braves gens, si respectueux du « bon français » seraient sans doute stupéfaits d’observer l’intérêt que les gens instruits (très instruits) portent à leurs fantaisies expressives.
Puisque les langues évoluent, c’est forcément parce que des actes de parole les bousculent. Les savants, les linguistes (et même les académiciens) observent. Très curieux, parfois amusés, parfois même émerveillés. Leur curiosité à l’égard de la créativité populaire fait bien un peu penser à celle du zoologiste étudiant l’évolution des espèces. En tout cas, eux, ils se régalent.
Ainsi, le plaisir de l’innovation n’est même pas pour celui qui innove (exceptés les « mauvais sujets » un peu psychopathes, à l’abri des sentiments de culpabilité).
Le texte illustratif ci-après est de Bertrand Poirot-Delpech, académicien (le plus parfait honnête homme au demeurant, et qui savait toujours, et à quel niveau ! dans les conflits majeurs, prendre position humaniste. Mais ce n’est pas la question.)
Dans ce texte, il fait également le constat de la disparition des lieux traditionnels d’expression. Lieux mal famés ; n’empêche, le langage y vivait.
La question principale est qu’il n’y a pas de lieu de remplacement, à part les halls d’escalier ; la télé aspirant tout dans son gouffre. La concentration urbaine débouche sur des déserts de solitudes.
Opposition ( + code, canal, bruit )
Pour fonctionner, les éléments du langage doivent s’opposer. Nous ne cesserons de revenir sur cette notion essentielle qui prend des aspects divers.
Nous nous contenterons ici de l’illustrer sur un exemple dont la simplicité est dictée par la nature même. Il s’agit des signaux vocaux que les membres d’une cordée d’alpinistes échangent. Il s’agit de signaux essentiels, de nombre très réduit et que vous constaterez être très contrastés sur le plan sonore. En effet, les deux membres de la cordée, chacun à l’extrémité de leurs 30 ou 40 mètres de corde, sont alternativement émetteur et récepteur de signaux dont la signification est pour eux vitale, c’est à dire qu’il doit être absolument exclu qu’ils puissent se confondre, alors que la configuration de la paroi et les mugissements du vent peuvent parasiter la transmission d’un message uniquement vocal, car les deux alpinistes souvent ne se voient pas (En termes d’information, on dira qu’il y a souvent du « bruit » sur le « canal »)
Il va de soi que le code est convenu d’avance. Il est largement commun à tous les alpinistes (ce n’est pas au refuge qu’on convient d’un code pour la course du lendemain), mais il a été élaboré tout à fait empiriquement et inconsciemment. Il n’empêche que les termes choisis se révèlent être très contrastés sur le plan sonore et de fait très efficaces.
| Bruit dominant | ||
| Laisse filer la corde, je grimpe sans problème se dit : | mou | [ou] |
| Je suis en difficulté, j’ai besoin de me reposer, je demande à celui qui m’assure de me bloquer | bloque | [ɔ] |
| Je suis en grande difficulté, je vais tomber, celui qui m’assure doit stopper ma chute | sec | [è] renforcé par le [c] |
| Le premier de cordée est arrivé à un endroit propice où il s’installe et se fixe pour assurer son second. Fin prêt (le second pourra toujours tirer par erreur) il crie : |
relai |
[è] calme |
| Le second annonce qu’il va commencer à grimper (et ça devra se traduire aussitôt pour lui par la tension de la corde) : | départ |
Lectures
- Benveniste
« Chacune des unités d’un système se définit ainsi par l’ensemble des relations qu’elle soutient avec les autres unités, et par les oppositions où elle entre; c’est une entité relative et oppositive, disait Saussure. On abandonne donc l’idée que les données de la langue valent par elles-mêmes et sont des « faits » objectifs, des grandeurs absolues, susceptibles d’être considérées isolément. En réalité les entités linguistiques ne se laissent déterminer qu’à l’intérieur du système qui les organise et les domine, et les unes par rapport aux autres. Elles ne valent qu’en tant qu’éléments d’une structure. C’est tout d’abord le système qu’il faut dégager et décrire. On élabore ainsi une théorie de la langue comme système de signes et comme agencement d’unités hiérarchisées.
(……)
Quand les linguistes ont commencé, à l’instar de F. de Saussure, à envisager la langue en elle-même et pour elle-même, ils ont reconnu ce principe qui allait devenir le principe fondamental de la linguistique moderne, que la langue forme un système. Ceci vaut pour toute langue, quelle que soit la culture où elle est en usage, à quelque état historique que nous la prenions. De la base au sommet, depuis les sons jusqu’aux formes d’expression les plus complexes, la langue est un arrangement systématique de parties. Elle se compose d’éléments formels articulés en combinaisons variables, d’après certains principes de structures. Voilà le second terme clé de la linguistique, la structure. On entend d’abord par là la structure du système linguistique, dévoilée progressivement à partir de cette observation qu’une langue ne comporte jamais qu’un nombre réduit d’éléments de base, mais que ces éléments, peu nombreux en eux-mêmes, se prêtent à un grand nombre de combinaisons. On ne les atteint même qu’au sein de ces combinaisons. »
— Benveniste, problèmes de linguistique générale, — Gallimard — p. 21
- Bertand Poirot-Delpech
« Quelqu’un qui se passionne pour la vie des mots ne peut pas être tout à fait désolé ni ennuyeux.
Savoir que la langue ne rime à rien console de toutes les désillusions. Orlando de Rudder, comme Claude Buneton, est un observateur du langage. L’an dernier, on a remarqué son français qui se cause.
Le bistrot était un endroit de choix pour voir prospérer cette sorte de langue. Céline, Marcel Aymé, Prévert, s’y tenaient à l’affût. Les propos de zinc à l’heure du crème étaient une mine de sagesse populaire et d’invention langagière. Les « pubs » à l’anglaise et les commentaires inévitables sur la télévision de la veille ont tari cette source de poésie.
Tout crus, les coqs, fait revivre le temps des bistrots de banlieue où les vies et les voix se croisaient sans livrer leur secret. L’un des clients joue du violon, le second fabrique des radios, d’autres dansent, se souviennent de pays lointains. Tous ont rendez-vous chez Emile, mais d’abord dans la conscience du narrateur […] »
— Extrait du « feuilleton de Bertand Poirot-Delpech », , de l’Académie française, chronique littéraire dans Le Monde du 25 septembre 1987
Latin ou anglais ?
[modifier | modifier le wikicode]
Le rêve d’une langue universelle et éternelle
La langue est un système "vivant" … Objection : et les langues mortes ?
Il existe en effet des langues vivantes et des langues dites mortes. Nous touchons soudain aux limites annoncées de notre comparaison écologique.
D’un point de vue écologique, il n’y a aucun rapport entre un petit bois vivant et la vitrine d’un muséum avec arbres en carton et animaux empaillés. La vitrine n’est qu’un mirage, une représentation du bois et non le bois lui-même (du point de vue écologique). Mais il reste quelque chose de commun entre une langue vivante et une langue morte et ce quelque chose est essentiel. C’est le pouvoir qu’elles ont l’une et l’autre de communiquer des idées et des informations entre les hommes (quand, bien sûr, les hommes les connaissent).
Une langue morte n’est pas vraiment morte, du point de vue de la communication. Il suffit de "l’activer" (comme une station spatiale qui tourne en orbite et qu’un équipage va remettre en service) pour qu’elle fasse son office.
C’est ce qui est arrivé à l’hébreu liturgique. Il a été adopté comme langue commune en Israël (pour dépasser la diversité linguistique des arrivants)… et il est redevenu vivant.
Le latin, langue morte, fonctionne parfaitement, pour autant qu’on puisse en juger à l’usage qu’en font les prélats de l’église catholique. Ils peuvent communiquer entre eux en latin à propos d’affaires les concernant et concernant la marche du monde. Nul ne contestera que ces affaires soient d’une extrême complexité. Les prélats sont même renommés pour la subtilité de leurs démarches et de leurs propos.
Le latin est donc un système de communication efficace.
Et on vérifie, du même coup, que si la forêt, en quelque sorte, vit d’elle-même et pour elle-même, la langue n’est qu’un objet créé par les hommes pour des besoins de leur vie sociale. On dit que c’est une institution humaine. On peut dire aussi un outil.
Là, dix problèmes au moins se présentent à la réflexion dont tout le monde a entendu parler et qui peuvent nous entrainer sur dix chemins de traverse. Il faut freiner des quatre fers si on veut aller au bout en passant par l’essentiel, sans tout emmêler, sans tricher non plus ; mais sans faire pire encore que tricher, selon nous : renforcer la conviction que c’est un sujet impossible
Que de problèmes à propos de ces langues créées (?) par les hommes pour les nécessités de la communication et pour l’expression de leurs pensées (?). Nos points d’interrogation soulèvent deux de ces problèmes.
1 - Les langues sont bien pourtant aussi des phénomènes « naturels » puisqu’elles échappent largement à la volonté et à l’intervention consciente. Ainsi, quand on a voulu créer des langues de toutes pièces, artificielles (ex. l’espéranto), ça n’a jamais vraiment marché. On peut alléguer le poids des orgueils nationaux, mais vous pouvez maintenant supposer une autre raison pour laquelle cette invention généreuse était difficile à faire triompher : même s’il n’y avait eu aucun obstacle politique, quel génie, ignorant de surcroit la linguistique moderne, aurait pu créer de toutes pièces un système "écologique" à usage universel ?
D’autre part, on peut supposer qu’avant l’invention des livres de grammaire et des écoles, les êtres humains ne parlaient pas nécessairement comme des bêtes. On devine bien un peu, d’après les exemples fournis précédemment, comment c’est possible ; mais une chose quand même est de glisser un mot nouveau dans un système, une autre est d’imaginer comment se crée l’ensemble du système. La complexité d’une langue "naturelle" reste un sujet d’émerveillement.
2 - Deuxième problème soulevé :
Le langage et l’intelligence sont en effet à ce point inextricablement mêlés et même confondus que de nombreux savants psychologues doutent qu’il puisse exister une pensée sans langage.
Or il se trouve que le latin, toujours lui, mort et pourtant subtil, est crédité par certains d’une capacité toute particulière à développer l’intelligence des enfants. Une super langue en quelque sorte. Elle est morte, et la voilà meilleure que toutes pour la pensée. Du moins celle des plus "doués".
On tourne déjà en rond au cœur brulant du débat idéologique sur la langue et ses fonctions.
Cependant, et nous en sommes là pour l’instant, le latin (langue morte) et le français (langue vivante) sont de bons moyens de communication ; pour le latin, on vient de le prouver par la simple observation de ceux qui l’emploient. Il faut sortir de ce qui tend à prendre l’aspect d’une contradiction insurmontable .
Pour cela nous cesserons évidemment de parler des rapports particuliers qu’une langue entretient avec tel ou tel individu communiquant avec un autre de ses semblables et en prenant tout le temps nécessaire pour ça. Nous prendrons en compte l’ensemble des individus vivants, organisés en société.
La langue morte, par définition, ne bouge pas, ne se transforme pas. Bien entendu, il a fallu des mots nouveaux pour « aéroplane » ou « bombe atomique », mais ces mots se sont ajoutés sans rien changer aux autres. Les langues vivantes, elles, n’arrêtent pas de bouger, et c’est justement ce qui épouvante les puristes toujours anxieux que ça n’annonce la décadence et la barbarie.
Il faut répondre à leur légitime inquiétude. Pour cela il faut cerner l’essentiel, sans rejeter forcément ce qu’ils disent. Ce qu’ils disent, disposé différemment, pourra prendre un tout autre sens.
Du point de vue de l’humanité parlante, qu’est-ce qui est essentiel dans une langue? Nous disons bien "une" langue, n’importe quelle langue.
C’est la communication, la transmission d’informations. Exact. Mais du nouveau point de vue où nous nous sommes placés, du point de vue de la diversité des hommes, mais aussi de leur fondamentale humanité commune, qu’est-ce que ça donne?
Faisons une expérience.
Soit l’énoncé politique suivant d’un assez bon niveau d’abstraction :
« Les grands thèmes de débat politique prennent tout leur sens lorsqu’ils sont traités en français. »
Demandons à un Antillais de traduire en créole le slogan en précisant qu’il ne doit rien perdre de son contenu et de sa force.
Voici un exemple de traduction en créole haïtien :
« Gwo sijè kouwè politik nan lakou Ayiti debat an kreyòl pou l ka gen gou sèl. »
(selon Potomitan, le site de promotion des cultures et des langues créoles – potomitan.info)
Parfaitement efficace la conviction linguistique exprimée en langue nationale haïtienne (le « kreyòl » est en effet langue nationale à Haïti.) Si ça vous intéresse, vous pouvez approfondir en consultant le site, ou en posant des questions de traduction de plus en plus abstraites à un copain antillais pour d’autres variétés de créole.
Conclusion :
Le créole n’est pas une sous-langue, un charabia primitif tout juste bon à permettre l’échange d’un régime de bananes contre un seau de poissons. Buffon (cf. lecture ci-après) se trompait quand il pensait qu’une vie rustique impliquait une langue fruste (ce que prouve l’autre lecture extraite du livre « les indiens blancs »). Mais vous admettrez avec nous qu’on n’est pas encore partout sorti de ces préjugés à la limite du racisme.
La valeur de toute langue coule de source pour un linguiste qui connait cette loi : toute langue est traduisible en une autre langue. (Cf lecture Jakobson)
Loi dont la conséquence est immédiate : toute langue peut exprimer n’importe quelle idée ou notion, même si cette idée ou notion n’a encore jamais été exprimée par aucun homme dans la langue en question. Cela est possible parce qu’une langue, justement, n’est pas un catalogue ; ses règles de fonctionnement sont telles qu’elle peut créer sans fin. "C’est fait pour".
Et voici un des moyens par lesquels cette capacité s’exprime. Parmi les critères qui permettent d’affirmer qu’une langue est une langue et non un quelconque système de signes, soit naturels (tels qu’il en existe chez de nombreuses espèces d’animaux) soit artificiels (inventés par les hommes pour des utilisations limitées, telles que la signalisation routière, etc.), il y a celui-ci, tout à fait capital : Une langue a le pouvoir de permettre qu’on parle d’elle, afin que les hommes qui l’emploient puissent s’adapter à toute situation de communication nouvelle. Cela s’appelle : capacité métalinguistique.
Pas d’affolement ! cela présente des aspects très banals. Cela signifie par exemple que, quand un mot manque, on peut fabriquer une expression de remplacement : « C’est le truc qui, que … »; que, quand quelqu’un ne comprend pas, on peut expliquer : « ça veut dire que … » ; puis qu’en cas d’usage répété, si vraiment le mot ne vient pas, ou s’il est mal fichu, on peut le fabriquer sur place, à la demande et à l’amiable entre ceux qui en ont besoin. Ainsi tout groupe d’hommes au boulot a les mots qu’il lui faut pour son boulot. Tout groupe d’hommes est en mesure de se fabriquer son outillage linguistique … ou de l’emprunter au voisin ; mais toujours « à sa main », on l’a vu, adapté à ses besoins.
C’est le moment ou jamais de vous rendre actifs dans la construction de vos connaissances. Nous vous suggérons de mener une enquête dans un métier que vous connaissez bien, pour voir comment le vocabulaire y fonctionne, allant ainsi un peu plus loin que ce que nos observations du début vous ont fait entrevoir. Vous recherchez:
1 - La diversification d’appellation des types d’outils selon l’usage, le type, le calibre (C’est le versant « nécessité extérieure » de la construction d’un vocabulaire. C’est à dire : il existe des objets diversifiés par la pratique : il faut bien les désigner pour travailler efficacement).
2 - Les procédés linguistiques utilisés pour construire ce vocabulaire :
a - fabrication proprement dite : néologismes - mots nouveaux créés sur place tout à fait arbitrairement ou en s’inspirant de mots existants - mots empruntés à une langue étrangère
b - « affutage » de l’outil nouveau, essentiellement :
- mots raccourcis
- par réduction des mots d’origine,
- par choix judicieux du néologisme,
- par usage du nom d’une marque qui fait bien l’affaire de ce point de vue.
Les linguistes ont trouvé des illustrations merveilleusement humanistes de cette loi chez tous les peuples. Dans Sciences et Avenir de juillet 82, une étude illustrée présente les formes variées des cornes des rennes (« merrains », vous connaissiez ce mot français de vénerie ?) et les noms que leur donnent les Lapons : « baddjin-ovda-gietta : bois dont les maitres-andouillers se dressent presque verticalement ; tseggo : bois dont les merrains sont peu courbés et presque verticaux ; etc. »… Tous détails absolument sans intérêt pour nous mais qui en présentent de considérables pour eux et qui nécessitent, par conséquent, des mots précis. De même, les Pygmées ont des mots différents pour le bruit des abeilles aux différents moments de la journée, et les Inuits pour les différentes couleurs et états de la neige sur laquelle ils doivent se déplacer. Ce sont les exigences du langage dans le travail.
Mais nous avons aussi ça chez nous. Ainsi les vocalises des gallinacés dont l’interprétation était sans doute utile dans la France rurale ; moins en banlieue toutefois.
Citation d’un affichage à « la ferme de Choisy-le-Roi » :
« Le coq est célèbre pour son cocorico : il chante ou coqueline. Le poussin pépie, piaule. La poule elle caquette quand elle pond, claquette avant la ponte, cloque quand elle parle à ses poussins, clousse quand elle couve, crételle après la ponte et glousse lorsqu’elle appelle ses poussins. »
Chez nous aussi, le phénomène n’est pas seulement archéologique. Pierre Perret nous a offert, en 2002, chez Robert Laffont, un dictionnaire savoureux : « Le parler des métiers ». Gabrielle Quemada, qui le préface, y écrit « ajoutons que les professionnels parlent rarement pour ne rien dire, ce qui distingue(rait) leurs énoncés du discours ordinaire » (p22). On est bien d’accord.
En plus de cette activité très riche de création lexicale, on peut se demander aussi si la manipulation d’idées nouvelles, la transformation radicale des façons de vivre, de travailler et de penser n’exigent pas des changements plus considérables touchant cette fois à la grammaire, ranimant nos inquiétudes sur la pauvreté des langues rustiques. Les savants en discutent. De toute façon, cela n’a rien à voir avec les préjugés racistes ou sociaux entretenus à ce propos. Car même si l’on peut envisager une plus grande complexité grammaticale des langues dites de culture, cette complexité est sans commune mesure avec les préjugés entretenus. Éventuellement, le linguiste se demandera si la soi-disant sophistication est un réel avantage.
Le latin lui-même serait là pour en témoigner par l’absurde. Soyons un peu perfides : si le français (le "beau") a autant de clarté et de précision en soi que ses zélateurs l’affirment, on pourra supposer qu’il a dû les conquérir sur le latin, langue antique, à bout de course et de force et de logique. Parce que si l’on considère l’ordre de la phrase : Sujet - verbe – complément, « cet ordre est dit logique, ou naturel, parce qu’il est le plus satisfaisant pour l’esprit. Il a d’ailleurs fortement contribué à faire du français une langue claire et précise. » (Thimonnier - Le code orthographique et grammatical, p 385 )
Voilà un zélateur du bon français qui va au fond de sa pensée.
Alors que le latin, quelle misère !
« canis canem edit »
Comment pouvait-on être Romain, et penser?
Cette phrase latine signifie « le chien mange le chien ». C’est un proverbe correspondant à notre « chacun pour soi », « l’homme est un loup pour l’homme ». C’est aussi le nom d’un jeu vidéo édité en 2006 ; bonjour l’ambiance ! Revenons à nos… moutons.
La différence de structure grammaticale entre le français et le latin, au demeurant, est simple : en français, l’ordre des mots donne très souvent le sens en effet ; en latin, on colle un signe au mot pour indiquer sa fonction, et le fameux ordre logique ne s’impose pas du tout.
Vous avez sans doute entendu parler de cette question de la prééminence d’une des deux langues sur l’autre à l’époque de la Renaissance. Mais c’était à fronts renversés, et il s’agissait de leur égalité ; le latin allait-il cesser de dominer ? Le débat a été passionné, mais il n’était certes pas raciste.
Ne nous enfonçons pas davantage dans le marais des questions mal posées.
Le latin (ouf !) est … traduisible. C’est une langue comme … le créole.
Pour se mettre en situation de ne plus poser de nouveau de mauvaises questions, des questions tellement mauvaises qu’elles débouchent sur des conclusions grotesques, il faut revenir à la complexité.
La langue ne peut exister sans les hommes (à la différence du petit bois). Ce n’est que par métaphore qu’on dit d’elle qu’elle est vivante. En réalité, ce sont les hommes qui vivent et qui, vivant, lui donnent vie.
Or, les hommes vivent aujourd’hui dans des sociétés devenues extrêmement complexes : il est inévitable que les langues reflètent cette réalité. Les questions posées ne concernent plus alors directement la communication dans la langue et l’intercommunication entre les langues. Ça, les langues (toutes les langues) le font "naturellement », parce qu’elles sont toutes assez "complexes" pour le faire et que, pour s’ajuster, elles ont la « fonction métalinguistique ». Mais il y a d’autres fonctions du langage que celles concernant strictement la communication (et cette activité ne se réduit pas à l’échange d’informations entre deux individus isolés). Nombre de fonctions du langage sont des fonctions sociales liées à des rapports sociaux hiérarchisés. Il est inévitable que ces contraintes jouent sur l’usage et l’appropriation on non du « bon usage » ; nous en traiterons longuement plus loin.
Sans plus attendre, comprenons déjà que dans l’affaire du latin (mais vous trouverez la même chose pour ce qu’on appelle « le bon français » et l’orthographe), une fonction domine les autres (c’est à dire qu’elle impose sa propre loi aux autres lois (par exemple celle qui veut que les mots soient courts quand ils servent souvent) et cette fonction s’appelle fonction véhiculaire. (voir lexique … tout de suite s.v.p!)
Pour le latin sacré, cette fonction véhiculaire a été portée à sa valeur extrême puisque l’ambition était de couvrir, dans le temps et l’espace, deux mille ans de temps et la terre entière; peut-être même l’éternité et l’infini. Dans la communion des saints, en effet, plus rien ne bouge, c’est le parfait bonheur ; et on ne prend plus le métro. Quant aux prélats sur la terre, quand ils conversent en latin, ils ont le temps certainement d’articuler « les mots les plus longs ». Mais les Chrétiens (surtout ceux d’aujourd’hui) n’en demandent pas tant au commun des mortels ; eux-mêmes ont décidé de chanter la gloire de Dieu en langue commune.
Non, le danger ne vient pas, pour le vernaculaire (la langue qu’on parle chaque jour avec ses voisins et compagnons de travail), du Verbe (Dieu le père). Quelque chose d’intermédiaire est beaucoup plus terrorisant, c’est l’État, qui a ses bonnes raisons, mais ses raisons d’État, pour qu’on l’écoute. « Le mineur de Silésie apostropha le ministre en dialecte » dans les rires de l’assemblée ( les journaux de 81). Il faut croire qu’il avait avec l’État quelques comptes à régler ; et il avait enfin le choix des armes.
Tout ceci nous oblige néanmoins à être circonspect. Au point où nous en étions un peu plus haut, nous aurions pu déjà nous laisser gagner par une douce euphorie, réparatrice de tant de peines et de désillusions, avec comme mot d’ordre : tout est bon ; laissez faire, laissez dire. On ne peut aller si vite. Il faut tenir compte de tout, même de la nécessité d’un État.
La réalité, c’est qu’il y a des langues, des dialectes, des patois, des argots, des façons de parler collectives et individuelles, des jeux de mots, des idées et des expressions, des lieux et des manières. C’est un foisonnement où il faut apprendre à se repérer.
Un foisonnement porté et animé par les lois du langage, ses lois réelles qui s’inscrivent dans celles de l’ordre social.
C’est tout ceci que nous vous conjurons de regarder en face, en adulte et de sang-froid, pour ne plus être dominés par elles.
LEXIQUE
- Pertinence
- "relatif à la chose, à la question ; convenable, approprié: des "raisons pertinentes". — Petit Larousse
Pour décrire une chose compliquée, on a le droit de choisir un point de vue.
De ce point de vue, tout n’a pas la même importance.
Les aspects significatifs sont dits pertinents.
La plupart des linguistes estiment que "seuls les éléments porteurs d’informations sont pertinents en linguistique"
- — Martinet — Éléments de linguistique générale pp. 2-6
Cela ne signifie pas qu’il n’y ait que les informations échangées qui comptent. Il y a d’autres informations, dans un échange linguistique, que ce qui est expressément dit dans les mots de la communication. (cf notamment « connotation » cf ch IV)
- Métalinguistique
- Le langage, ça marche tout seul. Quand on parle, on ne s’écoute pas parler (heureusement !) ; on pense à ce qu’on dit, on ne pense pas aux mots qu’on dit ou à la grammaire qu’on emploie. C’est comme un bon pilote de voiture : il pense à sa conduite, pas aux gestes de la conduite qui sont devenus pour lui automatiques. Parfois, cependant, il faut faire un petit effort, pour enrichir sa langue ou pour l’ajuster à celle des autres. Toute langue est équipée pour régler ce problème à tout moment utile et, dans la vie courante, cela se fait « dans la foulée », sans y penser ; mais c’est une activité essentielle.
- Classement des mots
- Sans contredire les classements classiques (noms, adjectifs, verbes, etc), il est intéressant de choisir d’autres points de vue.
- A/ On peut distinguer deux sortes d’ensembles de mots :
- 1) ensemble illimité
ex. Il mange du lapin
pain
chou
chat
chien
gâteau… très grand ensemble, pratiquement illimité de noms désignant des aliments possibles
- 2) ensemble fini (la liste est relativement courte, on voit le bout de l’inventaire)
exemples il mange du
un
ce
le
mon
ton
sonlapin … petit ensemble fini de « déterminants » ( ce sont des « mots outils » qui servent à la fabrication des phrases parce qu’ils portent en eux un sens grammatical)
- Autre exemple : l’ensemble bien connu des conjonctions « mais ou et donc or ni car »
- B/ On peut les classer aussi selon la fréquence d’utilisation. Le verbe « lire » et le verbe « liserer » n’ont évidemment pas la même fréquence.
- Des listes ont été construites selon les fréquences qui peuvent servir à l’apprentissage méthodique du vocabulaire. Un problème est de les tenir à jour. Et de déterminer les circonstances d’utilisation moyenne dans une moyenne de population. Mais aussi dans diverses catégories de la population, car on ne vit pas dans l’homogénéité collectiviste.
- C/ La fréquence recouvrira en partie une autre distinction possible : « sens unique » ou ambiguïté qui ne peut être levée que par le contexte, la situation et la « connivence » entre les interlocuteurs.
- Le mots du vocabulaire peuvent être rangés de façon concentrique selon leur fréquence d’utilisation. Ceux du centre sont souvent très polysémiques ; et donc éventuellement ambigus, sources de confusions et d’erreurs ; mais nous allons voir que généralement on s’en sort très bien. exemple :
- Lit
- (cf dictionnaire)
- Lithophanie
- Ne cherchez pas et oubliez-le tout de suite.
Ce mot banal et d’usage courant a plus de dix sens différents, plus ou moins reliés entre eux par des glissements d’idée.
ex. : le lit de la rivière (la paresseuse, toujours au lit !) ; enfant d’un premier lit (autre usage du meuble …)Un seul et unique sens : « dessin en creux sur une porcelaine translucide »
Pour la traduction automatique, les mots les plus extérieurs sont en or. Un mot, un sens. Mais ce sont des mots très spécialisés, des mots techniques.
Toutefois, des spécialistes peuvent choisir un mot extrêmement commun pour fournir leur vocabulaire extrêmement spécialisé. Dans un usage intelligent (pas dans la traduction automatique), ça revient exactement au même que le mot spécial unique inconnu du reste des mortels. Par exemple, la physique théorique appelle « charme » une propriété de ses particules. Les scientifiques qui l’on ainsi baptisée ont dû avoir des raisons humoristiques de le faire ; mais désormais, au boulot, ces raisons ne risquent guère de tordre leurs calculs. Ils utilisent un terme précis dont le sens, chez eux, est aussi unique que celui de « lithophanie ».
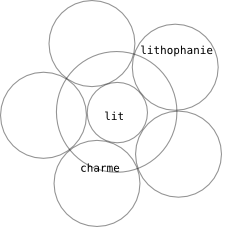
Au centre de la fleur, on trouvera donc les mots de la vie largement communs à tous les habitués d’une langue. De ce fait, et pas du tout paradoxalement, ces mots peuvent avoir du flou. Ils doivent même en avoir, car des locuteurs experts en joueront pour communiquer avec subtilité des nuances de compréhension ; et ceci quels que soient les niveaux de culture. Un « taucou » n’est pas un « couteau » dans un bon usage verlanesque, et pour ce qui concerne les « négros », ça dépend, nous explique Doc Gynéco, de qui le dit et où (voir ch 10). Ces nuances pourront en outre, bien entendu, distinguer les individus. Un adepte attardé de Buffon (voir lecture), pratiquant la France-Afrique sur le terrain (comment ne pas respecter ses dires ?) nous avait un jour expliqué combien les langues africaines étaient faciles à apprendre. Il en connaissait une qu’il parlait couramment. Bien sûr, parfois un mot sans doute lui échappait, parce qu’autour de lui les Noirs se mettaient à rire sans qu’il sache pourquoi …
Les linguistes expliquent que l’ambiguïté est fonctionnelle dans les langues naturelles et répond à la complexité de la réalité vécue, notamment dans les relation humaines. Elle permet accessoirement l’humour.
Mais pour les mots de la vie, il faut faire intervenir la notion de profondeur lexicale, qui, pour un même mot, ne juxtapose pas les sens différents, mais les intrique, les emboite et les hiérarchise. Et là, le contexte est essentiel, il va de soi : quand la rivière sort de son lit, personne ne songe à chercher remède chez conforama.
Tout ceci fait justice au reproche sans cesse asséné qu’il faut « employer le mot précis ». Ça dépend.
Petit Larousse illustré 2016 :
- Langue vernaculaire
- (du lat. Vernaculus, indigène). Parlée seulement à l’intérieur d’une communauté (par opposition à langue véhiculaire).
- Langue véhiculaire
- langue de communication entre des communautés d’une même région ayant des langues maternelles différentes (par opposition à langue vernaculaire).
Que distinguent de plus les dictionnaires ?
Petit Robert :
- Langage
- I-
- Fonction d’expression de la pensée et de communication entre les hommes, mise en œuvre au moyen d’un système de signes [vocaux ou graphiques] qui constitue une langue.
- Système de signes vocaux ou graphiques qui remplit la même fonction.
- Langue
- II-
- Système d’expression et de communication commun à un groupe social (communauté linguistique) -> dialecte, idiome, parler, patois, créole, pidgin, sabir
- Dialecte
- Forme régionale d’une langue considérée comme un système linguistique en soi (…)
spécialt. Système linguistique qui n’a pas le statut de langue officielle ou nationale, à l’intérieur d’un groupe de parlers.
- Parler
- 3 - Ling. Ensemble des moyens d’expression employés par un groupe à l’intérieur d’un domaine linguistique -> dialecte, idiome, langue, patois.
- Idiome
- Ling. Ensemble des moyens d’expression d’une communauté correspondant à un mode de pensée spécifique
- Patois
- (1285 probablt du rad. patt (cf patte) exprimant la grossièreté)
- Parler local, dialecte employé par une population, généralement peu nombreuse, souvent rurale, et dont la culture, le niveau de civilisation sont jugés comme inférieurs à ceux du milieu environnant (qui emploie la langue commune)
- Par ext. Langue spéciale (considérée comme incorrecte ou incompréhensible -> argot, jargon
- Argot
- 2 – Ling. Langage particulier à une profession, à un groupe de personnes, à un milieu fermé.
- Pidgin
- (mot angl. 1851 – altér. du mot business prononcé par les Chinois)
∼ Ling. Langue seconde composite née du contact commercial entre l’anglais et les langues d’extrême Orient, qui ne remplit pas toutes les fonctions d’une langue ordinaire
- Sabir
- (de l’espagnol saber « savoir »)
- Anciennement. Jargon mêlé d’arabe, de français, d’espagnol, d’italien, qui était parlé en Afrique du Nord et dans le Levant
- (1919) Ling. Système linguistique mixte limité à quelques règles et à un vocabulaire déterminé d’échanges commerciaux (opposé à pidgin et à créole, dont l’organisation est plus complète) issu des contacts entre des communautés de langues très différentes et servant de langue d’appoint (opposé à créole, langue maternelle). Par ext. péj. Langage hybride, fait d’emprunts, difficilement compréhensible -> charabia, jargon
- Jargon
- Langage déformé, fait d’éléments disparates (…)
- Péj. Langage particulier à un groupe et caractérisé par sa complication (…)
- Créole
- 3 – Ling. Système linguistique mixte provenant du contact du français, de l’espagnol, du portugais, de l’anglais, du néerlandais avec des langues indigènes ou importées et devenu langue maternelle d’une communauté.
- Maternelle
- 5 – Langue maternelle : la première langue qu’a parlé un enfant, souvent celle de sa mère
Dictionnaire Larousse de linguistique :
- Langues
- On reconnaît l’existence d’une pluralité dès qu’on parle de langue française, anglaise, etc.
Ce terme entre en concurrence avec les autres mots (dialectes, parlers, patois) qui désignent aussi des systèmes de communication linguistique.
La notion de langue est une notion pratique introduite bien avant que la linguistique ne se constitue ; le terme a été employé avec des valeurs si diverses par les linguistes et les non-spécialistes que personne n’est d’accord sur une définition qu’il serait pourtant essentiel d’établir avec précision.
- Idiome
1 – On appelle idiome le parler spécifique d’une communauté donnée, étudiée dans ce qu’elle a de particulier par rapport au dialecte ou à la langue auxquels il se rattache
3 – Le terme idiome peut être synonyme de langue
- Famille de langues
- On dit que deux ou plusieurs langues appartiennent à la même famille quand elles sont apparentées génétiquement (historiquement), c’est à dire quand tout laisse à penser qu’elles se sont développées à partir d’une origine commune
On distingue : indo-européennes, finno-ougriennes, altaïques et langues caucasiennes, chamito-sémitiques, nilotiques, nigéro-congolaises, d’Asie orientale et de Polynésie, américaines
Indo-européen primitif -> germaniques, celtiques, italique, grec, albanais, arménien, indien, iranien, tokharien, balte, slave
On hésite encore à affirmer la parenté du basque avec les langues caucasiennes ou avec quelque autre famille
Lectures
1 Jakobson — La commutation des codes
« La « commutation des codes » d’une langue à l’autre n’est possible précisément que parce que les langues sont isomorphes : des principes communs sont sous-jacents à leurs structures »
"La faculté de parler une langue donnée implique celle de parler de cette langue. Ce genre d’opérations « métalinguistiques » permet de réviser et de redéfinir le vocabulaire employé. »
« Toute expérience cognitive peut être rendue et classée dans n’importe quelle langue existante. »
— Jakobson, Essais de linguistique générale ; ch IV, aspects linguistiques de la traduction
Nous sur-signalisons la dernière phrase qui constitue le fondement de nos espoirs humanistes et l’argument d’autorité incontournable pour couper court au racisme ethnique et social quotidien.
Les idées que vous venez de découvrir rompent de façon radicale avec celles qu’on avait avant « l’invention » de la linguistique. La linguistique est aussi une arme contre le racisme.
Le texte suivant de Buffon résume à merveille les idées reçues qui trainent encore partout et qui s’expriment parfois, de façon à peine euphémisée, dans certains discours. Hier, c’était navrant, aujourd’hui, c’est à vomir.
Le pauvre Buffon lui-même n’est pas à mettre au pilori. Il se demande d’où vient l’intelligence et la vertu. De la civilisation sans aucun doute, mais elle peut pervertir aussi l’homme qui nait bon (comme nous l’explique JJ Rousseau). Il n’empêche que ce genre de discours s’accommode très bien du racisme et a justifié les pires démarches d’oppression jusqu’à nos jours. Or, même au temps de Buffon, on pouvait avoir d’autres informations (texte 3).
2 Buffon – De l’homme. Variétés dans l’espèce humaine.
« toute nation où il n’y a ni règle, ni loi, ni maître, ni société habituelle, est moins une nation qu’un assemblage tumultueux d’hommes barbares et indépendans, qui n’obéissent qu’à leurs passions particulières, et qui ne pouvant avoir un intérêt commun, sont incapables de se diriger vers un même but et de se soûmettre a des usages constans, qui tous supposent une suite de desseins raisonnez et approuvez par le plus grand nombre.
La même nation, dira-t-on, est composée d’hommes qui se reconnoissent, qui parlent la même langue, qui se réunissent, lorsqu’il le faut, sous un chef, qui s’arment de même, qui hurlent de la même façon, qui se barbouillent de la même couleur; oui si ces usages étoient constans, s’ils ne se réunissoient pas souvent sans savoir pourquoi, s’ils ne se séparoient pas sans raison, si leur chef ne cessoit pas de l’être par son caprice ou par le leur, si leur langue même n’étoit pas si simple qu’elle leur est presque commune à tous.
Comme ils n’ont qu’un très-petit nombre d’idées, ils n’ont aussi qu’une très-petite quantité d’expressions, qui toutes ne peuvent rouler que sur les choses les plus générales et les objets les plus communs; et quand même la plûpart de ces expressions seroient différentes, comme elles se réduisent à un fort petit nombre de termes, ils ne peuvent manquer de s’entendre en très-peu de temps, et il doit être plus facile à un sauvage d’entendre et de parler toutes les langues des autres sauvages, qu’il ne l’est à un homme d’une nation policée d’apprendre celle d’une autre nation également policée. »
— Buffon, De l’homme. Variétés dans l’espèce humaine. Édition : prestige de l’Académie française. p. 298 299
3 Philippe Jacquin – « les indiens blancs » (étude historique et ethnologique sur les rapports entre Français et Indiens en Amérique du nord du XVIe au XVIIIe siècle), Dans l’extrait qui suit on voit ce qu’il en est des préjugés de Buffon.
On comprend aussi à quelles conditions le bilinguisme est possible.
« La barrière linguistique.
« Toute l’autorité de leur chef est au bout de ses lèvres, il est aussi puissant qu’il est éloquent »142. Société de l’oralité, le monde indien est fasciné par le verbe, il apprécie l’orateur mimant une situation, le discours imagé, le rythme de la voix, le chant des sons. On écoute avec un profond respect : « après quelques mots, il commença à chanter; ses compagnons répondaient dans ce vaste espace comme une scène de théâtre, il fit des milliers de gestes, regarda le ciel, s’émerveilla du soleil …; il chanta quelques chansons entre ses cadeaux, il dansa pour le plaisir, en un mot, il se montra un excellent acteur, chacun admit que cet homme était éloquent »143. L’envoûtement ainsi produit n’a pas échappé aux Français : « qui saurait leur langue serait tout-puissant parmi eux »144. Se mettre à « l’école des Sauvages » devient, pour le commis et le missionnaire, un impératif qu’une maxime résume bien : « il ne faut que savoir la langue »145. Depuis longtemps, la barrière linguistique embarrasse les Français, entravant les bonnes relations et les affaires. La solution de Jacques Cartier, enlever deux jeunes Indiens auxquels on enseignerait le français, aboutit à un échec et l’expérience ne fut pas poursuivie. Au cours des contacts avec les pêcheurs, les Indiens retiennent des noms basques, tels que celui d’orignac pour désigner l’élan, ou encore des jurons. Mais « ils ne se soucient guère d’apprendre nos langues, car il y en a qui disent qu’ils ne nous viennent point chercher »146. Là se trouve le fond du problème : maîtres de la scène politique, possesseurs de « l’or brun », la fourrure, les Indiens n’ont pas besoin de faire l’effort d’apprendre le français. Même les tentatives de francisation des jeunes Indiens confiés aux missionnaires se révéleront vaines et, malgré les demandes renouvelées des autorités, aucun enseignement du français ne portera de fruits pendant la colonisation.
« Toutes les langues de la Nouvelle-France peuvent se réduire en deux principales, à savoir Huronne et Canadienne. La Huronne comprend presque toutes celles qui couvrent les nations sédentaires. La Canadienne comprend presque toutes les nations errantes qui se tiennent de l’embouchure de Saint-Laurent jusqu’au pays des Hurons »147. Cette dichotomie établie par le récollet Sagard cache l’extraordinaire complexité du champ linguistique de la colonie. « Continent Babel », l’Amérique du Nord compte alors deux cents langues, le Canada à lui seul cinquante-cinq qui se réunissent en dix groupes majeurs. À l’intérieur d’une même famille, l’entente est loin d’être parfaite. De parenté identique, le Montagnais, l’Algonquin et le Nipissing n’ont d’autre « différence que du Gascon ou du Provençal au Français »148, au dire de Sagard. En fait, chaque langue évolue librement et la prononciation, le vocabulaire varient à tel point que Marsolet, qui sait le Montagnais, aura le plus grand mal à se faire entendre des Nipissing, et pour cette raison « nous sommes obligés d’avoir des truchements divers pour n’ignorer rien des langues et d’une infinité de mots qu’ils ont de différents les uns des autres » 149.
Au-delà des nuances locales, le Français se heurte à d’imposantes difficultés. Il doit se débattre avec des sons nouveaux, s’habituer à une gymnastique vocale, car, en l’absence totale de consonnes et de labiales, les Indiens n’emploient pas leurs lèvres pour parler. Il est confronté à des verbes qui changent selon la nature du complément 150. À la pluralité des expressions s’ajoute un vocabulaire si fécond « que l’on peut dire une même chose de différents mots, entre lesquels ils en ont de si riches qu’un seul peut signifier autant que quatre des nôtres »151. Non seulement les mots se déclinent, mais ils traduisent à la fois plusieurs concepts; quant à la syntaxe, elle est complètement étrangère à celle des langues européennes. L’élève interprète n’est pas au bout de ses peines !
L’école des bois.
On possède peu de détails sur la façon dont se tenaient « les cours dans les bois ». Le vocabulaire de base devait s’acquérir en participant aux tâches journalières, en demandant le nom de tel ou tel objet, en bavardant avec la famille qui vous accueillait 152. À l’inverse du missionnaire, l’interprète n’a pas à exceller dans le maniement de l’abstraction et le jeu des concepts, il a besoin surtout de s’enrichir de termes pratiques du langage quotidien. « L’ennuyeux silence où l’on est réduit » 153, tant dans les déplacements que dans les cabanes, est un puissant stimulant. En effet, au cours du long hiver, le Français a peu de chances de rencontrer un compatriote et, s’il veut briser son isolement, il doit dialoguer avec ses hôtes. D’ailleurs ils l’y invitent et « ses professeurs » n’épargnent pas leurs efforts et leurs encouragements : « je répétais les mots devant mes Sauvages, lesquels y prenaient plaisir m’y aidant à m’y perfectionner, et comme ils ne pouvaient faire entendre leur conception, ils me les démontraient par des figures, quelquefois avec un bâton traçant la chose par terre ou par le mouvement du corps » 154 . Ainsi naît une pédagogie du geste. « L’écorce de bouleau sert de papier pour transcrire des mots ou faire des desseins »155. Pour inculquer certains sons, les Hurons accablent leur élève d’exercices de la voix : « il faut apprendre à la cadence », il est fondamental de connaître « la prononciation de quelques syllabes de laquelle consistent les diverses significations d’un même mot, car manquez seulement en une, vous manquez en tout ». Une fois franchi cet obstacle, la langue vous appartient et on peut aller dans « tout leur pays et traiter sans truchement » 156.
L’anthropologue Edouard Sapir affirmait qu’une langue est un guide de la réalité sociale et que deux langues ne représentent jamais la même réalité; devenir un parfait interprète exige de penser comme les Indiens et de se conformer à leur usage « des comparaisons, des mots du temps et des proverbes », Un parler imagé dont la compréhension n’est pas si évidente : « Voilà, disaient-ils, l’étoile chute, quand ils voient quelqu’un qui est gras et embonpoint ; c’est qu’ils tiennent qu’un certain jour une étoile tomba du ciel en forme d’une oie grosse » 157.
D’autres éléments interviennent dans l’apprentissage de la langue, la durée et les hommes. Quelle que soit la pédagogie des Indiens, un minimum de six mois semble nécessaire à l’obtention des bases. En fait, une parfaite maîtrise demande des années, et un missionnaire aussi doué que Jean de Brébeuf ne s’exprime couramment en huron qu’au bout de trois ans et demi. Les meilleurs interprètes, les Brûlé, Marsolet, Nicollet et autres, n’y consacrent pas moins de temps. Certains apprennent plus ou moins vite, les dispositions des candidats ne sont pas les mêmes en la matière. Le père Vimont écrit au sujet du Jeune Nicollet que « son humeur et sa mémoire excellente firent espérer quelque chose de lui » 158; Champlain constate qu’au retour de son hivernement Brûlé « avait fort bien appris leur langue »159, de même pour Richer que les Montagnais complimentent : « Tu commences à bien parler notre langue »160, alors qu’un missionnaire se lamente en disant qu’il lui faudrait dix ans d’études et une bonne grammaire pour arriver à un pareil résultat 161. Ces aptitudes, venant de gens illettrés pour la plupart, sont loin d’être partagées par tous ceux qui s’octroient le titre d’interprète. Révélatrices sont les plaintes dénonçant l’incompétence et la suffisance de truchements « qui ne savent la langue que par routine » ; beaucoup se targuent du titre pour entrer dans la traite 162. Mais leur incapacité notoire nuit tant dans les affaires qu’en politique car « ils ne rapportent pas fidèlement les choses qu’on leur dit ou par ignorance ou par mépris »
— Philippe Jacquin, « les indiens blancs »
L’ignorance et le mépris ont duré jusqu’à aujourd’hui.
Quelles lois ?
[modifier | modifier le wikicode]
Où nous remontons jusqu’aux singes,
mais pourvus de quelques notions
en état de marche
Trop rapidement évidemment, dans les premiers chapitres, nous avons essayé de montrer ce que n’était pas une langue : un catalogue, et ce qu’elle était : un système de systèmes de signes. Quelques premiers éclairages diversement orientés ont, peut-être, commencé à en faire entrevoir l’extrême complexité.
Une langue peut être considérée comme n’importe quel autre fait de la nature, et il n’y a aucune raison de penser qu’elle puisse être plus simple à étudier qu’un organisme vivant ou qu’un atome. On n’a jamais fini d’approfondir les réalités du monde, ce qui ne signifie pas qu’on ne sache jamais rien sur elles. Ces réalités sont « voilées », déformées par nos sens et nos préjugés, mais en principe on peut les « dévoiler », et en fait on y parvient ; et on s’approche de si près qu’on a « prise sur elles ». En devient-on pour autant « maitre et possesseur » ? On en a rabattu sur cette ambition prométhéenne au 20e siècle, mais de là à sombrer dans la totale résignation. La peur de se tromper n’évite pas le danger … de se tromper encore pire.
Les linguistes n’auront jamais fini d’analyser les langues ; la linguistique n’en est pas moins une science.
On peut bien dire que les connaissances qu’ils ont accumulées, à ce jour, sont moins précises sans doute, moins cohérentes, moins incontestables et partant moins utilisables que celles dont disposent, par exemple, les physiciens. Les physiciens maitrisent l’énergie atomique ; pas toujours selon nos gouts, mais assez bien en tout cas pour que des centrales produisent effectivement de l’électricité. Les linguistes, par contre, n’ont pas encore réussi à mettre au point des machines à traduire de qualité suffisante. On ne peut toujours pas se passer des bataillons d’interprètes humains au Parlement européen. Les « modèles » linguistiques scientifiques ( la langue mise en équation) sont insuffisants, ils ne maitrisent pas les langues.
Les travaux multiples ont néanmoins abouti à une compréhension nouvelle, à la fois plus claire et plus générale. Ceci est un fait culturel nouveau que tout le monde doit s’approprier. Compte tenu des enjeux. Politiques.
Après une randonnée rapide dans le contradictoire et l’incertain, dans le doute, nous allons essayer de construire. Il faudra inévitablement simplifier.
C’est pourquoi nous faisons l’économie ici d’une démarche pédagogique de construction d’un savoir. Ce que nous proposons, redisons-le, n’est pas un cours d’initiation à la linguistique (il y a des livres déjà écrits pour ça, et nous vous en avons recommandé plusieurs déjà pour vous tenir compagnie au long du voyage), mais une information culturelle entre adultes sensibilisés aux problèmes de l’écriture et de la communication, tragiquement démunis dans leur « savoir-faire » et tenus par ailleurs à l’écart de la « vérité sur le langage ».
Puisqu’il faut informer avec le minimum de lignes, l’exemple choisi (dans La Recherche n°92 septembre 1978), pour appuyer l’explication, sera un cas de linguistique appliquée ; afin de vérifier du même coup ce que nous avons aussi affirmé, qu’il y a des connaissances linguistiques qui peuvent déjà fonctionner. Ne pas tout savoir ne signifie pas que l’on ne sait rien et l’eau sale des contradictions et des confusions ne doit pas noyer le bébé. Bref! n’écoutez pas les singes savants qui médisent de la linguistique.
Lexigramme La Recherche n°92 septembre 1978 vocabulaire de la chimpanzés Lana.
Il s’agit d’un langage artificiel inventé pour permettre à des chimpanzés de parler. Comme les chimpanzés, pour des raisons morphologiques, ne peuvent pas émettre des sons modulés, le langage inventé est visuel. À ce détail près, qu’il n’est pas fait de matière sonore comme le nôtre, il possède, sous une forme élémentaire, et c’est ce qui fait tout son intérêt pour notre étude, les propriétés caractéristiques de tout langage véritable (que nous résumerons dans le chapitre suivant).
Mais d’abord, il faut s’étonner que les singes supérieurs, nos proches cousins, doivent attendre que nous intervenions pour se mettre à s’exprimer autrement que par des cris. S’ils sont si intelligents, ils devraient avoir inventé le langage articulé tout seuls. Or, les écoéthologues n’ont jamais observé dans la nature des palabres de chimpanzés. Quoi qu’il en soit, notre propos ici n’est pas l’intelligence des singes, mais l’interdisciplinarité (la linguistique appelée au rendez-vous des savants). Qu’a donc inventé l’expérimentateur en intelligence animale ?
1- Les signes inventés de ce langage chimpanzé sont visuels, mais ce ne sont ni des images représentant plus ou moins fidèlement les choses ou les êtres, ni des symboles évoquant une idée. Il n’y a, en fait, aucun rapport entre le signe et l’idée exprimée, le choix du signe est totalement arbitraire.
Si on choisit pour désigner l’eau la représentation stylisée d’une ondulation, le signe n’est pas arbitraire, car il évoque des vagues, le courant de l’eau. Mais si on choisit par exemple « ¤ » , le signe est arbitraire, il n’a aucun rapport avec la chose elle-même. « On » décide que le signe voulant dire « eau » sera représenté comme ceci et pas autrement. Ceci admis, on n’y revient plus.
Les signes du langage humain sont arbitraires. Et même ceux qui sont le plus motivés par des bruits naturels, comme les cris d’animaux, conservent une bonne dose d’arbitraire:
exemple: le coq est supposé faire :
- en France : cocorico
- en Espagne : kikiriqui
- en Angleterre : cock-a-doodle-doo
Évidemment, les savants qui ont inventé ce langage pour chimpanzé l’on fait arbitraire, exprès.
2- Dans beaucoup d’espèces, les animaux communiquent entre eux en utilisant divers signaux, parfois assez nombreux. Les corbeaux sont célèbres en la matière. Mais ces signaux ne sont pas organisés dans une structure, exceptés ceux des abeilles (on ne pouvait attendre moins d’animaux aussi laborieux et géométriques. La structure opérationnelle est néanmoins très limitée, seulement destinée à la localisation des sources de miel autour de la ruche).
D’une façon générale, le principe des langages animaux c’est : tel signal (cri ou geste), telle réaction. Il faut autant de signaux différents que de réactions possibles. Le plus souvent, ces signaux sont fixés dans la race (transmis par les chromosomes) et n’ont pas besoin d’être appris (c’est justement le cas de ce langage, structuré pourtant, des abeilles : il est absolument invariable dans l’espèce). Tous les animaux d’une même race ont le même cri (instinctif) pour signifier quelque chose (par exemple le danger) et les congénères réagissent à ce cri instinctivement. Il y a aussi, dans les espèces plus évoluées, des signaux appris par conditionnement (le fameux réflexe conditionné), mais qui fonctionnent de la même façon :
un signal ----------------> un réflexe
Le langage pour chimpanzé que l’on a inventé n’est pas, lui, une simple addition de signaux, il a été "structuré". Nous examinons maintenant comment.
1ère structure
C’est un ensemble très réduit de 9 éléments de base qui n’ont, au départ, aucune signification.
En les combinant à 2, à 3, à 4.. (ou à l. On peut décider évidemment, qu’un élément de base, seul, signifiera quelque chose, il n’y a pas lieu d’exclure cette possibilité), on obtient un nombre considérable de signes-signaux possibles (demandez à un matheux proche de le calculer). Par exemple, dans les 9 éléments de base il y a : un trait vertical, deux traits horizontaux, un gros cercle, un petit cercle, un trait ondulé horizontal, etc. On peut avec fabriquer des mots ; par exemple : vertical et horizontaux superposés = « nom de », vertical, petit rond dans gros rond et ondulé horizontal = « bonbon ». Etc. Plus quelques signes globaux ; par exemple : « ? »
2e structure
Mais c’est pas tout (de plus en plus fort !). Avec ces mots, le chimpanzé ne lance pas seulement des appels ("bonbon" ou "manger" qui pourraient vouloir dire globalement "je veux un bonbon » ou "j’ai faim"). Il construit des phrases dont le sens dépend de l’ordre des mots et pas du simple fait qu’ils sont ensemble exprimant une pensée formée d’idées et d’images liées par proximité.
La phrase « Lana donner pomme Mary » ne peut être la même que la phrase « Mary donner pomme Lana» ; de même que « le lion tue le chasseur » n’est pas « le chasseur tue le lion ».
Ne pas en conclure surtout que Lana (car ainsi s’appelle notre chimpanzée) a appris un ordre "logique" de la phrase (et, la première stupeur passée de la voir parler quasi comme vous et moi, de se dire que tant mieux pour la race chimpanzée si elle peut aligner « logiquement » les idées), car autant vous rappeler bien vite que de logique, il n’y en a pas le moins du monde dans la phrase basée sur l’ordre : Sujet – verbe - complément d’objet - Complément d’attribution. Dans d’autres langues, c’est autrement que l’on distingue ces fonctions grammaticales (nous avons déjà vu ça). La grammaire d’une langue humaine, elle aussi, est arbitraire.
Du reste, si on regarde le schéma explicatif de l’article de La Recherche, on voit, où l’inventeur a choisi de placer le signe exprimant l’idée que la phrase est interrogative ? Au début de la phrase. Et en français, où se trouve le signe indiquant l’interrogation? (nous parlons de l’oral) .
Il y a trois cas
En partant de la phrase affirmative « / il tue le lion / »
- Interrogation n° l : « / est-ce qu’il tue le lion / »
- Interrogation n° 2 : « / tue-t-il le lion / »
- Interrogation n° 3 : « / il tue le lion / » . Pareille que l’affirmation, mais avec un ton montant sur toute la phrase qui fait toute la différence.
D’où le système de traduction
| langue chimpanzée visuelle |
langage humain sonore | |
| une seule façon : ? (en premier) | = | 1 / est-ce que ; 2/ pronom sujet après ; 3/ ton montant |
Le chimpanzé est traduisible en français, mais nous voyons déjà que l’inverse (rassurons-nous) n’est pas tout à fait vrai, puisque le choix d’une façon d’interroger n’est pas tout à fait neutre ; la preuve, elle suscite des polémiques sur ce qui est ou non du « bon français ». Ce bon français, selon les puristes, exigerait le choix préférentiel n°2 ; mais cela ne les empêche pas, même si ça les énerve, de comprendre les autres. Cette réciprocité n’est pas vraie pour les gentils chimpanzés.
3- Mais, chimpanzés esclaves, chers frères, ne perdez pas espoir. Il n’y a qu’à s’y mettre au bon français. En effet, la langue chimpanzée est pourvue de la fonction métalinguistique essentielle ; voyons-la fonctionner dans l’enclos. Supposons que "pomme" soit le seul mot dont dispose Lana pour désigner un fruit, il y a tout lieu de penser qu’elle utilisera ce mot pour désigner toutes sortes de fruit. Ainsi font les bébés humains. Et si elle veut une orange, elle trouvera moyen de donner des précisions en l’appelant, par exemple, "pomme jaune". ( Ce n’est déjà pas mal du tout.)
Mais voilà ce que serait le pas décisif : un peu fatiguée de taper sur deux touches, Lana, qui sait déjà donner le nom de quelque chose qu’elle connait quand on le lui demande, ferait elle-même la demande : « ? nom de pomme jaune »
La réponse serait donnée sous la forme d’un nouveau mot formé arbitrairement avec les signes de base.
Lana aura-t-elle l’intelligence de demander ? Suspense !
Les expériences ont continué, y compris avec d’autres systèmes (dont la langue des signes des sourds-muets). Et les discussions ont continué aussi sur l’interprétation des résultats. La critique souvent portée est qu’il ne s’agit en fait que de montages de réflexes conditionnés, certes très sophistiqués, à la mesure de l’intelligence réelle de ces animaux et de l’imagination des expérimentateurs, mais pas d’un véritable langage quasi humain. Pour le moment, rien ne semble tranché (voir le numéro hors série de Science et avenir, « l’animal et nous » d’avril mai 2012 – article : « dans l’atelier des babouins volontaires »). Encore une fois, ce n’est pas notre sujet de réflexion. Résumons plutôt ce que nous avons appris en observant comment a été construit ce langage artificiel :
La langue chimpanzée est un système de systèmes de signes comportant une fonction métalinguistique possible.
On y distingue un niveau où les mots d’un vocabulaire disponible entrent en combinaison selon des règles syntaxiques pour former des phrases. Selon le schéma, connu maintenant de vous, des choix possibles et significatifs sur les axes syntagmatiques et paradigmatiques (voir lexique, ch.8)
| Lana | donner | pomme | |
| Lana | manger | bonbon | |
| machine | chatouiller | Lana | |
| etc. |
On distingue enfin un autre niveau où les signes de base, qui entrent également en combinaison, ne signifient rien en eux-mêmes, mais servent à former, comme une sorte de matériel standard de mécano, des mots, eux, chargés de sens.
Question pour le prochain chapitre. À quoi ces signes de base correspondent-ils dans le langage humain ?
Lexique
1 - Petit vocabulaire concernant la représentation de quelque chose par autre chose :Signe, indice, icône, symbole
- Signe
- Ce mot attendra. Tellement utilisé en linguistique, il faut le laisser murir. En attendant, simplement le dictionnaire : « indice, marque - ou - ce qui sert à représenter ». Cette définition générale, non particulière à la science linguistique, fait de « signe » le mot qui recouvre les trois suivants utilisés en sémiologie (mais avec des sens un peu différents et parfois variables selon les auteurs)
L’indice évoque la chose parce qu’on sait qu’il en provient ou y est lié. ex. : la fumée est l’indice du feu.
L’icône veut ressembler à l’objet trait pour trait, c’est un portrait ; mais aussi certains hiéroglyphes sont iconiques, c’est à dire que le portrait est simplifié à l’extrême, mais les traits les plus significatifs demeurent reconnaissables.
Le symbole
- C’est l’icône de quelque chose qui elle-même représente autre chose avec laquelle elle a une idée commune. ex. : la balance est le symbole de la justice parce que la représentation iconique de balance fait penser à l’équilibre, à la juste pesée, donc à la justice.
- C’est « tout signe conventionnel abréviatif » (PLI 1991)
Signal: le terme a également une valeur générale, mais implique une intention, consciente ou non, de communiquer.
Il faut également retenir:
Pictogramme : C’est un signal iconique, c’est à dire que c’est un dessin de quelque chose (et on reconnait la chose) mais qui se propose de raconter des histoires en s’articulant à d’autres signes de même nature selon un certain code d’arrangement.
L’exemple bien connu est celui des dessins d’Indien racontant sur des peaux de bison les exploits des guerriers.
Idéogramme : Dans un lointain passé, c’était peut-être un pictogramme ; en cherchant bien on retrouve un souvenir de la forme d’un objet sensible, mais l’usage répété n’en a plus fait qu’un signe conventionnel, représentant arbitrairement une chose ou une idée. La langue chinoise est idéographique (voir ch. sur l’orthographe)
2 – Arbitraire : L’arbitraire du signe est un mot bateau de la linguistique. Mais rien de plus à en dire que ce que vous avez lu : signe choisi sans autre raison qu’il en faut bien un pour désigner une réalité connue dont il faut pouvoir parler.
3 - Fonctionnement au 2e niveau de la langue chimpanzée.
Lexique : en première approximation = vocabulaire
syntaxe : règles de combinaison des mots sur l’axe syntagmatique pour faire des phrases.
En première approximation = grammaire
4 - Sémiologie : science générale des signes, et pas seulement des signes linguistiques. Un autre terme est employé qui, au profane, semblera synonyme sans inconvénient majeur :
sémiotique :
Un problème qui préoccupe les spécialistes, c’est que les signes du langage sont tellement omniprésents, y compris pour décrire et expliquer … les autres signes (ce que nous sommes actuellement en train de faire), qu’ils ont du mal à faire de la linguistique (science des signes de la langue seulement) un domaine inscrit dans la sémiologie (science de tous les signes possibles). D’autant plus que c’est l’étude du langage qui a fourni les modèles explicatifs … à la sémiologie. Qui contient qui ? Pour dire que les signes du langage humain sont d’une formidable richesse tout à fait à la mesure de l’espèce. Mais pour dire aussi que cette richesse déborde de partout et ne peut être contrainte dans un moule préfabriqué. (La langue chimpanzée est préfabriquée. Ce qu’il importerait de voir, c’est ce qu’en ferait une société de chimpanzés.)
Lecture
L’immense question essentielle indispensable pour continuer, et qui n’a pas changé depuis 40 ans
« S’il y consacre assiduité et application, un adulte intelligent peut utiliser une grammaire traditionnelle pour acquérir un certain degré de maitrise d’une autre langue. Mais le jeune enfant est capable d’acquérir la maitrise parfaite d’une langue avec une facilité incomparablement plus grande et sans aucune directive explicite. Le simple fait d’être exposé à la langue, pendant une période singulièrement courte, semble constituer tout ce dont l’enfant normal a besoin pour acquérir la compétence de locuteur de la langue. Bien fragiles sont, en réalité, les fondements de la conception selon laquelle il est nécessaire, pour développer chez le jeune enfant l’habilité linguistique, de lui fournir des indications précises, de le guider avec soin ou de le soumettre à des renforcements contingents qui soient distribués avec pertinence.
(……)
Il va sans dire qu’expliquer comment un enfant qui n’a pas été instruit peut parvenir à la parfaite maitrise d’une langue constitue un problème bien plus vaste et bien plus important que ne l’est celui de rendre compte de la capacité d’un adulte intelligent à apprendre partiellement une seconde langue à partir d’une grammaire bien construite. »
— Chomsky, , article « modèles explicatifs en linguistique », cité dans « textes pour une linguistique de Mehler et Noizet, 1974, p. 68 69
Le bel outil
[modifier | modifier le wikicode]
À grands traits, l’ensemble du système
Accrochez les ceintures!
Après avoir virevolté, nous mettons en place les grandes lois de fonctionnement de toute langue humaine :
- double articulation
+ - grammaire comme sémantique obligée
Toutes les langues humaines présentent ces lois de fonctionnement. Qu’elles puissent en présenter d’autres, plus cachées, est du domaine des recherches actuelles, mais ce qui suit est acquis ; c’est pourquoi évidemment on les trouvait dans le langage artificiel décrit au chapitre précédent.
1 La double articulation
À l’inverse de la démarche employée pour décrire la langue chimpanzée, construite exprès et sur mesure, nous partons,"naturellement" pour vous, de la phrase que nous allons essayer d’analyser comme le ferait un chimiste, en faisant apparaitre non des morceaux juxtaposés qui ne nous apprendraient rien sur ce qu’elle est, mais les éléments de plus en plus petits qui puissent, au remontage, expliquer comment ça marche (sachons d’avance cependant, comme le chimiste et le physicien, que la plongée intelligente au sein des molécules, des atomes, des corpuscules, n’en finit jamais … la réalité est inépuisable).
Voici la phrase qui servira au travail : "La petite mouche recommence à bouger"
Nous allons l’écrire de façon phonétique. Ou plutôt nous allons essayer de rendre compte, avec le système d’écriture de la langue française, de la façon dont on "parle" cette phrase.
(Il existe un système (international) d’écriture des sons qui peut fournir une traduction précise, mais nous ne l’utiliserons pas parce que l’expérience prouve que la mémoire adulte répugne à se charger de ce système pourtant commode et simple. Ce qui à vrai dire est très curieux, puisque c’est plus simple que l’écriture orthographique ; cette crispation permet de comprendre bien des choses sur le culte qu’on voue à cette dernière – à suivre !)
Dans l’Alphabet Phonétique International (API) i s’écrit i p s’écrit p mais an s’écrit ã ou s’écrit u u s’écrit Y etc.
…
Ce qui donne pour la phrase proposée : la p ( ə) t i t m u ʃ r ( ə) k ɔ m ã s a b u ʒ é
Ceci pour l’information. Maintenant nous abandonnons l’API.
Nous avons écrit, à notre façon, la phrase trois fois, et en attachant presque tout. En effet, d’abord, il n’y a aucune raison de savoir à priori où sont les "mots » (un enfant qui apprend à lire et à écrire ne le sait pas. Il faut le lui apprendre) ; ensuite, il n’y a pas une seule façon possible de prononcer, d’articuler, de rythmer cette phrase.
| (a) | la | ptit | mouch | re | co | men | sa | bou | gé |
| (b) | la | ptit | mouch | rco | men | sa | bou | gé |
| (c) | la | pe | ti | te | mou | che | re | co | men | se | a | bou | gé |
La façon la plus "neutre", ne traduisant ni un ton pédant ou scolaire, ni un ton « parigot », ni l’accent méridional, à priori c’est la façon (a). Mais la façon (b) qu’on rencontre aussi est intéressante parce que, pour des raisons phonétiques (trois consonnes à prononcer à la suite, ch, r, c) , elle oblige à une coupure plus forte entre "mouche" et "recommence". C’est une coupure imposée par la difficulté de prononcer, mais qui se place à un endroit logique.
On peut déjà distinguer grammaticalement :
 La petite bête dont on parle ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ Ce qu’on dit d’elle
La petite bête dont on parle ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ Ce qu’on dit d’elle
Voici l’analyse démarrée ; on peut la continuer et montrer de quoi est constituée la phrase en employant les procédés déjà vus de commutation et de substitution.
| laptitmouche lamouch lacoccinelle itulamouch imanjlamouche itulacoccinelle |
→ mouche, ptit, la, i, manj, tu … mais coccinelle → coc ? cocci ? cinelle ? nelle ? et mouche → mou ? che ? |
Le sens du mot disparait dans les dernières fragmentations. « la », « petit’ », « mouch », « coccinelle » peuvent être isolés, réemployés ailleurs, le sens qu’ils portent dans les morceaux de phrase « La p’tit’mouch’ » ou « la p’tit’coccinelle » se maintient pour l’essentiel. Mais, un découpage de trop, et plus rien !
Dans « mou », dans « ou » ou dans « ch », il n’y a pas un petit morceau de l’idée de mouche. Le mot « mou » existe bien, mais avec une idée totalement étrangère à « mouche » .
Simplement, il se trouve que le bruit « mou » étant possible, la « langue » l’a choisi (arbitrairement) pour signifier quelque chose, mais qui n’est liée d’aucune façon au sens de mouche. (Nous disons « langue » par commodité, mais vous savez, pour toujours désormais, qu’il s’agit d’un être abstrait, d’un objet scientifique, et non d’un être réel existant « en soi ». Ce sont les hommes qui la font vivre, et qui profitent des « créneaux » pour « garer » leurs idées.)
mouch, ptit’ … qui sont les plus petits morceaux que l’on peut isoler en conservant l’idée qu’ils ont dans la phrase, sont appelés monèmes (parfois morphèmes. Morphème = monème)
Monème = plus petite unité pourvue d’un sens.
On pourrait penser : quelle affaire pour découvrir ce que tout le monde sait, qu’il y a des mots en français ! En réalité, un monème n’est pas tout à fait un mot.
Par exemple "œil de bœuf" désignant une sorte de fenêtre ronde sur un toit pourra être considéré comme un monème, car l’image amusante qu’on a voulu faire sans doute jadis quand on a créé ce mot (point de vue diachronique) n’est généralement plus présente à l’esprit quand on emploie le mot aujourd’hui (point de vue synchronique).
À l’inverse, dans notre phrase cobaye, « recommence » peut être décomposé en deux monèmes, « re » et « commence », puisque « re » a une idée propre qui se trouve dans :
| « refaire » « rebâtir » « reboiser » … etc. |
qu’on pourrait penser retrouver dans « rechercher » (= chercher de nouveau ?), mais ce sens n’existe guère dans les dictionnaires. On ne trouve que « chercher avec soin, chercher à connaître … » Le monème « re » du recommencement se perd. Le linguiste Claude Gruaz le désigne sous le nom de « morphon » ; il a eu été morphème, on le devine encore un peu, mais on ne comprend plus pourquoi. Par contre, la valeur indépendante de re est bien connue de tous, la preuve dans ce titre de film :
« Qui a re-tué Paméla ? ».
L’analyse en monème, dit Martinet, n’est jamais une chose facile. Il n’empêche que les monèmes existent bel et bien et que la possibilité qu’ils offrent d’être combinables et
re-combinables est un avantage inappréciable des langues humaines; ce qui fait une belle différence avec les cris-signaux des animaux.
S’il fallait avoir un cri différent pour chaque situation complexe que l’on veut exprimer, imaginez un peu :
« grand-mère a trouvé une mouche dans la confiture » ce serait :
brouwanwayaou
« écrase donc la petite mouche qui bouge dans la confiture », ce serait : grouhaiaulala
… tout à fait autre chose!
Il faudrait un vocabulaire infernal! un vocabulaire infini …
Heureusement, les hommes ont un langage articulé, fait d’éléments qui s’articulent, comme des pièces de mécano. Et la première articulation de ce langage c’est celle que nous venons d’étudier, qui concerne les unités pourvues d’un sens et que nous retrouverons dans la seconde partie de ce chapitre en parlant du vocabulaire et de la grammaire.
Nous remarquons que ce que nous appelons ici la première articulation correspond à ce que nous avons appelé 2ème niveau de structure dans l’étude de la langue chimpanzée. Cela résulte du point de vue adopté ; selon qu’on fabrique à partir d’éléments inventés (langage artificiel) ou qu’on analyse la langue « naturelle ».
Dans notre analyse de la langue naturelle, nous sommes allés des gros morceaux vers des éléments plus petits. Nous allons en trouver maintenant de tout petits et davantage cachés (si on veut, des atomes).
En route maintenant vers ces atomes de la seconde articulation.
| mouch | mouche | ch | ||||||||
| moul | moule | l | ||||||||
| bouch | bouche | b | ||||||||
| souch | souche | s | ||||||||
| boul | boule | |||||||||
| bal | balle ou bal | a | → | ach | hache | |||||
| cha | chat | |||||||||
| as | ||||||||||
| sal | sale, salle | ← | sa | |||||||
| etc. |
Attention, ce ne sont pas des lettres. Nous sommes dans les sons, dans le "parler", pas dans l’écriture. Le son /a/ s’écrit avec la lettre a , mais les deux lettres d’écriture o et u, qui chacune ont leur bruit, fabriquent ensemble un son unique, ni le son /o/, ni le son /u/ : le son … /ou/.
(L’APl nous fait quand même cruellement défaut pour nous expliquer clairement.
En Api :
- ch = /ʃ/
- ou = /u/
- m = /m/
- d’où /muʃ/ = mouche)
Les petits sons, bien isolés, n’ont, en eux-mêmes, aucune signification, mais ils ont la propriété formidablement pratique, en permutant l’un avec l’autre, un à un ou à plusieurs, de changer radicalement le sens d’un segment de phrase (et par voie de conséquence, de toute la phrase).
- Lap’tit’mouchrecomensabougé
- Lap’tit’moulrecomensabougé
- Lap’tit’bouchrecomensabougé
Ces unités nouvelles qui n’ont pas de sens mais qui changent le sens sont appelées phonèmes
Cette deuxième articulation opère une économie foudroyante, sans commune mesure, du point de vue du nombre, avec celle de la première articulation dont les unités emplissent quand même de gros dictionnaires. Pour prendre un exemple, le Espagnols communiquent toutes idées nécessaires ou plaisantes sur tous les sujets, même les plus ardus, avec seulement, tenez-vous bien, 24 petits phonèmes parfaitement distincts qui produisent l’infinité des phrases possibles en espagnol.
Mais pourquoi l’espagnol ? Le français, combien en a-t-il ?
Nous nous éloignons délibérément de la langue française pour éviter d’aborder à ce sujet des questions qui fâchent. Mais, rassurez-vous, nous y reviendrons.
2 grammaire - vocabulaire
Les monèmes (ou plus prosaïquement les mots), une fois qu’ils existent, vivent leur vie de monème avec leur physionomie et leur sens. "Cinelle" n’est pas un monème, il n’a pas de sens, mais "carburateur" n’en était pas un non plus au XVIIIème siècle. Maintenant si. « Carburateur », tout seul, là devant vous, ça a un sens pour vous. Peut-être, un jour, appellera-t-on « cinelle » un objet nouveau.
La petite vie des monèmes dans le vocabulaire n’est pas si simple, mais pour l’instant contentons-nous de les croire sagement rangés dans les dictionnaires, à la disposition de quiconque veut les utiliser et les réutiliser dans les phrases sans cesse nouvelles.
Nous avons abordé le problème, par petites touches, dans les chapitres précédents, mais maintenant il faut nous centrer sur le problème : comment les mots s’arrangent-ils dans et avec la grammaire ?
Vocabulaire et grammaire s’entraident pour produire le sens de la phrase.
Dans « le chasseur tue le lion » <-> « le lion tue le chasseur », ça saute aux yeux (et aux oreilles). Mais il y a des règles moins évidentes.
Nous avions trouvé deux monèmes dans : « re-commence" (la mouche recommence à bouger)
Nous pouvons en indiquer trois dans une phrase où on écrirait : « re-commenc-ez »
ez = deuxième personne du pluriel (ou du singulier de politesse).
Mais soit la phrase (a) : « vous recommencez votre travail »
Y a-t-il deux monèmes pour la même idée (2e personne) ou un seul monème en deux morceaux ?
Soit la phrase (b) : « recommencez votre travail »
On croit entendre la voix du professeur : il n’est pas content. Il commande. C’est l’impératif. Donc :
«vous recommencez » s’oppose à « recommencez »
« vous » s’oppose à… rien ; et c’est cette opposition, cette structure présente à l’esprit sans qu’on y pense qui produit le sens d’impératif (quand on donne un ordre) et celui d’indicatif (quand on se contente « d’indiquer » les choses et les faits dont il est question)
La grammaire, que nous pourrions définir comme arrangement obligé des monèmes dans une phrase, est comme un moule où les mots en entrant peuvent exprimer d’un seul coup beaucoup plus de choses qu’ils le pourraient seuls. Le sens est, en somme, pré-digéré dans la structure.
C’est en définitive un moyen d’économiser du discours. Au lieu de dire: "Vous allez vous mettre à recommencer, et je vous préviens, c’est un ordre", on dit « recommencez ». Efficace, n’est-ce pas ! Rien que par la place, mieux même : la virtualité de place d’un monème!
Ceci dit et constaté, la grammaire n’est pas non plus sacrée et immuable. Encore une fois, les habitudes de langage et les manières de la langue sont multiples, changeantes selon les siècles et selon les langues. Dans un même moment, synchroniquement, peuvent même coexister des façons de faire différentes, plus ou moins tournées vers le vocabulaire ou vers la grammaire.
Bien entendu ces différences peuvent porter un sens supplémentaire. On l’a déjà observé : la langue fait feu de tout bois, toujours prête à saisir une forme libre pour y placer du sens.
Il y a tant de choses à faire comprendre!
C’est ce qu’on a déjà expliqué dans les repères linguistiques, mots et grammaire
| vocabulaire | (1) je suis en train de bouger je bouge dans une heure je bouge tout de suite (2) est-ce que je bouge ? |
je vais bouger | je bougeais j’ai bougé je bouge je bougerai bougé-je ? ( ciel !) |
grammaire |
La première liste (1) traite du « temps », de la façon d’exprimer la situation ou le mouvement des évènements dans le temps, en utilisant de la structure grammaticale et/ou du vocabulaire.
La deuxième liste (2) est simplement constituée de deux manières de poser une question. Celle de droite qui manifestement tombe en désuétude (et de ce fait a un inimitable ton pédant surajouté) peut permettre de comprendre pourquoi on préfère la première, laquelle utilise du vocabulaire, en l’occurrence "est-ce-que", qui bien qu’apparemment formé de trois mots est un seul monème (l’équivalent exact de la touche « ? » en langue chimpanzée - et pareillement placée en début de phrase). Ce mot pourrait être dit mot grammatical en ce sens qu’il donne la valeur interrogative à tout l’énoncé.
Dans le langage humain, il y a une 3e façon de poser une question, c’est l’intonation, un ton montant donné à la phrase : « je bouge » - « je bouge ? ». À l’écrit, le point d’interrogation à la fin de la phrase suffit à la compréhension.
Les structures grammaticales sont ainsi présentes dans nos têtes, toujours prêtes à servir. C’est pourquoi le langage schtroumpf est si amusant, car la production de sens continue malgré la disparition des mots. Mais avec l’aide par contre de la situation et de ce que l’on sait de la psychologie et des habitudes des personnages ; ce sont des données indispensables pour savourer leurs facéties et leurs jeux … de mots.
Un linguiste a inventé une phrase magique pour troubler la réflexion de ses condisciples. La phrase est célèbre dans le milieu : « D’incolores idées vertes dorment furieusement ». Ça a effectivement une allure de langue, en raison de l’ordre grammatical (alors que « dans le désordre » ça ne marche pas du tout : « idées furieusement de dorment vertes incolores »). Cette phrase grammaticale, mais « insensée », quel sens a-t-elle ?
Mais la poésie a-t-elle trop de sens, elle aussi, ou pas assez quand elle quitte le sens banal et commun et l’ordre « normal » des mots ? C’est à l’amateur d’apprécier. Nous donnons deux exemples dans les lectures. À l’amateur d’apprécier !
Nous retenons que lexique et grammaire, mais aussi la connaissance qu’on a des situations, concourent à produire le sens des conversations avec la plus grande efficacité possible.
Que les langues sont de merveilleux outils dont les êtres humains font merveille.
Et qu’en fin de compte, on peut dire qu’il y a, dans le langage, tout, sauf la pénurie. Étrange constatation quand partout on entend déplorer la pauvreté langagière de ceux-ci ou de ceux-là.
Et ce sera tout pour ce chapitre. Quand même !
Lexique
Dans l’élan constructif, nous complétons par du vocabulaire indispensable désormais. (Le chapitre était un peu court, nous vous en remettons une couche.)
| signe = | signifiant |
| signifié |
C’est la "tarte à la crème" de la linguistique. Les notions sont essentielles pour une réflexion approfondie, mais à notre niveau immédiat, il n’y a pas de quoi fouetter un chat.
Le signe
c’est quelque chose qui désigne quelque chose d’autre.
Le signe linguistique étant arbitraire, « ce qui sert à désigner » (le signifiant) n’a aucun rapport naturel avec « ce qu’on veut désigner » (le signifié). On (on ?) choisit un signifiant possible (disponible et capable de bien fonctionner) pour un signifié devenu nécessaire dans les discussions ; et voilà, on a fabriqué un signe ! Ex. « métro ».
Référent
Mais ce qu’on veut désigner n’a peut-être aussi qu’un rapport déformé voire faux avec la réalité. Comme on dit, on voit midi à sa porte. Cette réflexion relève certes de la philosophie, mais elle a aussi des côtés pratiques. Ainsi les féministes vont s’indigner qu’une même réalité :
| homme marié | <-> | homme non marié | =>> | monsieur | |
| madame <<= | femme mariée | <-> | femme non mariée | =>> | mademoiselle |
soit désignée dans le premier cas par un seul mot et dans l’autre par deux mots distincts. Ce n’est manifestement pas innocent dans la société. Et l’on conçoit que faute de pouvoir promouvoir « damoiseau », les féministes aient préféré proscrire, dans les papiers officiels, la distinction machiste, qui cependant s’obstine dans les mœurs sous le prétexte hypocrite qu’on prétend surtout vouloir souligner la jeunesse. Cet exemple explique pourquoi les linguistes ont le souci louable de ne pas confondre le signe et l’idée avec la « réalité réelle » (si l’on peut dire) qu’ils appellent référent.
| Donc, pour le signe (linguistique) = | signifié |
| signifiant |
Le signifié c’est … une idée ; Le signifiant, des sons qui l’expriment.
Le signifié, c’est l’idée qu’on se fait du référent lorsque le signifiant, dans notre cerveau, « appelle » en quelque sorte la structure de la langue que nous avons intégrée et qui « produit », elle, le signifié. On voit alors à quel point la langue peut ne pas être innocente dans la fabrication de nos idées.
Arbitraire (du signe)
La liaison Sé / Sant est arbitraire. Ça veut dire que « l’idée (signifié) de « sœur » n’est liée par aucun rapport intérieur avec la suite de sons /s oe r/ qui lui sert de signifiant ». (Saussure, fondateur de la linguistique. D.L.L. p. 443).
Par contre le signe « bonne sœur » n’est pas arbitraire dans la langue : « sœur » (-> même père) ; « bonne sœur » ( -> même père au ciel).
Mais selon la culture que l’on a (ou tout simplement l’attention qu’on prête aux mots), on pense ou non à ce sens. Si on n’y pense pas, « bonne sœur » fait bloc. ( hier encore, dans les milieux populaires, le référent pouvait être : infirmière qui fait les piqûres à l’œil parce qu’elle croit au paradis.)
Connotation - dénotation
La connotation, c’est un signifié qui vient en plus et presque en marge du signifié normal d’un signe. Ex. "rouge" dénote une couleur précise pour tous les francophones. Mais rouge connote des positions, des réactions politiques diverses.
Mangé-je ? = est-ce que je mange ? La dénotation, c’est « interrogation ». Mais la connotation de la première expression c’est « préciosité, pédantisme ou blague ».
Le D.L.L. note « le caractère vague » du concept de connotation. En face de la dénotation … il joue le rôle de « débarras ». Mais il témoigne de la vie foisonnante du langage. Une connotation peut devenir un signifié essentiel. De toute façon le jeu créatif sur le langage est sans limite et tout peut servir de support à une signification voulue. Il suffit de guetter les possibles et l’opportunité de se régaler ou de se faire valoir d’un « bon mot ». C’est pourquoi il est difficile de couler la langue vivante dans un cadre rigide.
La dénotation, c’est donc le signifié « normal », qu’on pourrait dire de base et qu’on suppose commun à tous les interlocuteurs quelle que soit la situation. Il est dans la langue ; c’est donc une pure abstraction, puisque, en principe (et en gros) les interlocuteurs « ont la même langue », mais qu’en réalité (et en détail) chacun à la sienne.
Si « chiffon rouge » dénote quelque chose d’essentiel pour moi, que je partage encore avec tant d’amis que « je connais ou que je ne connais pas », à coup sûr l’expression réclame une place dans le (mon, notre. . .) « dictionnaire idéal ». Et si mon cousin ne connait l’existence que du « chiffon rouge » qu’il doit accrocher à l’échelle qui dépasse à l’arrière de sa camionnette de petit entrepreneur, tant pis pour lui.
(Il y a donc de l’hégémonie à débattre entre couches sociales, à propos de la langue …)
Ceci dit, on peut envisager d’analyser de façon positive la dénotation (et non « en creux », par la « valeur » que prend un terme dans un système de langue, le sens qu’a ce terme quand tous les autres termes ont donné leur sens). Il faut avoir conscience que les deux approches ont des avantages et des inconvénients ( nous parlons maintenant de la vie pratique réelle, et non d’abord de la science linguistique qui ne fait qu’éclairer notre recherche d’un mieux-être dans le langage).
La définition « en creux » d’un mot par l’observation nécessaire de tous ses rapports complémentaires avec les autres mots du système conduit inexorablement à normaliser le système, à le rendre « standard » pour qu’il soit commun. Le mot "standard" existe en linguistique. On parle de langue standard : celle qu’il faudrait inculquer à tous les Français pour "qu’ils parlent la même langue".
Par contre, la définition par construction de plus en plus précise d’une définition mot après mot du dictionnaire devient très vite insupportablement compliquée.
Par exemple, les objets qui servent à s’assoir : les sièges. Un siège sans dossier, avec des pieds, pour une seule personne, c’est un tabouret ; avec un dossier, c’est une chaise ; avec des bras, c’est un fauteuil ; mais pour plusieurs personnes, c’est un canapé … On peut faire un schéma, le schéma est lisible. Mais ajoutons des « traits sémantiques » (en raison de petits perfectionnements dans l’industrie de l’ameublement). L’inventaire (le "catalogue" ! pour le coup le mot s’impose) se complique :
traits sémantiques :
- trois pieds
- à bascule
- articulé, en toile, pour aller dehors
- etc
Et maintenant, nous voulons placer "sofa". Nous voulons placer aussi "chauffeuse", "pouf" … Ça devient franchement inextricable.
Surtout que nous avons un moyen grammatical diaboliquement productif pour allonger la liste d’objets : ajouter un trait sémantique par le moyen d’un adjectif ou d’un nom précédé de "à" ou "de", ça donne: « canapé convertible », « chaise de paille » « chaise à bascule »… que n’importe quel marchand peut baptiser à sa guise d’un seul mot (et généralement en anglais) « /rokingchèr/ » …
Vous voyez, par un bout ou par l’autre, ce que peut devenir une leçon de vocabulaire à l’école élémentaire. Nous reviendrons évidemment sur la question.
Valeur valeurs
Vous vous souvenez sans doute des anecdotes historiques concernant le papier-monnaie émis pendant la révolution française, qu’on appelait "assignat". Les paysans n’en voulaient pas, ils voulaient des pièces d’or. À leurs yeux, l’assignat n’avait pas de valeur. C’était bien vrai, à cause d’un phénomène que nous connaissons bien : l’inflation.
Mais, pour eux, il ne pouvait pas en avoir, puisqu’il était en papier et que le papier n’en a pas. Sur ce point, évidemment, ils se trompaient. Ils ne comprenaient pas ce qui fait la valeur monétaire de la monnaie. Il n’est pas évident que, de nos jours, tout le monde le comprenne.
On ne peut trouver la vérité de la valeur monétaire ni dans la nature des choses, ni dans celle de ces petits objets marqués qui permettent leur échange. Ce n’est pas la rareté non plus qui confère la valeur ; le croire expose à prendre pour … argent comptant le fameux raisonnement : un cheval bon marché est rare ; tout ce qui est rare est cher ; donc, un cheval bon marché est cher.
La valeur, c’est le travail accumulé. Il faut aller au delà des apparences pour le comprendre et dépasser d’abord quelques aspects immédiats contradictoires. Car il s’agit d’un temps moyen de travail, pas le temps de travail de Pierre, Paul ou Jacques. C’est si vrai que lorsque quelqu’un découvre un procédé de travail nouveau, plus économique, pendant un temps, il fait des super-bénéfices. Le temps que la valeur se réajuste dans les produits concernés. À condition encore que certains autres facteurs ne se mettent pas en travers. Par exemple, le pouvoir politique qu’ont certains d’établir une situation de monopole qui leur permet de cacher, à leur profit, la valeur réelle de ce qu’ils vendent ; ou encore l’accaparement des produits de première nécessité, puis leur vente au marché noir ; ou encore le blocage draconien des prix par décision d’état, etc. On a même vérifié récemment (tout le monde est au courant) que le « marché libre et non faussé » ne fait pas non plus de miracles. Mais dans le paradis de la consommation, on sait maintenant exactement ce qu’un produit coute : ce que coute le travail d’un Chinois, plus les super-bénéfices des super-pharaons du monde. Fondamentalement, la valeur, c’est du travail accumulé dans les objets, et cette réalité, d’une façon ou d’une autre, finit par s’imposer. Si elle est niée, on court à des catastrophes.
La "valeur linguistique", pareillement, doit être cherchée derrière les apparences. "On appelle valeur linguistique le sens d’une unité définie par les positions relatives de cette unité à l’intérieur du système linguistique" D.L.L.
Nous avons abordé l’étude de cette définition en première et en deuxième articulation, en remarquant qu’étrangement les mêmes démarches s’appliquent à des choses pourtant aussi différentes que les monèmes (chargés de sens) et les phonèmes (qui n’en ont pas). Mais le mot qui fournit l’explication, vous le connaissez bien maintenant, c’est structure.
D’autre part, dans la pratique langagière, les « valeurs linguistiques » telles que définies ci-dessus ne sont pas les seules. Une autre « valeur » apparait dans l’ensemble des circonstances de la vie sociale où la parole tente de s’exercer. À savoir que la parole de chacun a une valeur différente selon sa position dans l’échelle sociale. Cette valeur n’est pas d’abord celle de la valeur intrinsèque des mot-assignats employés. Mais c’est justement parce que le langage n’est pas un petit bois écologique qui s’autorégule tout seul. Vous avez été prévenu dès le début : le langage est un produit social et ses problèmes sont politiques.
Est-ce que les scientifiques se sont préoccupés de cette valeur-là ? savent-ils la calculer ? C’est la grande question qui nous préoccupe.
La théorisation du problème de la valeur sociale de chaque parole individuelle a été tentée par le célèbre sociologue Bourdieu, et, au ch.9ter, nous vous donnerons quelques bonnes définitions extraites de son livre "Ce que parler veut dire".
Ce seront pour vous des balises tout à fait essentielles sur le chemin qui nous mènera aux conclusions. Du point de vue où nous sommes placés et en raison du rôle assigné à cet essai, nous devons désigner avec insistance le lieu "essentiel", où, à l’évidence, s’enclenche la douleur des aliénations dans et par le langage.
Si, dans les premiers chapitres, nous ne nous attachons pas spécialement à cet aspect déterminant, c’est parce que nous devons tenir compte d’abord, modestement, du fait que les linguistes n’ont de cesse de mobiliser toutes les précautions méthodologiques pour ne pas s’écarter de leur objet d’étude : la langue, le système de la langue. Cette attitude scrupuleuse, hautement respectable, doit être…valorisée, quelle que soit notre impatience de comprendre pour agir.
Mais après, « aux armes citoyens ! »
Lectures
Jakobson et … poésies
«
LA NOTION DE SIGNIFICATION GRAMMATICALE SELON BOAS
The man killed the bull (« L’homme tua le taureau »). Les gloses de Boas sur cette phrase, dans sa brève esquisse Language (1938), constituent une de ses plus pénétrantes contributions à la théorie linguistique. « Dans la langue », dit Boas, « l’expérience a communiquer est classée suivant un certain nombre d’aspects distincts » . C’est ainsi que dans les phrases « l’homme tua le taureau » et « le taureau tua l’homme », l’inversion dans l’ordre des mots exprime des expériences différentes. Les topoi (3) sont les mêmes — homme et taureau — mais l’agent et le patient sont distribués différemment.
La grammaire, d’après Boas, choisit, classe, et exprime différents aspects de l’expérience, et, de plus, elle remplit une autre fonction importante : « elle détermine quels sont les aspects de chaque expérience qui doivent être exprimés ». Boas indique avec finesse que le caractère obligatoire des catégories grammaticales est le trait spécifique qui les distingue des significations lexicales :
[… …]
Le choix d’une forme grammaticale par le locuteur met l’auditeur en présence d’un nombre défini d’unités (bits) d’information. Cette sorte d’information a un caractère obligatoire pour tout échange verbal à l’intérieur d’une communauté linguistique donnée. De plus, des différences considérables caractérisent l’information grammaticale véhiculée par les différentes langues. C’est ce que Franz Boas, grâce à son étonnante maîtrise des multiples modèles sémantiques du monde linguistique, avait parfaitement compris :
Les aspects choisis varient fondamentalement suivant les groupes de langues. En voici un exemple : tandis que pour nous le concept du défini ou de l’indéfini (definiteness), le nombre et le temps sont obligatoires, dans une autre langue nous trouvons, comme aspects obligatoires, le lieu — près du locuteur ou ailleurs — et la source d’information — vue, entendue (c’est-à-dire connue par ouï-dire) ou inférée. Au lieu de dire « l’homme tua le taureau », je devrais dire « cet (ces) homme(s) tue (temps indéterminé) vu par moi ce(s) taureau(x) ».
(3) NDT : nous avons choisi ce terme grec pour rendre l’anglais topic, terme générique suggéré par Yuen Ren Chao pour désigner le sujet et l’objet, cf. Y. R. Chao, « How Chinese logic operates », in Anthropological Linguistics, I, 1-8, 1959.
À l’intention de ceux qui auraient tendance à tirer, d’une série de concepts grammaticaux, des inférences d’ordre culturel, Boas ajoute immédiatement que les aspects obligatoirement exprimés peuvent être nombreux dans telle langue et rares dans telle autre, mais que « la pauvreté des aspects obligatoires n’implique en aucune façon l’obscurité du discours. Quand c’est nécessaire, on atteint à la clarté en ajoutant des mots explicatifs. » Pour exprimer le temps ou la pluralité, les langues qui ne connaissent pas le temps ou le nombre grammatical recourent à des moyens lexicaux. C"est ainsi que la vraie différence entre les langues ne réside pas dans ce qu’elles peuvent ou ne peuvent pas exprimer mais dans ce que les locuteurs doivent ou ne doivent pas transmettre. Si un Russe dit : Ja napisal prijatelju « j’ai écrit à un ami » (I wrote a friend), la distinction entre le caractère défini ou indéfini du complément (le opposé à un) n’est pas exprimée, tandis que l’aspect verbal indique que la lettre a été achevée, et que le genre masculin exprime le sexe de l’ami. Comme en russe ces concepts sont grammaticaux, on ne peut pas les omettre dans la communication. En revanche, si vous demandez à un Anglais, qui vient de dire I wrote a friend, si la lettre a été achevée et s’il l’a adressée à un ami ou à une amie, il risque de vous répondre : « Mêlez-vous de vos affaires ! »
La grammaire est un véritable ars obligatoria, comme disaient les scolastiques ; elle impose au locuteur des décisions par oui ou non. Comme Boas n’a cessé de le faire remarquer, les concepts grammaticaux d’une langue donnée orientent l’attention de la communauté linguistique dans une direction déterminée, et, par leur caractère contraignant, influencent la poésie, les croyances, et même la pensée spéculative, sans cependant diminuer la capacité, inhérente à toute langue, de s’adapter aux besoins suscités par les progrès de la connaissance.
»
C’est un peu long, mais nous poursuivrons cependant, la citation. Ne serait-ce que pour dire sans crainte sur qui et sur quoi nous nous appuyons pour « vulgariser ». Peut-être que le très grand linguiste nommé Jakobson se trompe et est dépassé, mais c’est aux savants d’aujourd’hui de nous l’expliquer. Quant à nous, dans l’urgence … politique, nous trouvons Jakobson parfait.
«
Chomsky (1), avec beaucoup d’ingéniosité, a tenté de construire une « théorie complètement non sémantique de la structure grammaticale ». Cette entreprise compliquée se révèle être en fait une magnifique preuve par l’absurde, qui rendra d’utiles services aux recherches actuelles sur la hiérarchie des significations grammaticales. Les exemples produits dans le livre de Chomsky, Syntactic Structures, peuvent servir à illustrer la manière dont Boas délimite la classe,des significations grammaticales. Décomposons la phrase, prétendue absurde, Colorless green ideas sleep furiously « D’incolores idées vertes dorment furieusement » (2) : nous en extrayons un sujet au pluriel, « idées », dont on nous dit qu’il a une activité, « dormir » ; chacun des deux termes est caractérisé — les « idées » comme « incolores » et « vertes », le « sommeil » comme « furieux ». Ces relations grammaticales créent une phrase douée de sens, qui peut être soumise à une épreuve de vérité : existe-t-il ou non des choses telles que des idées incolores, des idées vertes, des idées qui dorment, ou un sommeil furieux ? L’expression « vert incolore » est synonyme de « vert pâle » et produit l’effet, légèrement épigrammatique, d’un oxymoron apparent. L’épithète métaphorique, dans « idées vertes », rappelle le vers fameux d’Andrew Marvell, Green thought in a green shade (« une verte pensée dans une ombre verte »), l’expression russe « un ennui vert » (zelenaja skula) (1) ou encore l’image de Tolstoï, « une horreur rouge, blanche et carrée » (Vse tot zhe uzhas krasnyj, belyj, kvadratnyj). Au sens figuré, « dormir » peut signifier « être dans un état comparable au sommeil : inertie, léthargie, engourdissement », par exemple « sa haine ne s’endormit jamais » (his hatred never slept) (2) ; pourquoi donc ne pourrait-on pas dire, des idées de quelqu’un, qu’elles dorment ? Finalement, pourquoi l’attribut « furieux » ne rendrait-il pas l’idée d’une frénésie de sommeil ? En fait, il s’est trouvé quelqu’un, Dell Hymes, pour faire un sort à cette phrase dans un poème tout à fait sensé, écrit en 1957, et dont le titre est précisément : « D’incolores idées vertes dorment furieusement ».
Cependant, même si nous censurons pédantiquement toute expression imagée et dénions l’existence aux idées vertes, même alors, comme dans le cas de la « quadrature du cercle » ou du « lait de poule », la non-existence, le caractère fictif de ces entités, n’ont pas de portée s’il s’agit de déterminer leur valeur sémantique. C’est la possibilité même de mettre en doute leur existence qui fournit la meilleure mise en garde contre toute confusion de l’irréalité ontologique avec l’absence de sens. Il n’y a, de plus, aucune raison d’assigner aux constructions en question « un degré inférieur de grammaticalité ». Dans un important dictionnaire russe, l’adjectif signifiant « enceint » était classé comme uniquement féminin, parce que — beremennyj muzhchina nemyslim « un homme enceint est inconcevable ». Cette phrase russe, cependant, emploie la forme masculine de l’adjectif, et l’« homme enceint » paraît dans les légendes populaires, dans les canards des journaux, et dans le poème de David Burljuk : Mne nravistja beremennyj mužčina prislonivšijsja k pamjatniku Puškina « J’aime l’homme enceint qui s’appuie contre le monument de Pouchkine » (1). Le masculin apparaît, de plus, dans un emploi figuré du même adjectif. De la même façon,une petite fille française, à l’école primaire, prétendait que, dans sa langue maternelle, non seulement les noms, mais aussi les verbes ont un genre : par exemple le verbe « couver » est féminin, puisque « les poules couvent mais pas les coqs ». Nous n’avons pas non plus le droit de recourir à l’argument ontologique pour établir des degrés de grammaticalité, en excluant des inversions telles que golf plays John, qui, d’après Chomsky, ne sont pas des phrases (2) (cf. des énoncés aussi clairs que John does not play golf ; golf plays John « John ne joue pas au golf ; c’est le golf qui se joue de lui) (3).
L’agrammaticalité effective prive un énoncé de son information sémantique. Plus les formes syntaxiques et les concepts relationnels qu’elles véhiculent viennent à s’oblitérer, plus difficile est-il de soumettre le message à une épreuve de vérité, et seule l’intonation de phrase tient encore ensemble des « mots en liberté »(4) tels que silent not night by silently unday « silencieux pas nuit par silencieusement, non-jour » (e.e. cummings) ou Furiously sleep ideas green colorless (N. Chomsky) « Furieusement dormir idées vert incolore ». Un énoncé tel que « Cela semble toucher à sa fin » dans sa version agrammaticale « fin toucher semble à sa » peut difficilement être suivi par la question : « Est-ce vrai ? » ou « En êtes-vous sûr ? » Des énoncés d’où toute grammaire a complètement disparu sont évidemment dénués de sens. Le pouvoir contraignant du modèle grammatical, reconnu par Boas, et qui contraste, comme il l’avait bien vu, avec la liberté relative qui règne dans le choix des mots, est mis en pleine lumière par une recherche sémantique dans le domaine du non-sens.
»
— Jakobson, Essais de linguistique générale – 1963 – édition de minuit. Chapitre X, p. 196 et suivante
Puisqu’il est question de poésie …
LE GRAND COMBAT
Il l’emparouille te l’endosque contre terre ;
Il le rague et le roupète jusqu’à son drâle ;
Il le pratèle et le libuque et lui baruffle les ouillais ;
Il le tocarde et le marmine,
Le manage rape à ri et ripe à ra.
Enfin il l’écorcobalisse.
L’autre hésite, s’espudrine, se défaisse, se torse et se ruine.
C’en sera bientôt fini de lui ;
Il se reprise et s’emmargine … mais en vain
Le cerceau tombe qui a tant roulé.
Abrah ! Abrah ! Abrah !
Le pied a failli !
Le bras a cassé !
Le sang a coulé !
Fouille, fouille, fouille
Dans la marmite de son ventre est un grand secret
Mégères alentour qui pleurez dans vos mouchoirs ;
On s’étonne, on s’étonne, on s’étonne
Et vous regarde,
On cherche aussi, nous autres, le Grand Secret.
- — Henri Michaux Le grand combat (1899-1984)
Le grand combat pour la forme et la liberté dans l’art. Le grand combat des poètes. Et merci à ce grand poète (et aussi grand peintre) que fut Henri Michaux de nous révéler les mystères du langage.
Prendre corps par Arthur H ♩
Tu me flore, je te faune
Je te peau, je te porte, et te fenêtre
Tu m’os, tu m’océan, tu m’audace, tu me météorite
Je te clé d’or, je t’extraordinaire, tu me paroxysme
Tu me paroxysme, et me paradoxe
Je te clavecin, tu me silencieusement, tu me miroir, et je te montre
Tu me mirage, tu m’oasis, tu m’oiseau, tu m’insecte, tu me cataracte
Je te lune, tu me nuage, tu me marée haute, je te transparente
Tu me pénombre, tu me translucides, tu me château vide, tu me labyrinthe
Tu me parallaxe, et me parabole, tu me debout, et couché, tu m’oblique
Je t’équinoxe, je te poète, tu me danse, je te particulier
Tu me perpendiculaire, et sous-pente
Tu me visible, tu me silhouette
Tu m’infiniment, tu m’indivisible, tu m’ironie
Je te fragile, je t’ardente, je te phonétiquement, tu me hiéroglyphe
Tu m’espace, tu me cascade, je te cascade à mon tour, mais toi tu me fluide
Tu m’étoile filante, tu me volcanique, nous nous pulvérisable
etc.
- — chanté par Arthur H, texte de Ghérasim Luca Prendre corps
Un peu fatigant peut-être ici le procédé …
Vous préférez relire Jakobson ?
La bête à symboles
[modifier | modifier le wikicode]Le dessin de bande dessinée humoristique est caricatural. C’est-à-dire que les gestes expressifs normaux sont outrés pour qu’on comprenne bien. Nous allons expliquer et commenter des dessins du célèbre Pif le chien. Nous les avons observés dans Pif poche n° 120 (Le problème de © nous empêchant la reproduction de même une seule case par histoire nous oblige à un peu plus de discours, mais on comprendra quand même)
Pif et son copain Hercule vivent de multiples aventures amusantes. Par exemple, ils sont à la pêche et Pif ferre une baleine. Hercule est sidéré. Sa stupéfaction s’exprime dans une bulle par un point d’exclamation, Mais s’exprime aussi avec son corps, et comment ! Il est « stupéfié » au sens propre (lequel, indique le dictionnaire, caractérise « une sorte d’immobilité due à une très grande surprise ou un grand effroi ».) Dans l’image suivante cette stupéfaction produit un encore plus grand effet : vulgairement parlant il « en tombe sur le cul » ; les propos de Pif doivent être « renversants ».
L’artiste est habile. Il sait croquer sur le vif les expressions familières, et son imagination et son talent, qui font le reste, sont merveilleusement primesautiers … ainsi qu’en témoigne les autres images exprimant pareillement la stupéfaction.
On est bien pris! En fait d’imagination débridée, on a affaire à un code rigoureux et systématique. Un langage idéographique. Évidemment, le code du langage de la bande dessinée ne peut évoluer vers une écriture comparable au chinois dont les signes, à l’origine, comme chacun sait, n’étaient pas arbitraires, mais motivés par des ressemblances de ce genre-là. La bande dessinée doit rester, elle, un petit cinéma. Il n’empêche que, sous le "cinéma", il y a les signes purs et durs qui font leur travail de signe, c’est-à-dire qu’ils sont là pour délivrer, vite et bien, un maximum d’informations pré-codées. Quatre images et …"la chute", connotée nécessairement "super-marrante", évidemment. Le super-marrant est, comme on dit, "téléphoné". Le signifiant « bonhomme tombant sur le cul" est ni plus ni moins que le déclencheur d’un réflexe. Il faut connaitre le code pour vraiment se marrer. Mais on peut connaitre ce code sans en avoir conscience.
Il y a aussi des variantes, liées aux circonstances de l’action et aux contraintes de l’image. Par exemple, l’orientation de la plante des pieds dépend de l’orientation des différents personnages ou accessoires. Mais des détails divers apparaissent aussi qui ne sont pas absolument nécessaires au signe et qui, pourtant, chaque fois, ont l’air d’en faire partie. Notamment ces sortes de gouttes de sueur (vraiment, quelle stupeur panique !) qui flottent encore en l’air à l’endroit où se tenait le corps l’instant d’avant. Et, quand elles ne sont pas là, quelque chose d’autre rappelle la soudaineté du mouvement, une lettre, un poisson, voire la bulle. Mais il peut n’y avoir rien du tout et le monème fonctionne quand même. Ce qui est décisif c’est donc : pied en coin d’image et aussi bien à droite qu’à gauche en dépit de la fréquence des "à gauche", qui ne relèveraient que d’une préférence particulière du dessinateur, une "variante personnelle", peut-être due au fait qu’il est droitier.
L’observation plus approfondie des règles de son art révèle donc un « espace de liberté » ; mais la question importante ne se pose pas moins : le procédé d’écriture lui est-il propre ou est-il employé partout ? Auquel cas, il serait enseigné quelque part … vous voyez le rapport avec d’autres institutions comme la télé ou les journaux.
… Et la vie même, « simple et tranquille ».
Manger, s’habiller, se déplacer répondent à des nécessités naturelles, vitales.
« Elle se déplace = elle se déplace », d’abord, c’est aussi simple que ça. Elle se déplace pour aller à son travail ou au cinéma, tout le monde est libre, pourquoi aller chercher la petite bête. On peut néanmoins nonchalamment poser des questions indiscrètes :
« Tiens ! elle se déplace avec lenteur et lourdement.
Ah oui ! Sans doute est-elle fatiguée.
Déprimée ?… »
Souci d’autrui ou atteinte à la vie privée ? Ces indices sont utiles ou dangereux dans la vie sociale selon qu’ils incitent à la compassion ou au mépris. Cependant, ils sont ce qu’ils sont.
Il y a pire. Cette façon de marcher peut être délibérée. Ce peut être un signal intentionnel pour tenter de faire comprendre aux autres qu’en effet on bat de l’aile. On exagère juste un peu pour mieux appeler au secours !
À moins, au contraire, qu’on refuse pitié ou aide, et là, on se force à se tenir droit.
Ou pire encore, on craint exactement l’inverse de la compassion : le coup de grâce. Elle est « finie », malheur aux vaincus, à la porte ! Alors, dans une société implacable, serait-on à bout de ses forces morales et physique, on s’efforcera encore d’exprimer, pour ne pas être licencié, l’aisance, la décontraction, la vivacité et la satisfaction.
Donc, une simple démarche peut être autre chose qu’un indice, ce peut être le signifiant d’un signifié.
En fignolant un peu, et avec l’aide des mass médias, ce signe peut tomber dans un plus large domaine public, exemple cette publicité :
«
« Plaire »
c’est savoir marcherDans la beauté, la grâce a une importance capitale.
Le fichier « Plaire » consacre une rubrique assez riche à la démarche, à la manière de s’asseoir, de bouger … Il est des gestes, des attitudes qui vous classent : distingué ou ordinaire, séduisant ou lourdaude … Il faut connaître ce savoir-vivre de la beauté qui peut faire toute la différence : plaire ou ne pas plaire.
»
C’est fait ! Les fonctions de s’habiller, se déplacer, se nourrir deviennent des signes. Et il peut devenir parfois plus important de produire le signe que d’exercer la fonction. D’astiquer sa belle bagnole que de partir en vacances.
Prenons-en conscience, la vie de chacun est réglée, orchestrée par les signes de la vie quotidienne, ceux de la mode, ceux de la tradition, ceux du « savoir-vivre ». « À table, on mange du pain, disait grand-père, c’est poli ; on pousse avec son pain sur la fourchette, et on mange ». Parce que ce pain, qu’il fallait « gagner » « à la sueur de son front », était essentiel. Puis le métallo a « défendu son bifteck ». Le bifteck-frites, en attendant l’heure du gressin aux germes de luzerne, répondait aux besoins physiologiques d’une vie de travail intensif, davantage « sur les nerfs", plus pauvre en efforts musculaires que l’antique travail des manouvriers. Mais c’était ainsi devenu le signe, très ambitieux socialement, des revendications « de classe » et, last but not least, d’une identité nationale. Aujourd’hui le prix du Macdo est parait-il le souci familial d’un nouvel art de vivre sa mal-vie dans la modernité américaine … et dans l’obésité d’une indigence paradoxale. Apparemment, le gressin n’a pas partout triomphé.
Comment ce « langage » des « fonctions-signes » (Roland Barthes) peut-il aussi bien fonctionner ? Comment colle-t-il à la réalité en s’éloignant apparemment à ce point d’elle ?
Les symboles sont notre réalité humaine. Il y a les fonctions vitales, mais, tout aussi nécessaires dans l’humanité, les rituels. De tout temps ils ont garanti la cohésion des sociétés petites ou grandes. Ce langage-ci, comme l’autre (celui des mots dont nous semblons nous éloigner, mais c’est pour mieux y revenir), découpe la réalité sans coïncider exactement avec elle. L’important est qu’il l’organise. Qu’il oblige à des suites de comportements ; lesquels tout compte fait (tous ajoutés bout à bout), font que la société produit, consomme, se reproduit et … perpétue ses injustices.
Ces fonctions-signes doivent donc avoir une unité d’ensemble assez remarquable et une non moins remarquable robustesse pour que, changeant sans cesse, elles ne cessent de fonctionner, afin que toutes choses changeant aussi, tout reste pareil. Elles constituent une assez formidable structure.
(Par exemple celui de la mode qui change. La coupe de cheveux : elle passe du court au long, puis au court, pour signifier, en s’inversant, les mêmes oppositions de « signifiés » : révolte/conformisme, jeunesse/sagesse … avec de subtils dégradés et un usage habile possible de la zone floue où le signe bascule, pour se situer ni dans ce signifié-ci, ni dans celui-là, mais dans les deux à la fois, et encore avec des nuances : la chevelure abondante mais stricte du jeune cadre dynamique à attaché-case; puis le même avec un coup de peigne en moins …)
Tous les codes, certes, n’ont pas la même subtilité exquise. Par exemple le code de la route. Là, rouge c’est rouge et vert c’est vert. Un feu ne peut pas être un petit peu rouge, comme un engagement révolutionnaire six mois après mai 68. Du point de vue nécessaire, et respectable, du gardien de l’ordre au carrefour, les considérations sur l’orange mûrissant sont totalement fallacieuses et, subséquemment, nulles et non avenues, puisqu’il y a trois lampes l’une sous l’autre et que l’on passe de l’une à l’autre par changement brusque et non ambigu (en linguistique, on dit « discret ») … et nonobstant : retrait de permis.
Il marche aussi ce système-là. Il faut de tout dans l’univers des signes.
Mais plus on s’élève dans la culture, plus les rapports tissés entre sa propre activité symbolique et les codes socialisés, longuement élaborés dans l’histoire, deviennent complexes. Et l’inquiétude grandit. Car le "code secret" de la bande dessinée ne passe pas d’idées importantes en contrebande, ne manipule pas l’opinion. Son seul but est la franche rigolade. On ne se plaindra pas, pour rire un peu mieux, d’avoir été conditionné. Quant aux arguties déployées par les chauffards pour éviter les contraventions, elles ne peuvent pas grand chose contre le droit « discrétionnaire » de l’agent assermenté de punir ; là on est dans la société possible, quasiment tout le monde le sait et le reconnait, et non dans l’utopie anarchiste.
Mais quand il s’agit de politique, le code secret devient inquiétant. Des savants se sont attaqués au décryptage des discours cachés derrière les discours. La fréquence de certains mots et tournures peut révéler beaucoup sur la psychologie de celui qui parle (par exemple, a-t-il une pensée visuelle, orale ou d’action ?). Intéressant, mais assez anodin. Par contre, c’est l’idéologie aussi que l’analyse révèle. L’efficience du sens caché des mots sur l’auditeur est un gros problème démocratique. Dans l’information quotidienne fournie par les journalistes, qui peuvent facilement être les relais du pouvoir, le choix systématique de certains mots implique un jugement sur les faits rapportés, et agit par conséquent sur la pensée de ceux qui écoutent. Pendant l’occupation allemande lors de la seconde guerre mondiale, tous les résistants étaient des terroristes. Dans les conflits actuels, le même code est utilisé. Pour ne pas faire ici de politique émotionnelle, justement, on en restera là. D’autant que quand le choix est plus naïf il n’est pas moins redoutable, nous explique Michel Serres dans une des lectures que nous proposons.
Ce détour (important) fait, nous revenons à nos plus modestes ognons. Où il s’agit « simplement », non de faire de la politique immédiate, mais d’affuter nos outils pour mille ans d’autogestion (ou de participation). Ce n’est qu’un début, continuons le combat pas du tout terroriste de la libre confrontation des idées. Cette éducation populaire un jour éradiquera l’aliénation et métamorphosera le monde de façon pacifique …
… Eh bien en voilà du langage codé !.. Non, ce n’est pas de la langue de bois, non mais des fois, pour qui nous prend-on ?!
On avait prévenu : la linguistique aussi est un sport de combat.
Lexique
Distinctif : ce qui produit un changement de sens
ex.. : / chou/ ∼ /joue/
La seule différence entre ces deux mots, à l’oral, c’est une vibration des cordes vocales au début qui "distingue" le phonème /ch/ sans vibration du phonème /j/ avec vibration.
Avec vibration /sans vibration est le trait distinctif.
Pertinent : le dictionnaire Quillet dit:
« Ce qui se rapporte exactement à la question », c’est-à-dire ce qui compte vraiment pour ce qui est en question.
ex. Il s’agit de s’entendre agréablement avec des méridionaux en vacances. Il n’est pas pertinent de s’intéresser aux [e] dont ils encombrent (les pauvres !(*)) les fins de mot. On se comprend malgré ces [e]
/"tu la jouEs cettE boulE"
Par contre, le touriste d’outre Rhin risque de créer de regrettables confusions sur le /b/ de boule, car, pour tout francophone, la distinction /p/ - /b/ est pertinente.
Dans un même ordre d’idées, tout petit écolier de la région parisienne, pas trop névrosé, entrant à la grande école, a tôt fait de constater que « La tu li pe de Va lé rie » , eh bien! c’est une /tulip/ tout simplement, quitte à récupérer ce e sentencieux pour y inscrire un signifié utile en récré pour préserver son quant à soi quand des garnements agressent : « tu m’ embê te », avec un fort accent "tonique" sur la dernière syllabe. Si, avec ça, la maitresse n’accourt pas au galop pour protéger le petit mignon (ou la petite mignonne) ! …
(*) Chacun sait que "ne pas avoir d’accent pour … eux, c’est en avoir". Il ne faut donc pas prendre la petite moquerie au sérieux. Ce qui est sérieux par contre, c’est la difficulté d’écrire d’une façon unifiée les parlers régionaux différents. Nous verrons cela plus loin à propos de l’orthographe, redoutable question.
Discret : ne signifie pas « qu’on entend à peine » ; pour ce qui concerne le sens scientifique, le dictionnaire Quillet indique:
"qui présente une discontinuité - Math.. qui s’accroît par unité indivisible ». L’idée est celle de tout ou rien, s’opposant à des changements continus traduisant des évolutions également continues du réel. Par exemple: le ton de colère dont on peut charger ses propos n’est pas un signe discret, car toutes les nuances et signes de colère sont imaginables depuis une vague irritation jusqu’au risque d’apoplexie.
En linguistique, le phonème (distinctif, ainsi qu’on vient de le rappeler) est l’exemple même de la discrétion.
| /ch/ | /l/ | |
| mouche | ------------- | moule |
… on ne connait pas d’hybride !
Lectures
« l’habitus » selon Bourdieu
« spontanéité génératrice qui s’affirme dans la confrontation improvisée avec des situations sans cesse renouvelées (et qui) obéit à une logique pratique, celle du flou, de l’à-peu-près, qui définit le rapport ordinaire au monde » p. 96
« C’est un système de schèmes acquis fonctionnant à l’état pratique comme catégories de perception et d’appréciation ou comme principes organisateurs de l’action » p. 24
« L’habitus est le jeu social incorporé devenu nature » p. 80
« Le bon joueur se trouve tout naturellement à l’endroit où la balle va tomber, comme si la balle le commandait, mais, par là, il commande à la balle » p. 80
»
— Bourdieu, dans « Choses dites » (Les Éditions de Minuit : Le Sens commun. 1987)
Michel Serres, « Pensée unique, médias funèbres »
« Cherchons ensemble ce qui est indéfiniment répété. Placez-vous devant le poste de télévision et regardez les informations du milieu de la journée, celles du matin et du soir; prenez votre crayon et comptez simplement quel est le mot le plus répété. On appelle ça, en analyse linguistique, une « analyse de contenu ». Quel est le mot le plus répété dans les informations ?
Eh bien, c’est le mot « mort » ; ou le mot « cadavre », ou l’image du cadavre, ou le mot « victime ». Répétez après moi : cent vingt morts, deux mille morts, quarante morts, trois morts. Le mot « mort » quitte le contenu pour entrer dans la répétition. Or les psychologues disent que la répétition équivaut à l’instinct de mort.
[ … ]
J’en arrive à penser les médias comme une immense Eglise, une Eglise qui retourne au sacrifice humain, à la barbarie polythéiste, aux cultes funéraires de la mort, donnée, reçue, partout et toujours présente. Les médias jouent le rôle d’une Eglise intégriste qui parle tout le temps de la mort, qui ne parle que de la mort, où l’on cultive cette répétition hallucinée, toujours là et lancinante … La répétition, c’est à dire l’instinct de mort. Pensée unique, unicité de la mort [ … ] (et) ses déclinaisons funèbres ; catastrophes, assassinats, scandales
[ … ]
La vie jaillit d’arrêter les répétitions, de bifurquer des formats, comme un rameau se sépare du tronc, comme une branche nouvelle se lance en porte-à-faux, en écart à l’équilibre par rapport au tronc unique, à la dite pensée unique.
[ … ]
Non, ce ne sont pas des nouvelles, mais la répétition de la mort, reprise sans cesse, uniforme, monotone comme un cauchemar.[ … ] Comment voulez-vous que l’Occident n’en devienne pas mélancolique ?
[ … ]
Vive la vie ! Elle ne cesse, au contraire, de renaître ! »
— Michel Serres, Petites chroniques du dimanche soir – Éditions Le Pommier
Dur dur, l'hominisation !
[modifier | modifier le wikicode]Il fallait faire un détour pour comprendre les raisons profondes qui font du langage (le propre de l’homme, autant que le rire) un tel nœud de difficultés et d’embrouilles.
On commençait à débiter des notions à bon rythme, et si elles n’étaient peut-être pas assez claires chez le vulgarisateur, les citations « incontournables » devaient de toute façon emporter la conviction par argument d’autorité. Dans les domaines épineux, la « parole légitime », comme dit Bourdieu, est un allié dont il ne faut pas se priver ; en attendant la conviction pleine et entière ; et les débats publics sur le fond de la question.
Dans ces questions qui touchent de si près à l’école où s’est joué le destin de chacun et où se joue encore plus celui des enfants actuels en raison de l’évolution des métiers, cette façon de pratiquer le doute systématique n’est plus du tout en odeur de sainteté. Les gens veulent des connaissances précises, et qu’on arrête de toujours tout remettre en question. Le plus court chemin qui va de a vers b, c’est ba. Pas « bah ».
Mais si la complexité des choses était le fait majeur ? Alors traiter l’objet « dans sa complexité » serait le traiter « dans sa réalité » (Wallon) . Ou encore [s’il était] « essentiel de dire des choses vagues : de ne pas aller croire que ce qui ne peut pas être dit avec rigueur n’existe pas … Comme il est essentiel aussi de ne pas dire avec des mots précis ce qui ne peut qu’être entrevu [ … ]» — Bernard d’Espagnat, Un atome de sagesse. Seuil 1982. p. 94. Cette dernière idée surtout est horrible, car elle oblige à agir sans certitude et à remettre en effet toujours tout en question.
Le nouveau détour devrait permettre d’achever de situer sans ambigüité deux faits d’une très grande signification en linguistique et … en politique qui se présentent confondus dans la réalité sociale et qui ont la qualité, fort dialectique, d’être non seulement distincts mais contradictoires.
Faisons un schéma de la « condition humaine ». Tout individu est écartelé entre
| A | B |
| un pôle psychologique (individuel) | un pôle culturel (collectif) |
Au pôle A nous voyons à l’œuvre, pour l’affaire que nous traitons, ce que les psychologues appellent la fonction symbolique qui s’exerce dès le plus jeune âge chez tous les êtres humains (et peut-être chez certains animaux supérieurs). Cette fonction s’exprime de mille façons et pas seulement dans le langage.
Nous rappelons que créer un symbole consiste à remplacer quelque chose par autre chose pour le représenter, ce qui offre un avantage énorme sur la prise en compte de la chose elle-même (même par l’intermédiaire de son image dans le souvenir), car le remplaçant peut être à la limite n’importe quoi. C’est cette limite qu’exploite à fond le langage, grâce à ce que les linguistes appellent « l’arbitraire du signe ».
On sait que les enfants, dans leur jeu, sont des champions précoces de la fonction symbolique. Cette faculté leur vient très tôt et avant le langage. Piaget raconte comment, chez les bébés, des objets ou des gestes peuvent se mettre à signifier toutes sortes de désirs ou de circonstances. Et les psychanalystes expliquent que l’inconscient, qui prend ses racines dans l’enfance, est rempli d’images symboliques qui s’articulent entre elles pour signifier, quand on va y fouiller, des choses essentielles sur ce qu’on est, ce qu’on ressent et ce qu’on fait.
En fin de compte on est tous poussés par le sens que l’on prête aux choses … et aux mots, qui sont à la fois communs à toute une collectivité et absolument personnels. Ceci ne simplifie pas la linguistique. Elle est confrontée au foisonnement de la réalité et non à un ensemble de catégories rigides. Il faut bien, dans ces conditions, qu’elle délimite son objet. Elle trouve alors un ordre dans la réalité qu’elle étudie, et des lois scientifiques. Ce ne sont pas des lois superficielles. Les côtes du melon ne sont pas faites pour que le melon soit facile à découper en famille, et les structures de la langue pour faire des résumés à apprendre par cœur. C’est pourquoi l’école n’aime pas la linguistique.
Au pôle B, cependant, nous rencontrons, par définition, l’exigence de l’apprentissage. Le pôle B est celui de l’accumulation sociale des symboles et ses exigences restrictives. Chaque individu peut fabriquer du symbole à volonté, mais la société doit mettre un peu d’ordre là-dedans pour que ça puisse servir à tout le monde.
Il faut, en quelque sorte, institutionnaliser les symboles. Ce sont alors des symboles obligatoires, sinon contraignants … C’est-à-dire qu’on peut ou non les ressentir comme contraignants, imposés, arbitraires (au sens ici de pas justifiés, despotiques), de toute façon on ne les choisit pas.
Chaque être humain n’a pas à réinventer la culture. Elle est stockée en dehors de lui. Ce qui ne signifie pas qu’elle soit intangible et figée, ni qu’on doive nécessairement l’assimiler à coups de pied au cul. Elle s’impose de l’extérieur à chaque individu, mais aucun individu n’est passif, que ce soit positivement ou négativement. L’être humain est toujours symboliquement actif.
Alors, bien entendu, si pour certains humains ce qu’il faut apprendre est imbibé d’angoisse, la culture, ce sera dur !
Nous voyons mieux maintenant l’utilité de ces détours hors du « langage des mots ». D’abord, on constate qu’il y a toutes sortes d’autres langages que le langage des mots : en les comparant, on peut espérer découvrir des lois communes. Un langage éclaire l’autre (sémiologie). Ensuite, les conditions psychologiques (ce qui se passe dans la tête de chaque individu) et sociales (culturelles, institutionnelles) dans leurs rapports mutuels apparaissent d’ores et déjà comme des données essentielles pour accéder au langage des mots, objet principal de nos préoccupations.
D’ailleurs, les linguistes eux-mêmes qui s’étaient efforcés, dans un souci de rigueur, d’éliminer du champ de leur travail ce qui n’était pas phonèmes et monèmes, s’aperçoivent que, pour « traiter du langage dans sa réalité », il faut se préoccuper des conditions psychologiques et sociales dans lesquelles les phrases sont énoncée. (Ce qui ne leur simplifie pas la tâche).
Plus abruptement on peut dire :
il n’y a pas une grammaire idéale fonctionnant dans des cervelles idéales en produisant des phrases idéalement conformes à la langue, et des grammaires mal apprises fonctionnant de travers dans des cerveaux mal foutus produisant des énoncés de débile.
Aucun savant n’a jamais rien dit de tel, même quand il parle de « compétence » et de « performance ». Quand les linguistes choisissent pour objet d’étude un ensemble de phrases délimité (un corpus) afin d’en tirer une "grammaire bien formée", et qu’il s’agit de phrases du style dit « soutenu » (parce que c’est ce qu’ils ont sous la main, pardi ! ils ne vivent pas en HLM), sur le fond, ils sont sans préjugés. Ce n’est malheureusement pas ce qui attend les enfants des « milieux défavorisés » à l’école.
En voici un qui avait demandé à son enseignante tout à fait dévouée et attentive :
"Quoi tu fais, maitresse ? P1 (Phrase n° 1)
Ça sonnait abominablement charabia. Donc, c’était du charabia. Donc, il fallait l’acculturer, l’enfant, au plus vite. Mais y parviendrait-on à ce niveau de dégradation? …
Cependant, comme tout un chacun, l’adulte désespérée, à laquelle l’enfant s’était adressé, aurait volontiers usé avec ses amis ou collègues de cette forme familière, relâchée, mais acceptable dans une conversation détendue :
"Tu fais quoi à midi? » P2
(“Tu manges au chinois ou tu restes à la cantine pour corriger ensuite tes cahiers ?”)
La correction exigerait:
"Que fais-tu ? " P3.
Ou un peu plus familièrement :
« Qu’est-ce que tu fais ? » P4
Comparons les écarts entre P1, P2, P3 et P4.
La cause est sans appel, du moins du strict point de vue de la langue, objet de nos soucis.
Un fait de langage produit des effets, mais si on prend l’exacte mesure du fait ici rapporté, l’effet est disproportionné. L’effet symbolique produit par la première des « fautes de français » est sans commune mesure avec le fait de langue qui le supporte (que nous nommerons le signifiant de l’effet signifié). On ne saurait, en tout bon sens, imputer la gravité de cette faute à une sorte de désorganisation profonde du système (ce que pense l’adulte, qui se désole). De "désorganisation", il n’y en a point. Il y a simple rupture de la norme et "jeu" dans les lois du système : adoption de « quoi » qui porte en lui suffisamment de sens (interrogatif et référentiel) pour être compris avant comme après le verbe et assimilation, tout à fait « logique », à « où, comment, pourquoi » (ex : Comment tu fais ? ) ; nous avons d’ailleurs, déjà attesté en « bon français », « Quoi faire ? ».
D’ailleurs, des exemples de cet usage relâché de « quoi », aujourd’hui, il n’y a qu’à se baisser pour en ramasser. Ex : « La morale politique, c’est quoi ? », Ségolène Royal, rapporté sur France-inter le jeudi 4 octobre 2006 à 8h10.
Il n’y a dans P1 que le choix personnel (bravo le petit !) de mettre son « quoi » essentiel en tête.
Nous constatons par conséquent le tout venant banal de la créativité (cf lexique du ch 1) et non, sur ce symptôme précis où se fige un jugement sans appel, l’inverse, une supposée absolue pauvreté.
Pour ne pas errer dans l’illusion démagogique, disons tout de même qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Oui, ce pauvre gosse et son milieu n’allaient pas bien et produisaient continuellement des preuves, non de leur imbécilité, mais de leur marginalisation. En bref, et en utilisant le langage linguistique, la tournure ici utilisée était « grammaticale », mais pas « acceptable ». Il fallait qu’elle soit acceptable pour appartenir à la tribu. D’où le désespoir pédagogique. Mais qui sera toujours impuissant s’il y a erreur de diagnostic.
Ce que l’on doit affirmer, c’est que cette faute de français ne révèle objectivement qu’une aptitude à faire… ce que tous les autres font : en prendre à l’aise de temps en temps avec la norme (et ainsi faire évoluer le français).
Jadis, la norme, c’était le "parler du roi". Des grammairiens de l’époque avaient tout à fait bien expliqué la chose. Ils disaient (Vaugelas) : c’est l’usage qui commande ; mais il y a mille usages différents ; il faut donc en choisir un ; ce sera celui de la Cour, ça va de soi (cf lecture).
Sous la République, on admettait (discrètement) que c’était celui des “intellectuels parisiens” (cf lecture). Aujourd’hui, c’est la nouvelle bourgeoisie "libidinale et ludique“ (Clousquart, « le capitalisme de la séduction » ; on ne les appelait pas encore les bobos), qui prospère à la télé et s’y lâche. On regretterait presque la télé du Grand Charles ; tout le monde, là, i(l)s étaient égaux devant la loi du « bon usage » fixé et enseigné.
Revenons aux savants.
Et notamment au problème autrement grave, que nous avons mis en tête de liste, qui les préoccupe, eux, depuis longtemps, diaboliquement banal et évident : comment un bébé de 20 mois parvient-il à acquérir avec aisance des lois qu’eux, les linguistes, ne parviennent pas à démêler ? A croire que le cerveau est équipé, de naissance, de circonvolutions spéciales pour trier les phonèmes et les règles de grammaire dans le « bain de langage#x202F;» où vit chaque « petit d’homme », comme le foie fait pour les glucides et les lipides de la digestion (cf texte de Chomsky mis en évidence au chapitre III ).
Mais il est à la fois banal et navrant de constater que, si les bébés apprennent, sans souffrir et sans y penser, les subtilités de la langue orale, la moitié des écoliers échouent dans l’apprentissage scolaire de la langue écrite qui pourrait être conçue, à première vue, comme un simple décalque de la première (b,a,ba). Ce qui n’est pas vrai, nous le savons bien, mais l’ordre des difficultés n’en peut être radicalement différent. Nous avons fait justice, en effet, de l’idée que la langue orale la plus commune ne serait qu’un code pauvre et rudimentaire. Il peut y avoir, peut-être, une différence quantitative entre les langues (liée d’ailleurs moins à la langue qu’à la connaissance que l’on a du monde - par exemple, pour l’instant, nous étendons notre connaissance du monde et pour cela nous sommes obligés d’acquérir un vocabulaire nouveau - fonction métalinguistique), mais il n’y a pas de différence qualitative : de toute façon les règles sont complexes, et les linguistes ont autant de mal à démêler celles de la grammaire académique que celles des Jivaros.
Cette question de la complexité de toute langue et de la façon dont une langue (ou plusieurs) est assimilée par tout être humain (excepté les débiles profonds qui n’accèdent pas à une langue, mais au mieux à un ensemble de signaux, comme les animaux) recouvre ainsi quelques-uns de nos espoirs en de meilleurs lendemains pour tous. Nous ne pouvons qu’espérer que les spécialistes dénouent au plus vite l’écheveau. En attendant, continuons la promenade, pour admirer les merveilles de la nature et nous armer encore contre l’obscurantisme et le mépris.
Et croyez-nous, les savants travaillent. Grâce à l’imagerie cérébrale, ils font actuellement des progrès importants. Mais, eux ne font pas les mariolles. Il faut les lire (voir nos références entre lexique et lectures)
La question posée est :
Comment l’être humain armé de sa fonction symbolique arrive-t-il, vaille que vaille, à se repérer et circuler dans des "forêts de symboles ». Mais parfois aussi y périr.
Lexique
| A | B | |
| Parole | Langue | |
| Performance | Compétence | |
| Énonciation |
Là-dessus des explications extraites du D.L.L.
1 - Des citations de Saussure (inventeur de la linguistique moderne 1913)
"l’étude du langage comporte deux parties : l’une essentielle a pour objet l’étude de la langue qui est sociale dans son essence et indépendante de l’individu, l’autre, secondaire, a pour objet la partie individuelle de la langue, c’est-à-dire la parole"
« (la langue) C’est un produit social de la faculté du langage et un ensemble de conventions nécessaires adoptées par le corps social, pour permettre l’exercice de cette faculté chez les individus".
« (la langue) est un produit que l’individu enregistre passivement"
« (la parole) est un acte de volonté et d’intelligence".
2 - Voici maintenant les nuances qu’apporte Chomsky (ce célèbre linguiste américain)
(Comme il veut nuancer et infléchir en fonction de ses propres idées, il doit inventer des mots nouveaux sur la question.)
Compétences : système de règles dont dispose un être humain et qui constitue son savoir linguistique, grâce auquel il est capable de prononcer ou de comprendre un nombre infini de phrases inédites.
Performance : ensemble des contraintes qui s’exercent sur la compétence pour en limiter l’usage (mémoire, attention, contexte social, affectivité …etc.)
Ainsi, pour Chomsky, on irait d’une compétence établie à des performances plus ou moins … performantes !
Chez Saussure, c’est plutôt l’inverse : du prodigieux pouvoir de l’Individu libre et créateur aux contraintes, hélas inévitables, de la vie en société. Nous voyons, de toute façon, la contradiction se bloquer sur ses deux pôles (A et B). D’où la nécessité d’introduire une notion nouvelle
L’énonciation : en employant ce nouveau mot, le linguiste signifie que son intention est de ne rien oublier de ce qui fait la communication véritable.
Par exemple, s’il surprend une conversation autour d’une mobylette dont l’enregistrement ne révèle que des phrases inachevées, entrecoupées de « ouais » et de « super », il n’en conclura pas que la performance est lamentable ou révèle peut-être même une compétence embryonnaire. Il n’aura pas été sans remarquer que la mobylette, au départ complètement immobilisée, s’est mise à pétarader de plus belle au terme d’échanges évidemment fructueux puisque « la preuve du pudding c’est qu’on le mange" et la preuve de la mobylette c’est qu’elle tourne autour du pâté de maisons (en faisant un bruit d’enfer, mais c’est une autre question). Il visera par conséquent à "substituer aux dualités saussuriennes [ …] une autre problématique théorique, articulant le champ de la linguistique à des domaines comme l’histoire, la pratique sociale, l’idéologie[ …]. Cette nouvelle problématique se caractérise par le rejet de l’idée d’un code neutre (la langue) opposé à la liberté individuelle de locution (la parole).
Ce souci de considérer le langage comme une activité de production et de réintégrer au sein de la théorie linguistique le sujet se retrouve dans les problématiques de l’énonciation[ …]".
(Fuchs et Le Goffic Initiation aux problèmes de linguistique contemporaine – 1975, Hachette
p 16 et 17)
Langue(s) et situations d’énonciation
D’aucuns feront remarquer, cependant, que la prestation langagière incontestable (on les entend parler) est en réalité très rudimentaire, et qu’une tout autre communication, faite de gestes et d’habitudes partagées, assure l’efficacité de l’action.
Ceci, en effet, mérite réflexions et non seulement l’engagement militant aveugle.
Linguistes et pédagogues distinguent en effet :
- le langage en situation
- le langage hors situation, beaucoup plus exigeant et difficile à acquérir et maitriser. Nombre de ces linguistes (avec les théorisations nécessaires à l’appui) et la plupart des pédagogues (eux, "spontanément", car c’est leur idéologie dominante) ajouteront que les structures de la langue écrite ayant historiquement investi le langage hors situation, l’accès à ce langage hors situation passe pas l’apprentissage de la langue de culture.On propose donc pour les enfants des « milieux défavorisés » (ceux dont les proches, soi-disant, n’ont guère d’autre occasion de s’exprimer que dans le style: « donne-moi ça », avec geste à l’appui), dès la maternelle, un programme d’exercices compensatoires pour acquérir le langage hors situation, c’est à dire le vrai « bon français » dans l’esprit des thérapeutes, et c’est là où le bât blesse.
Ces réflexions et propositions ne nous écartent donc pas du champ des contradictions où nous nous sommes délibérément placés en disant que nous n’en bougerions pas aussi longtemps que de "bonnes questions" ne s’y feraient pas entendre. Sans nier, bien entendu, les précieuses distinctions descriptives des deux types de langage, nous suggérons un protocole d’expérience susceptible de nuancer, peut-être, leur caractère un peu dichotomique. Il consisterait, en gros, à isoler un des bricoleurs de mobylette dans une cabine téléphonique, afin de voir si, hors de vue de l’engin, il peut encore contribuer à sa réparation. (Nous exigeons cependant, pour respecter les enseignements de Claude Bernard sur la méthodologie de l’expérimentation scientifique, qu’il s’agisse toujours d’une mobylette et non, par inadvertance, d’un complément d’objet direct.)
À priori, si le sujet peut produire l’énoncé suivant :
"T’as vu la petite goupille qui tient la durite noire du carburateur ? T’as qu’à la faire sauter pour dévisser les vis platinées du delco" - i.e :
"Avez-vous considéré les obstacles contingents qui interdisent l’approche rationnelle du phénomène? Vous n’avez qu’à les écarter pour affronter les données réelles de la situation",
nous considérerons les propos misérabilistes comme non pertinents pour l’approche rationnelle de la question essentielle du droit à la parole.
Il faut lire :
« Les neurones de la lecture » de Stanislas Dehaene – 2007, éd. Odile Jacob
« Le langage – introduction aux sciences du langage », ouvrage coordonné par Jean-François Dortier – 2010, Éditions Sciences Humaines
« Apprendre à lire, des sciences cognitives à la salle de classe », plusieurs auteurs, sous la direction de Stanislas Dehaene — 2011, éd. Odile Jacob
Et un ouvrage de vulgarisation ; on l’attendait depuis si longtemps ! :
« La plus belle histoire du langage » ; plusieurs auteurs, dont Ghislaine Dehaene — 2008, Seuil
Ces auteurs ne proposent pas la baguette (ou le tournevis) magique dont rêvent les adeptes des pédagogies mécaniques, lesquelles ont nettement le vent en poupe, au moment présent.
Dans ce contexte, à lire, tout de suite, le livre d’Olivier Houdé :
« Apprendre à résister » — Olivier Houdé, édition le Pommier, 2017
Olivier Houdé, ancien instituteur, rejoint les chercheurs précédents ; il emploie les mêmes méthodes et techniques de recherche et met en évidence une capacité du merveilleux cerveau humain consistant à pouvoir pratiquer, même très jeune, le doute méthodique. Il appelle ça la capacité d’inhibition, « la capacité de notre cerveau à inhiber les automatismes de pensée pour nous permettre de réfléchir ». Cette capacité, on peut la négliger, voire l’annihiler ou au contraire l'encourager et l’entrainer. C’est un choix politique. On constate alors que les découvertes savantes ne vont pas sans discussions sérieuses dans lesquelles les béotiens que nous sommes ne parviennent pas toujours à distinguer ce qui relève des critères scientifiques et des choix civiques (cf Sciences et Avenir de juin 2018). Nous reviendrons évidemment sur tout ces problèmes au fil des pages. Mais, comme les savoirs et les techniques évoluent très vite, vous n’éviterez pas d'avoir à suivre.
Lectures :
Vaugelas
Comment situer et établir la norme ?
Le postulat et la méthode Vaugelas
«
Nous auons dit qu’il y a vn bon et vn mauuais Vsage; et j’adiouste que le bon se diuise encore en l’Vsage déclaré, et en l’Vsage douteux.
Ces Remarques seruent à discerner également l’vn et l’autre, et à s’asseurer de tous les deux. L’Vsage déclaré est celuy, dont on sçait asseurément, que la plus saine partie de la Cour, et des Autheurs du temps, sont d’accord, et par conséquent le douteux ou l’inconnu est celuy, dont on ne le sçait pas.
DE QUELLE FAÇON IL FAUT DEMANDER LES DOUTES DE LA LANGUE
Ce n’est pas vne chose inutile de descouurir le moyen par lequel on peut sçauoir au vray l’Vsage que l’on demande, quand on est en doute; Car faute de sçauoir la méthode qu’il faut obseruer, et de quelle façon il faut interroger ceux à qui l’on demande l’esclaircissement du doute, on n’en est point bien esclaircy; au lieu que par le moyen que ie vais donner, on voit clairement la vérité, et à quoy il se faut tenir, Par exemple, ie suis en doute s’il faut dire elle s’est fait peindre, ou elle s’est faite peindre, pour m’en esclaircir qu’est-ce qu’il faut faire ? Il ne faut pas aller demander, comme on fait ordinairement, lequel faut-il dire des deux; car dés là, celuy à qui vous le demandez, commence luy mesme à en douter, et tastant lequel des deux luy semblera le meilleur, ne respondra plus dans cette naïfueté, qui descouure l’Vsage que l’on cherche, et duquel il est question, mais se mettra à raisonner sur cette phrase, ou sur vne autre semblable, quoy que ce soit par l’Vsage et non pas par le raisonnement, que la chose se doit décider, Voicy donc comme i’y voudrois procéder, Si ie parle à vne personne qui entende le Latin, ou quelque autre langue, ie luy demanderay en Latin, ou en cette langue là, comme il diroit en François ce que ie luy demande en Latin, ou en cette autre langue; Et s’il n’en sçait point d’autre que la Françoise,
⌈ je lui poserai une question détournée ⌋
tost ou tard, cette personne seule, ou plusieurs ensemble dans vne mesme compagnie, à qui ie me seray adressé, ne manqueront point de dire elle s’est fait peindre ou elle s’est faite peindre, et de ce qu’elles diront ainsi naïfuement sans y penser et sans raisonner sur la difficulté, parce qu’elles ne sçauent point quelle elle est, on descouurira
le véritable Vsage, et par conséquent la façon de parler, qui est la bonne, et qui doit estre suiuie.
»
— Vaugelas, D’après « La langue française, histoire d’une institution » Jean-Paul Caput — Larousse 1972
Hagège
«
Le débat réel, ici, concerne la notion de simplicité. Surchargée de présupposés psycho-culturels, cette notion ( …) demande une caractérisation objective. L’urgence communicative des situations de déprivation linguistique n’a pas, comme on le croit, imposé un minimum opérationnel ( …) (Ces langues), pour être des langues économiques, analytiques et motivées, ne sont cependant pas des langues simples, au sens où il s’agirait d’instruments rudimentaires répondant à la nécessité d’une communication minimale.
»
— Hagège, – L’homme de paroles chap 2 : Le laboratoire créole p. 36, 37-40
Jakobson
«
Les langues diffèrent essentiellement par ce qu’elles doivent exprimer, et non par ce qu’elles peuvent exprimer » (p84) « À l’intention de ceux qui auraient tendance à tirer, d’une série de concepts grammaticaux, des inférences d’ordre culturel [il faut ajouter immédiatement] que les aspects obligatoirement exprimés peuvent être nombreux dans telle langue et rares dans telle autre, mais que la pauvreté des aspects obligatoires n’implique en aucune façon l’obscurité du discours. Quand c’est nécessaire, on atteint à la clarté en ajoutant des mots explicatifs. » (p201)
»
— Jakobson, – Essais de linguistique générale p. 84 et 201
Bourdieu
«
La compétence suffisante pour produire des phrases susceptibles d’être comprises peut être tout à fait insuffisante pour produire des phrases susceptibles d’être écoutées ( …) Ce qui est rare, donc, ce n’est pas la capacité de parler qui, étant inscrite dans le patrimoine génétique, est universelle, ( …) mais la compétence nécessaire pour parler la langue légitime qui, dépendant du patrimoine social, retraduit des distinctions sociale
»
— Bourdieu, – Ce que parler veut dire p. 42
Meschonnic
«
Le sens politique-poétique de la langue suppose certainement une ambition. Mais dès que cette ambition se fixe sur la langue, au lieu de se placer dans le langage, elle n’est plus qu’une jactance. C’est le langage qui est en jeu dans la langue, pas la langue dans le langage.
Ce sens du langage n’est autre que le sens de la vie [ …] Cette activité n’est pas seulement un passé. Elle est permanente. Sauf chez ceux dont les idées sont arrêtées. Et il n’y a peut-être vraiment de langue que tant qu’il y a une invention dans la pensée. Puisqu’une langue est une histoire, elle en a l’infini.
»
— Meschonnic, – De la langue française p. 306
Si après ça vous continuez à croire ce que disent les cuistres et les racistes sociaux …
Mais comment établir la norme ?
«
Le parler du Roi
… ou un succédanéAussi, faute d’autre définition, la prononciation de référence dont il sera question ici est celle de l’auteur, c’est-à-dire celle des milieux parisiens instruits. Bien qu’elle ne s’impose plus comme modèle à imiter, elle reste, au moins historiquement, celle qui garde une position dominante.
p 117
Le son (plus exactement le phonème) œ̃ noté un dans l’écriture, a pratiquement disparu de l’usage courant. Certains savent le produire, mais oublient de le faire quand ils parlent (ce qui est le cas de l’auteur de ces lignes) : brin et brun s’entendent donc en brɛ̃, chacun en ʃakɛ̃, etc.p 125
Théoriquement, il faudrait considérer comme une faute le refus instinctif de produire un œ̃ dans lcs mots brun, chacun, aucun, un, mais c’est un trait caractéristique de la variété de parlé étudiée ici que de ne pas connaître ce son et d’y substituer ɛ̃ (brin, pain, fin, etc). Que cette amputation de l’appareil des voyelles nasales françaises soit déplorable, c’est l’opinion de beaucoup de spécialistes, même de ceux qui, comme l’auteur de ces lignes, commettent régulièrement cette faute en dépit des efforts faits pour 1’éviter. C’est que la prononciation œ̃ n’est vraiment réalisée que par ceux qui y ont été habitués dès le début de leur apprentissage du français. Les autres la réalisent quand ils font attention, mais dès que l’automatisme reprend le dessus, ils ne produisent plus que des ɛ̃. De ce point de vue, on ne peut que donner raison aux théoriciens qui considèrent que le son (le phonème) œ̃ a pratiquement disparu de cette sorte de français parlé.p 149
»
— Aurélien Sauvageot . Ancien élève de l’École normale supérieure. Professeur honoraire de l’École nationale des langues orientales., — Analyse du français parlé — Hachette 1972
Au boulot, pas d’cadeau !
[modifier | modifier le wikicode]Cette fois, munissons-nous tout de suite de notre gilet de sauvetage!
→ Lecture : Martinet 1.10 – 1.11
Ce qui est en question, c’est notre balancement incertain entre le libéralisme linguistique et la contrainte. Le "dépassement dialectique" est-il possible, et pas trop loin, par pitié, de la vie quotidienne.
C’est aujourd’hui le grand sursaut national. Les maitres de la vieille école, heureusement, ne s’étaient pas laissé abuser par les sornettes des rénovations. Ils l’avaient prédit qu’à tout foutre en l’air, l’animalité reviendrait au galop, la sauvagerie et les "cris inarticulés". Il est temps de reprendre les choses en main ; au point où l’on est, par le début. « On commencera par la deuxième articulation. » C’est Martinet qui le dit (2.10). b + a = ba.
Le maitre un peu linguiste n’a donc plus, lui, qu’à reprendre son bâton de pèlerin pour demander aux enseignants revalorisés de bien vouloir prononcer et reconnaitre les sons distincts, par exemple du mot médecin. 90 % des interrogés, qui disent le mot en deux syllabes, affirmeront qu’ils ont prononcé un /d/. Il ne faut pas poser les questions comme ça, ça fait trois siècles et demi que Vaugelas nous l’explique (cf Vaugelas, lecture ch. précédent). Heureusement, on est mieux équipé qu’au temps de Vaugelas : les paroles s’envolent et les écrits restent ; les mémoires magnétiques aussi. L’électronique sera impitoyable si on a caché, comme dans les films, un micro dans son veston : c’est un /t/ qui a été prononcé. Pareil quand on dit apsent pour absent ; tout le monde fait cette « faute », il n’y a pas de raison de s’en culpabiliser, c’est automatique. Mais c’est mal parti pour la croisade contre le laxisme articulatoire.
C’est pourquoi aussi il faut qu’ils s’y tiennent, les technocrates qui orientent les reprises en main, à la syllabe écrite. Qui ne peut être qu’une syllabe orale à l’heure du b, a, ba : allez faire distinguer une syllabe écrite d’une syllabe orale à un esprit de six ans en train d’apprendre à … écrire. Mais on peut dresser, on sait faire, ça fait cent cinquante ans qu’on s’y entraîne :
La tu li pe est rou ge
Sur quoi on pourra établir pour mille ans, les saintes et vénérées règles de l’orthographe, qui, bien certainement, auraient tendance à tourner de l’œil si la langue évoluait. Nous examinerons de près cette crainte bien fondée plus loin.
… Et pourtant elle évolue. Voir, pour ce qui concerne ce « e muet », la publicité des « petits Lu ». Les « p’tits Lu » désormais ne seront plus ce qu’ils sont sans l’apostrophe. L’intérêt du marché a tranché contre le purisme orthographique. Pourtant, après un dressage scolaire bien accepté, le « parler bébé », qui articule tout, reste, croit-on, la bonne façon de parler aux petits enfants afin qu’ils comprennent. Ils comprennent et apprennent en fait la langue qu’on parle tout autour d’eux, et l’articulation des syllabes écrites, meilleure représentation sans doute de ce qu’on appelle la langue standard ou correcte, est seulement présente dans la mémoire des adultes qui évidemment l’oublient quand ils parlent entre eux … D’ailleurs, ils l’oublient aussi avec leurs bébés quand ceux-ci se mettent à converser vraiment. Mais quand il s’agit de bien se faire comprendre, le parler bébé standard reprend le dessus. Car le parler normal est supposé être un sous-produit, une dégradation du vrai français. Ce n’est donc pas le « parler bébé » absolument nécessaire (et universel) qui est en question, mais sa ré-interprétation à l’ombre du cours préparatoire … futur. Pauvres bébés, heureusement qu’ils ont l’esprit souple.
… Pauvres petits CP, heureusement qu’ils ont l’esprit souple … Mais pas tous ! On peut même penser, puisque le « parler bébé » de toute façon est une exigence anthropologique, que sa réalisation en « parler CP » est un avantage comparatif : dans la douce chaleur familiale, c’est une bonne préparation à l’école ; ainsi la boucle est bouclée.
Il ne s’agit donc pas de nier les lois du langage. Des lois, il y en a, plein, on l’a vu. Le problème est d’utiliser, au profit de tous, leur force vive ?
Pour « médecin », la loi est très simple : on pourrait dire mé de cin (trois syllabes orales et … trois syllabes écrites). Le e prononcé comme voyelle s’accompagne nécessairement de vibrations de la gorge (les voyelles sont « sonores »). Or le phonème /d/ a lui aussi de telles vibrations. D’où l’accord parfait de l’écriture et de la parole orale quand la syllabe "de" est articulée. Mais si le /d/ a des vibrations, c’est la propriété (on dit trait pertinent - plus, pour être précis, une certaine force d’explosion moindre que pour /t/ et qui contribue aussi à la distinction) qui le distingue du /t/ (sourd –sans vibration et plus sec). Dans ces conditions -c’est facile à comprendre- quand on dit « mède-cin » en deux syllabes, comme c(/s/) qui suit /mèd’/ n’a pas, lui, de vibration (ce qui le distingue du phonème /z/ qui en a), pour articuler à l’aise sans risquer de s’empêtrer la bouche, il est commode de les ôter à /d/, qui devient /t/ ipso facto. On appelle ce phénomène « assimilation ».
L’opération éclaircissement du taillis vocal est possible ici parce qu’il n’existe pas de mot qui se distinguerait de médecin-met’cin par cette seule distinction t/d . Mais il ne faudrait pas en conclure qu’on peut partout ainsi se laisser aller. On ne saurait confondre « l’odeur » et « l’auteur », « toto » et « dodo », ni une « bière » et une « pierre » à cause de « apsent ».
Des lois comme ça, il y en a plein d’autres qui se mettent inexorablement à fonctionner quand la syllabation change.
« / mont’ pas su’l toboggan / » (qui nous semblait en mauvais état – père craintif !), hurlions-nous un jour à notre rejeton de notre 5e étage d’HLM ! Nous nous confrontions, innocemment, à la "fameuse" règle des 3 consonnes : la langue française répugne à prononcer trois consonnes à la suite ; surlt est impossible ; c’est comme ça, c’est la loi. Et si ces consonnes semblent indispensables ? Pour respecter la loi, malgré l’écriture, on ajoutera une syllabe supplémentaire et un e-pas muet même s’il n’existe pas dans l’orthographe
| Exemple : | des arcs-boutants, | on prononce | / dézarqueboutan / |
| des ours polaires, | --------------- | /dézoursepolair/ | |
| Ouest France, | --------------- | /ouestefrance/ |
La loi, disons-nous, et pas la fantaisie et le laxisme !
On était bien tranquille au chapitre 4 avec notre petit ensemble de phonèmes. Tout se complique.
Il y a donc ce e bizarre, à éclipse, clignotant. Des linguistes n’y vont pas par quatre chemins: « ce n’est pas un phonème » (Bonard « de la linguistique à la grammaire » Sudel 1974, p. 38. Martinet explique à peu près la même chose à 3.22 de ses « éléments de linguistique générale.)
Quand on doit le dire ce e pour les raisons susdites, il tend à se prononcer comme dans /un œuf/ ; et même peut-être comme /des œufs/ (le signe sms de « de », c’est « 2 », et c’est bizarre pour certaines vieilles oreilles).
| /e/ | /eu/ |
| un œuf | des œufs |
| je joue | un jeu |
Lesquels dites-vous pour heureux, peureux … ?
C’est qu’il se passe de drôles de choses dans cette zone d’articulation
/peureu/
ou / pereu / comme /petit/
Et ce n’est pas tout, o rentre dans la danse ; o c’est le o de toto, mais c’est aussi, dans la région parisienne, un son qui devient presque /e/
ex. un pilote / pil[e]t /
Par contrecoup, en sens inverse, il arrivera qu’un enfant écrive « roquin » au lieu de « requin », ou « perseune » au lieu de « personne ».
Mais les adultes aussi en plaisantent.
Dans un petit dessin humoristique d’un calendrier, le client d’un boulanger s’est déguisé en Zorro parce qu’il n’a pas compris qu’on lui demandait seulement de payer avec "des [z] euros".
Cependant, notre Zorro défaillant n’est pas une victime du laxisme ambiant récent. Martinet, notre maitre, a décortiqué tout ceci il y a longtemps dans son livre de 1969 "Le français sans fard" ; le chapitre XII est intitulé "C’est jeuli le Mareuc !" C’est pas à cause de 68, puisque le texte de ce chapitre reproduit un article de lui publié en … 1958.
Mais le « reblochon », lui, ne plaisante pas : la phonétique normative (orthoépie) est prioritaire dans sa pub.
Mais il y a plus rigolo encore : le syllabisme dans le peloton de l’évolution. Une charade dans un périodique pour enfants : " 1 - une pie - une queue d'écureuil - un nid - une queue de chat " = " un pi que ni que ". On soupçonnerait quand même une pointe d’humour pour cet accompagnement débonnaire de la méthode syllabique ; ce périodique étant par ailleurs intelligent et bienveillant.
Dans ce climat d’incertitude, d’instabilité et d’angoisse, les linguistes, eux, ne s’effraient pas. Ils sont bien convaincus que les phonèmes ne peuvent pas être, à la différence des signes de base du langage chimpanzé, taillés sur mesure et tirés au cordeau. Ce ne sont pas des pièces de mécano. Il faut bien qu’il y ait du jeu dedans, c’est ça qui leur permet de bouger, si nécessaire, ni trop ni trop peu, ni trop vite, ni trop lentement, selon l’évolution "naturelle" de la langue.
Les phonèmes sont l’assise, peut-être ("peut-être" est une précaution scrupuleuse par rapport à l’hypothèse que les mécanismes grammaticaux fondamentaux seraient innés. Là, ce serait le stable du stable -nous verrons cela plus loin), la plus stable du système de la langue, mais soumis au mouvement général quand même (voir lecture).
C’est la structure qui commande, ils ne peuvent qu’obéir. Au risque de déplaire aux amateurs d’immobilisme, ils ne peuvent dissimuler leur vie profonde et les changements qui s’opèrent en eux, changements nécessaires à la ré-équilibration du système quand, quelque chose ayant bougé en un endroit, tout se met en branle pour que ça ne reste pas de guingois.
L’évolution se traduit souvent par le phénomène dit de neutralisation. En certaines positions dans les mots, le rôle distinctif d’un phonème, par rapport à un autre, disparait, mais comme il persiste ailleurs, du moins pour certaines catégories de la population, là où il n’est plus qu’une variante d’un phonème général qui recouvre les deux anciens (tout en se re-situant par rapport à tous les autres), il est encore connu comme phonème par certains citoyens, et c’est ce qui peut provoquer des conflits et des difficultés dans l’apprentissage.
C’est le cas de /é/ - /è/, dont la tendance à la neutralisation est particulièrement forte et peut se résumer ainsi, d’après les meilleurs auteurs : /é/ - /è/ ne sont distinctifs que quand ils finissent le mot. « Distinctif » en fin de mot permet de ne pas confondre « faites-moi un p » et "faites-moi un pet" ; confusion qui pourrait être redoutable dans une classe surchargée ; mais dont la probabilité d’occurrence semble infime.
On songe à celle qu’on a laissé malheureusement s’installer entre /a/ et /â/. Tout le monde a en mémoire les conséquences horribles du laxisme articulatoire, quand la spikrine de la célèbre émission "Bonjour Madame" eut énoncé la terrible phrase : "mettez vos /pat/ dans l’eau bouillante" précipitant des milliers de ces malheureuses, déjà affligées d’un vocabulaire confus, dans le service des grands brulés des hôpitaux.
Mais ne rions plus. Rétablir /a/ - /â/, /in/ - /un/ (gageons que cette dernière distinction vous ignoriez même son existence), est pour certains un rêve proche. Sûr, ils vont labourer la mer ! Mais en attendant, ils profitent des moindres souffles de désolation concernant la marche du monde pour emmerder tout le monde.
Dans son livre de repentirs « les fautes de français, plus jamais », le présentateur d’émissions de télévision Julien Lepers reprend scrupuleusement les reproches que certains auditeurs, acharnés du « bon français », lui font, et promet de ne plus recommencer. Son livre commence évidemment par les exigences d’une bonne prononciation. É et è sont là bien sûr, et a et â. Mais, curieusement, pour un et in, il ne s’appesantit pas trop ; on décèlerait même une pointe d’humour sur la façon de s’y prendre : « partir du eu et, graduellement, faire remonter le son produit vers le nez. Allez-y, exercez-vous ! »(p42) … Procédure abandonnée radicalement depuis des lustres par les intellectuels parisiens (voir lecture Sauvageot, précédent chapitre). Il dit avoir été conseillé par un éminent linguiste ; Il y a donc anguille sous roche puisque in-un est toujours là dans le PR (2009) plutôt laxiste aux yeux des puristes. Mais où va-t-on, où va-t-on ? …
Autrement, pour revenir à [é] et [è], la loi est qu’ailleurs qu’en fin de mot, s’il y a une consonne en fin de syllabe, c’est /è/, s’il n’y en a pas c’est /é/ (ou hybride /é,è/), variante non libre contextuelle … Et totalement graphique depuis la réforme de 90 quand il s’agit d’écrire é ou è. C’est è quand la syllabe écrite d’après est terminée par un e : évènement comme avènement. Ce qui laisse encore pantois les disciplinés de l’orthographe : amusez-vous à compter les évènements et les événements dans les publications 30 ans après la nouvelle règle. Il est vrai que simplifier pour instaurer une règle purement graphique peut sembler assez cocasse voire idéologiquement dangereux. En fait c’était une règle opportuniste. Madame Catach, maitresse d’œuvre, défendait « l’accent plat », mais il fallait bien ruser.
Ceci dit, doit-on laisser partout gagner les confusions?
e ↔ eu ↔ o ↔ et d’autres
Jeudi, je dis : vous l’amenez la monnaie → / je di je di : vous la me né la me né /
… Et d’autres.
Imaginons qu’un tiers de la France s’enrhume de façon chronique, qu’un tiers perde ses dents de devant, non remboursées par la sécurité sociale, et que le dernier tiers, dans un contexte de carence affective, s’installe dans le zozotement. On peut s’attendre partout à des réactions vives, spontanées, sans doute fraternelles, mais énergiques aux quatre vents des chantiers :
" Bon dieu, articule ".
Il faudra bien se soigner!
Il faut bien admettre que la langue est par nature totalitaire et coercitive. Elle s’impose à chaque individu. C’est un ordre implacable où chaque citoyen joue le rôle de kapo-chef de son voisin. Alors, pourquoi craindre on ne sait quel pourrissement auquel on ne pourrait répondre que par le dressage au berceau ?
Eh bien, la réponse est simple : à cause de J. Ferry. Car la situation était tout autre il y a un siècle et demi. Il ne s’agissait pas alors de normaliser la francophonie, il s’agissait de liquider les patois (de mettre fin aux régionalismes, à la mosaïque linguistique, et politique). Il s’agissait de substituer la langue française unificatrice et civilisatrice (on le conteste aujourd’hui, mais ce n’est pas notre propos d’en débattre) aux patois isolés ou reculés. Mais maintenant que tout le monde rencontre tout le monde et parle français ; lorsque même un berger du Larzac a des chances de parler à la télé, que peut-on craindre?
Il n’y a qu’à avancer dans ce sens, vers encore plus d’échanges et plus de démocratie. N’ayez crainte, on articulera, on a trop à dire qui se refoule, que ça fait partout des névrosés, qu’on paye des spécialistes pour les soigner … Parlons, d’abord parlons !
Mais que disons-nous? que la démocratie est un instrument privilégié de culture et d’éducation … Et pas seulement l’école ! …
Lexique
Variantes
1 / Variantes contextuelles (ou combinatoires, ou liées)
Elles sont imposées par l’environnement immédiat du signe dans la phrase
a) Exemple de première articulation
ons - est la terminaison de la première personne du pluriel des verbes au présent
rons - est la terminaison de la première personne du pluriel des verbes au futur simple
Injectons le verbe « aller »
→ allons
→ irons
On dit que le monème du verbe aller a ici deux variantes all et i , variantes liées respectivement à rons et ons . On n’est pas libre de mettre l’une ou l’autre ; le contexte, les combinatoires phoniques et grammaticales imposent le choix (quoique le chanteur Renaud réussisse à dire « nous nous en allerons »).
b) Exemple de deuxième articulation.
- On analyse la position de la langue et le bruit exact que l’on émet lorsque l’on prononce le /k/ de « con » et celui de « qui » et on s’aperçoit d’importantes différences. Mais personne ne s’en doute. /k/, pour les Français, est un seul phonème.
- Par contre /é/ et /è/ encore distinctifs, s’entendent avec leur son précis même là où c’est le contexte seul qui décide du choix. Ex en fin de mot terminé par une consonne : mer, sec, etc
… sauf pour les oreilles de ceux chez qui la neutralisation est complète , c’est à dire pour qui il n’y a plus que /ē /. Ce qui fait qu’on peut toujours leur articuler avec le plus grand soin : je chantais, je chantai, ils entendent exactement la même chose. Surtout quand les puristes qui veulent corriger ne font pas eux-mêmes la distinction.
2 / Variantes libres
C’est à dire libres du contexte immédiat. Ce sont des raisons d’accent régional, de niveau de langue ou de style qui décident le choix.
a) Exemple de première articulation
« tifs » et « cheveux » dénotent exactement la même chose (synonyme), mais la connotation est évidemment très différente.
b) Exemple de deuxième articulation
/r/ , l’exemple classique des [r]parisiens et bourguignons.
Leurs différences, particulièrement sensibles, ne distinguent jamais, en français, un mot d’un autre.
Mais ce qui est vrai en français ne l’est pas forcément dans une autre langue. Il y a des langues où les deux r sont distinctifs. On comprend bien là pourquoi un phonème n’est pas un son. Un phonème, c’est une réalité abstraite qui n’a de signification que dans son système phonologique , dans une langue donnée ; et même dans une « variété » sociale ou locale de cette langue.
À propos de l’ e muet
[a de min ] = [ a d’min ]
On pourrait même dire que /d/ a deux variantes /d’/ et /de/ puisque la substitution de l’un à l’autre ne distingue pas des mots différents. Martinet signale cependant « l’être » et « le hêtre », « dors » et « dehors » ; évidemment, ça pose problème. Mais ne rencontre-t-on pas ailleurs des situations marginales du même style : « l’apesanteur » et « la pesanteur ». Pour distinguer oralement deux mots de sens opposés, il faut faire une pause sensible après l’article. On se débrouille avec les moyens qu’on a. Et quel bonheur ! on n’en manque pas.
On voit se confirmer de toute façon que pour analyser, il faut choisir un point de vue : /d/ c’est un phonème, unité abstraite ; [d] c’est le bruit qu’il fait.
Délimitation des phonèmes
… Et ce bruit du phonème n’est pas un bruit stable et parfait, défini d’après un diapason. C’est une réalité autant cérébrale qu’acoustique définie par l’ensemble des oppositions qu’elle entretient avec l’ensemble des autre phonèmes d’un système phonologique. En outre, ce n’est pas une vibration sonore unique, c’est une combinaison de sons qui ne s’opposent pas bloc contre bloc, ce sont des « traits distinctifs » qui s’opposent.
Chaque langue a son propre système phonologique. Et les phonèmes de chaque système ne coïncident pas.
C’est dans cette réalité abstraite que se nichent les bizarreries de prononciation des étrangers apprenant le français et qui trop souvent servent de prétexte à la moquerie, voire au mépris.
Soit la langue (supposée) des Patagons (P) et celle des Bachibouzouks (B) et des sons de ces deux langues situés dans une même zone sonore allant de m à n dans la continuité des longueurs d’onde (en réalité, ainsi que nous l’avons dit, chaque son du langage est formé de plusieurs sons combinés, mais nous simplifions ces données acoustiques).
Soit donc dans le système des P , de m à n, trois phonèmes x y z et dans le système des B, toujours de m à n, deux seulement (ce sont ici des langues tout à fait fantaisistes, x y z v et w des phonèmes … inconnus et m et n leurs limites pour la démonstration).
| /x/ | /y/ | /z/ | ||
| P | m | ------------------/// | -----------------/// | --------------------n |
| /v/ | /w/ | ||
| B | m | ---------------------------/// | ------------------------------n |
Les bébés P et les bébés B ont, comme tous les bébés, commencé par gazouiller, c’est à dire produire tous les bruits qu’ils pouvaient produire avec leur bouche (en réalité, des observations récentes semblent indiquer que le bébé, dans le ventre de sa mère, commence le travail de discrimination. Langue ô combien maternelle ! … Mais l’essentiel reste quand même à faire après la naissance, ainsi qu’on sait).
Donc, les bébés ont modulé toutes les nuances possibles et imaginables depuis m jusqu’à n . Puis ils ont cessé cela. Ils ont accepté de découper la continuité phonique en zones correspondant aux sons opposables de la langue où ils ont été plongés. Des expériences ont prouvé qu’il se créait alors une sensibilité différente aux frontières des phonèmes adoptés (en hachuré), faisant barrière.
Mais quand un B entreprend ultérieurement d’apprendre la langue P (et plus il s’y met tard, plus c’est difficile ; adulte, il ne se débarrassera quasiment jamais de son accent), il n’a pas cette sensibilité réflexe dans les zones tampons des phonèmes de P. Regardons le schéma ; on voit que selon le /v/ de sa langue, il a tendance à mordre sur /y/ sans s’en rendre compte. Car pour chaque langue, tout est permis pour chaque phonème, jusqu’à la limite extrême où ça bascule dans le phonème voisin. Quand il fera ça, les P vont rire.
Il arrive aussi plus simplement, mais pas plus facilement pour celui qui apprend, que dans la langue apprise un trait particulier distinguant deux phonèmes de cette langue n’existe pas dans la sienne. C’est le cas en français du trait « sonore » s’opposant à « sourd » pour distinguer /j/ de /ch/ et /z/ de /s/. Des orateurs d’origine étrangère peuvent laisser trainer une petite difficulté à sonoriser ce qui doit l’être, et on entend : « [ch]e me souviens de cette déci[s]ion ». C’est navrant pour l’efficacité politique. Mais ce n’est rien à côté des ricanements que peut entendre sur un chantier un immigré parlant de la cigiti.
Heureusement, par bonne justice immanente, les bons Français peuvent avoir eux-mêmes du souci à se faire au regard du système phonologique officiel. Les phonèmes restent distincts, qu’ils soient proches phonétiquement ou pas, s’ils sont distinctifs, s’ils ont du travail à faire. Des phonèmes fragiles à cet égard peuvent donc perdre leur valeur distinctive soi-disant intrinsèque pour des raisons de proximité articulatoire (par « paresse » articulatoire) si la première articulation les « autorise ».
Ainsi, en français (laissons les Patagons et le bachibouzouks), il n’y a ni plus ni moins de proximité linguistique entre /d/ et /t/ qu’entre /in/ et /un/, mais l’opposition /in/-/un/ ne sert plus à rien, alors elle s’évanouit sans plus de manière. On peut envoyer paitre les redresseurs de prononciation.
Par contre, lorsque des enfants n’entendent plus l’opposition p-b, t-d, c-g, on est en droit de s’affoler. Pas s’il s’agit d’appeler le mé/t-d/cin bien sûr, puisqu’il n’existe pas d’usage courant de « Mède ceint » ; mais pour « douche » et « touche » (ou toute autre contrepèterie qu’il vous plaira d’inventer), il vaut mieux leur éviter les rires.
C’est l’opposition et l’opposition seule qui fait la valeur phonologique. Mais en rapport avec les autres aspects du « système de systèmes ». Martinet explique comment les phonèmes pondèrent la tendance anarchique à mal articuler les mots ; mais réciproquement, c’est le système des mots utiles qui maintient ou non l’intérêt (et donc la vie) des oppositions phonologiques. Ces inter-relations entre les sous-systèmes sont infiniment riches et toujours plus complexes qu’on peut l’imaginer. En témoigne encore (tout se complique) la corrélation entre certains phonèmes et les mots grammaticaux (cf le texte de Jakobson).
Tout ceci a conduit les linguistes à créer la notion d’archiphonème. Nous recopions telle quelle l’explication donnée dans le DLL, parce qu’on y parle d’« ensembles », et ce n’est pas le moment de prendre le risque de convoquer en plus les « maths modernes » dans tous ces propos déstabilisateurs.
« On appelle archiphonème l’ensemble des particularités distinctives communes à deux phonèmes dont l’opposition est neutralisable. Ainsi, en français standard, l’opposition d’ouverture intermédiaire semi-fermé [e] (é) et semi-ouvert [ε] (è) qui fonctionne en syllabe finale ouverte (sans consonne finale) (lait-lé) est neutralisée dans certaines positions […] l’opposition de type normatif [e] vs [ε] (ex. : pécheur – pêcheur) tend […] à disparaître.
Dans les positions de neutralisation d’une opposition, les traits distinctifs sont les traits communs aux deux termes de cette opposition (par exemple : vocalique, palatale, non labialisé, ouverture intermédiaire pour [e] vs [ε]. Ce sont ces traits qui définissent phonologiquement l’archiphonème, représenté graphiquement par la lettre majuscule [E]. l’archiphonème est donc l’intersection des ensembles formés par les traits pertinents de deux phonèmes dont l’opposition est neutralisable. »
Nombre de phonèmes d’une langue.
Il résulte de tout ce qui précède une redoutable incertitude dans les dictionnaires (et donc en pédagogie) sur le nombre précis. Les discussions peuvent être vives et épineuses pour choisir ce nombre.
Une part de raisonnement est subjective, puisqu’il s’agit d’apprécier les cas où les contextes pourront ou non suffire à distinguer les mots dont la prononciation tend à se confondre. Le pauvre Julien Lepers, dans son livre « les fautes de français, plus jamais ! » fournit la méthode pour s’en sortir avec /é/ - /è/ que lui a envoyée une auditrice : «Vous devriez faire un effort parce que ça la fiche mal, explique-t-elle avec un brin de véhémence. Dernièrement, vous parliez du lait de vache et vous prononciez « le lé ». Ce n’est pourtant pas compliqué ! É : la bouche est presque fermée. È : la bouche est plus ouverte, les dents à un centimètre de distance. ». On peut constater cependant, d’après la liste qui suit, que les pauvres ilotes dépourvus de double décimètre ne doivent pas trop craindre le drame des confusions :
céder – s’aider ; chez – chais ; épée – épais ; filé – filet ; foré – forêt ; gué – gai ; j’irai – j’irais ; poignée – poignet ; pré – prêt ; vallée – valet ; plus ce redoutable lé – lait que même la publicité s’emploie à vouloir corriger comme la prononciation du « reblochon ». À part céder-s’aider, peut-être, dans la conjoncture sociale actuelle (il faut céder ou s’aider ?), il n’y a pas de quoi s’affoler.
Soyons pratiques :
Pour ce qui concerne /un/ /in/, la cause semble entendue et, sauf quelques maniaques, personne ne songe à rétablir l’articulation distinctive.
Pour le /t/ de médecin, personne ne conclura, de la neutralisation possible, qu’il y a disparition de l’opposition sourde-sonore pour /t/ et /d/.
Quant à é – è, c’est l’orthographe qui pose problème. Mais la solution, justement, est … orthographique, surtout pas auditive.
Et voilà pourquoi un francophone a un système phonologique ne comportant que 30 phonèmes au maximum, mais qui lui suffit pour "communiquer" et … pour écouter les informations télévisées, c’est la preuve évidente de la médiocre importance des 5 ou 6 autres prévus par la loi. Nous commençons à oser le dire, sans davantage nous abriter derrière les phonèmes de nos voisins. D’ailleurs, les savants linguistes du « [Trésor de la langue française informatisé ]» sont du même avis ; ils n’en proposent même que 29 dans l’« entrée phonétique du trésor » (que nous allons vous recommander) ; dont un petit nouveau, le ng de parking, footing et cie. Nous allons examiner ça de plus près au chapitre suivant.
Les variantes et variations ne sont pas une entrave à la communication orale (passé un temps plus ou moins long d’accommodation à "l’accent" de l’interlocuteur "francophone"); par contre, elles peuvent servir massivement de signifiant à la "distinction" des origines géographiques et sociales.
Jadis l’accent paysan était réputé vulgaire (et comme il n’y avait pas un accent paysan, mais plusieurs, ceux qui s’en moquaient en inventaient un "standard" (c’est-à-dire n’existant nulle part) pour raconter les grosses histoires de péquenot. Aujourd’hui l’accent de banlieue est repéré de même. Cependant, il ne s’agit pas, au sujet de cet accent, de mépris seulement (comme pour les péquenots déracinés du XIXe siècle), mais de peur aussi : c’est l’accent des nouvelles « classes dangereuses » dont on ne sait pas quoi faire ; on ne peut même plus les envoyer à l’usine.
L’accent paysan est donc passé, en 50 ans, du mépris à ce gout nouveau pour les pots en terre cuite et les roues de charrette. L’accent d’HLM, lui, est insupportable. Aussi, les gosses d’HLM (humiliés, désespérés) le renforcent et l’affirment. C’est en effet comme une violence annoncée.
Lectures
Martinet , Jakobson
1 Martinet, éléments de linguistique générale
«
1-10. Forme linéaire et caractère vocal
Toute langue se manifeste donc sous la forme linéaire d’énoncés qui représentent ce qu’on appelle souvent la chaîne parlée. Cette forme linéaire du langage humain dérive en dernière analyse de son caractère vocal : les énoncé vocaux se déroulent nécessairement dans le temps et sont nécessairement perçus par l’ouïe comme une succession. Tout autre est la situation lorsque la communication est de type pictural et perçue par la vue : le peintre peint, certes, successivement les éléments de son tableau, mais le spectateur perçoit le message comme un tout, ou en portant successivement son attention sur les éléments du message selon un ordre ou un autre sans que la valeur du message s’en trouve pour autant affectée. Un système visuel de communication, comme celui que représentent les panneaux de signalisation routière, n’est pas linéaire, mais à deux dimensions. Le caractère linéaire des énoncés explique la successivité des monèmes et des phonèmes. Dans la succession, l’ordre des phonèmes a valeur distinctive tout comme le choix de tel ou tel phonème : le signe mal /mal/ comporte les mêmes phonèmes que le signe lame /lam/ sans se confondre avec lui. La situation est un peu différente en ce qui concerne les unités de première articulation : certes, le chasseur tue le lion signifie autre chose que le lion tue le chasseur, mais il n’est pas rare qu’un signe puisse changer de place dans un énoncé sans modification appréciable du sens : il sera là, mardi et mardi, il sera là ; il est d’autre part assez fréquent que les lexèmes s’annexent des morphèmes qui, en indiquant leur fonction dans l’énoncé, c’est à dire leurs rapports avec les autres signes, leur permettent de figurer dans différentes positions sans affecter réellement le sens de l’ensemble. C’est par exemple, souvent le cas en latin où puerum, dûment caractérisé comme objet par le segment -um, figurera indifféremment avant ou après le verbe : puer-um uidet ou uidet puer-um.
1-11. La double articulation et l’économie du langage
Le type d’organisation que nous venons d’esquisser existe dans toutes les langues décrites jusqu’à ce jour. Il semble s’imposer aux communautés humaines comme le mieux adapté aux besoins et aux ressources de l’homme. Seule l’économie qui résulte des deux articulations permet d’obtenir un outil de communication d’emploi général et capable de transmettre autant d’information à aussi bon compte. Outre l’économie supplémentaire qu’elle représente, la deuxième articulation a l’avantage de rendre la forme du signifiant indépendante de la nature du signifié correspondant et d’assurer ainsi une plus grande stabilité à la forme linguistique. Il est clair, en effet, que dans une langue où, à chaque mot, correspondrait un grognement particulier et inanalysable, rien n’empêcherait les gens de modifier ce grognement dans le sens où il paraîtrait à chacun d’entre eux qu’il est plus descriptif de l’objet désigné. Mais comme il serait impossible de réaliser l’unanimité en ces matières, on aboutirait à une instabilité chronique peu favorable au maintien de la compréhension. L’existence d’une deuxième articulation assure ce maintien en liant le sort de chacun des composants du signifiant, chacune des tranches phoniques /m/, /a/, /l/ de mal par exemple, non point à la nature du signifié correspondant, ici « mal », mais à celui des composants d’autres signifiants de la langue, le /m/ de masse, le /a/ de chat, le /l/ de sale, etc. Ceci ne veut pas dire que le /m/ ou le /l/ de mal ne pourra se modifier au cours des siècles, mais que, s’il change, il ne pourra le faire sans que change, en même temps et dans le même sens, le /m/ de masse ou le /l/ de sale.
»
— André Martinet, éléments de linguistique générale
La deuxième lecture est tout à fait complémentaire ; au cas où vous auriez l’impression, avec Martinet, que les notions deviennent relativement claires. C’est pour vous faire rebondir dans la complexité. Il s’agit de l’aspect phonologique et de l’aspect grammatical du langage dans leur interrelation (rapport au VI congrès international des linguistes, Paris 1948).
Mais vous n’êtes pas obligé d’apprendre, pour essayer de comprendre, le russe, le polonais et le tchèque de Bohème (les linguistes sont payés pour ça ; correctement, on l’espère). Vous lisez juste ce qu’il faut pour comprendre … que tout ceci n’est pas facile à comprendre et que la linguistique est une science.
Entre parenthèse, nous signalons, au cas où ça vous aurait échappé, les titres de ces deux ouvrages de référence : « éléments de linguistique générale » et « essais de linguistique générale ». Ces savants, en plus, sont modestes. Ah ! si les réformateurs des programmes scolaires pouvaient l’être un peu plus !
2 Jakobson, Essais de linguistique générale
«
(dans) notre enquête portant sur les phonèmes d’une langue, nous essayons de dessiner le réseau des combinaisons de ces phonèmes qui se trouvent effectivement réalisées, nous sommes obligés de faire entrer en ligne de compte les catégories grammaticales : en effet, les combinaisons de phonèmes sont différentes au début, à l’intérieur, ou à la fin du mot. Les combinaisons à la joncture de deux unités formelles, par exemple à la joncture d’un préfixe ou d’un suffixe et des parties adjacentes du mot, diffèrent des combinaisons internes ; de même, selon qu’il s’agit de préfixes ou de suffixes, les lois de combinaison aux jonctures peuvent varier (par exemple, le russe n’admet l’hiatus qu’à la joncture d’un radical avec un préfixe ou avec un autre radical -tout mot avec un radical non-initial est conçu comme un composé). Des unités formelles différentes du point de vue fonctionnel sont souvent signalées par des configurations phonématiques différentes (dans les langues slaves, par exemple, le contour phonématique distingue clairement les suffixes des radicaux). Il peut se faire que les radicaux de parties du discours différentes (par exemple ceux des noms et des verbes, ou des noms et des pronoms) se différencient par la longueur et la composition de la chaine des phonèmes. En gilyak, des combinaisons de phonèmes, usuelles dans les noms propres, en particulier les noms personnels, n’apparaissent jamais dans les mots ordinaires. Ils se révèle donc que l’inventaire brut des phonèmes est une fiction, car chaque classe d’unités grammaticales, et chaque position à l’intérieur de ces unités, présente son propre tableau de combinaisons phonématiques.
Mais ce que nous disons des combinaison peut dans une certaine mesure s’appliquer aux phonèmes pris séparément, et, en dernière analyse, aux traits distinctifs eux-mêmes. Les phonèmes et les traits distinctifs ne sont pas distribués indifféremment tout au long d’un mot (ou d’une unité formelle plus petite). À côté de leur fonction distinctive, ils peuvent remplir un rôle supplémentaire, celui de signes démarcatifs. La présence d’un certain phonème (ou d’un certain trait distinctif) à une certaine place d’un segment de discours signale la présence d’une limite entre des mots (ou entre des unités formelles plus petites) ou, au contraire, l’absence d’une telle limite. De tels « signes démarcatifs négatifs » (comme les appelle Troubetzkoy) sont très fréquents et importants.
En tchèque de Bohème, l’opposition entre consonnes voisées et non-voisées n’est possible qu’à l’intérieur du mot, et seulement quand une voyelle, une liquide, une nasale ou un /v/ suit. Si j’entends une consonne voisée suivie d’une voyelle, d’une liquide, d’une nasale ou d’un /v/, je sais que cette consonne voisée n’est pas une finale. Bref, il s’agit d’un signe démarcatif négatif.
Si un suffixe commence par une nasale (ou par une voyelle, une liquide ou un /v/), la voisée finale du radical conserve son voisement : lid-mi, křiž-mo. Mais, à l’mpératif, la consonne voisée finale de la racine devient non-voisée dans cette position : hol’-me (de hod’it), leš-me (de ležet). Les verbes tužit et tušit ont la même forme à l’impératif : tuš-me. L’abolition de l’opposition « voisées/non-voisées » devant la désinence de l’impératif indique que, en tchèque (de même qu’en russe et en polonais), les désinences de l’impératif ne sont pas des suffixes mais des particules enclitiques autonomes devant lesquelles jouent les lois de la finale de mot. D’autre part, la consonne finale des prépositions obéit à ce point de vue aux lois de l’intérieur du mot, la seule différence étant que, à 1’intérieur d’un mot, une non-voisée suivie d’une vibrante chuintante prive cette dernière de son voisement habituel (křeči > kreči) tandis qu’à la finale d’une préposition (de même qu’à la finale de tout mot autonome), une non voisée suivie d’une vibrante chuintante devient voisée (k řeči > g řeči « envers le discours »), C’est ainsi que la diversité des lois de sandhi indique la gradation des syntagmes (au sens saussurien du terme) d’après leur degré de coalescence (cf. par exemple, en français, les groupes de mots où la liaison est obligatoire, ceux où elle est facultative, et ceux où elle est interdite).
Il est possible de caractériser les différentes classes grammaticales d’unités formelles par des listes différentes de phonèmes où même de traits distinctifs. Par exemple, sur les vingt-trois consonnes du tchèque parlé, huit seulement se retrouvent dans les suffixes flexionnels. Trois d’entre elles apparaissent dans les désinences nominales et six dans les verbales ; /m/ est la seule consonne qui se rencontre dans les deux classes à la fois.
( …)
Toute étude d’un système pholonogique qui se veut compréhensive, se heurte inévitablement au problème des systèmes partiels utilisés pour différencier et spécifier les diverses catégories grammaticales de la langue en question. La limite entre la phonologie proprement dite et ce qu’on appelle la mor(pho)phonologie est plus que labile, on glisse de 1’une à l’autre imperceptiblement.
( …)
Par conséquent, le problème de la différenciation phonologique des diverses couches grammaticales nous amène à envisager à la fois l’aspect synchronique et l’aspect diachronique. Les structures phonologiques et grammaticales se rajustent mutuellement l’une à l’autre. L’autonomie interne relative de chaque système n’exclut pas une interaction et une interdépendance continuelles. Comme nous l’avons déjà dit, la restructuration du système phonologique peut fournir au système grammatical des stimuli que celui-ci adoptera ou rejettera. Inversement, les processus grammaticaux provoquent parfois avec succès des innovations dans le système phonologique, et servent même à engendrer de nouveaux phonèmes.
»
— Jakobson, Essais de linguistique générale - pp. 166-175
Oups ! … l’écriture
[modifier | modifier le wikicode]
Que vois-je ?…
Car vous n’avez encore rien vu
OÙ tout se complique, OU devient très simple (mais d’un autre point de vue)
« Oups » Exclamation à la mode, de l’anglais « oops » … comme foot, footing, look, cool, coolie, cookie, scooter, scoop, looping, … tous dans le dictionnaire. Mais qui diable a décidé de franciser ce « oups »-là … et pas les autres ?
Poursuivons donc joyeusement, sans ironiser davantage sur les anglicismes, à propos des choix que « l’Usage » est supposé faire avec pertinence pour écrire les mots.
L’orthographe française est belle et parfaite, comme chacun sait. Regardons de près pour nous réjouir.
Voici, en bon français basique, une pub sur nos murs :
« un pastis, oui
un pastiche, non »
Il y a dedans tout ce qu’il faut pour comprendre ce qu’est un phonème ; et aussi ce qui parasite la compréhension de la notion quand on est déjà un peu lecteur.
Constatons d’abord que le début des deux mots est le même, tant pour l’oreille que pour les yeux : pastis, pastiche. Un son => une lettre, on est dans l’idéal du b, a, ba.
La fin diffère : s et che . Une lettre et trois lettres, ce qui produit forcément un effet visuel. À l’oral pourtant, c’est un seul son-phonème s’opposant à un seul autre son-phonème. Ch représente, en « écriture normale », un son-phonème qu’on retrouve dans chapeau et, en fin de mot comme pour pastiche, dans le mot tache qui s’oppose à tasse (avec deux s pour la raison orthographique qu’on connait bien). Le e ne compte pas pour un son supplémentaire qui serait à l’oral indispensable à la compréhension. Dans le midi, on fait éventuellement sonner ce e et on articule une syllabe de plus. Mais le [ pastis ] et le [ pasti - se ], c’est exactement le même liquide, même quand une marque est le « pastich’ » (ou le « pasti-che ») d’une autre. Quand quelqu’un me propose un « pasti-se », éventuellement un « pa-se-ti-se », je suis seulement informé de l’origine géographique du généreux donateur, ce qui est certes une précieuse information, mais ne change rien au produit. L’articulation finale de pastis et pastiche n’est pas pertinente pour savoir ce qu’on m’offre.
Abritons-nous tout de suite derrière des arguments d’autorité pour qu’on respecte le petit amateur de linguistique dans ses affirmations, et surtout l’ex-instituteur qui a commencé à se préoccuper de ces histoires quand il s’est aperçu que les gosses, surtout ceux « en difficulté », renâclaient à se couler dans certaines affirmations « méthodiques » du genre « pa pa fu me la pi pe »
- Petit Robert (qui donne la prononciation de tous ses mots en API) indique : pastis [pastis] et pastiche [pasti∫] (∫ est le signe de l’alphabet phonétique représentant le son « ch, ch, ch » de la locomotive à vapeur).
- Mais nous avons désormais mieux encore pour comprendre : l’utilisation de l’entrée phonétique du Trésor de la Langue Française informatisé . Allez-y voir. (il faut cliquer sur Entrer dans le TLFi , puis 3) Faites une saisie phonétique.) Exercez-vous, surprenez-vous. Osez vis à vis de vous-même, honnêtement, le doute méthodique pour savoir si votre pratique du langage correspond aux « visions » orthographiques des mots que vous avez incorporées. Il s’agit de vous mettre à la place de quelqu’un qui ne connait vraiment pas l’orthographe, mais s’applique à s’alphabétiser par la méthode syllabique. Si ce quelqu’un sur le chantier désire une « pizza », comment croyez-vous qu’il l’écrira sur la feuille qui circule ? S’il y mettait un d ce serait juste normal. Entrer dans le TLFi !
Avec ce système de transcription de l’oral à l’écrit, « la parole légitime», comme dit Bourdieu, risque elle-même une forte contestation ; mais c’est son problème, profitons-en. Si on lui demande P-A-S-T-I-CH-E, on n’obtient rien. Il faut supprimer le E final pour que le mot « pastiche » arrive. Par contre, si on demande P-T-I aussi bien que P-E-T-I, « petit » se présente avec tous ses « trésors ». C’est pas juste ! C’est le Nord qui domine la norme de prononciation ; le Tlf accepte en effet les deux façons d’articuler « petit » parce que les Nordistes font ainsi, selon les phrases (le Petit Robert met le son e de petit entre parenthèse dans sa description phonétique, ce qui revient au même.)
C’est politiquement juste ou pas, en tout cas c’est exact pour ce qui concerne le sens. D’autres sons par contre produiront des changements de sens radicaux, et ceux-là, il n’est pas question de les mettre entre parenthèses. Il n’est pas question de laisser tomber les deux phonèmes /s/ et /∫/. Les zozoteurs font rire, et même énervent quand ils provoquent des confusions. Profitons de ces confusions parfois entendues pour réviser ce qui a été traité précédemment. Procédons aux manipulations, aux changements « distinctifs » :
| salut > chalut | tâcher > tasser | mousseron > moucheron | enchâsser > ensacher | . |
On peut jouer avec d’autres sons. Attaquons le a de tasser > tisser > tousser ; le t de tousser > mousser ; le s de mousser pour réintroduire le ch > moucher ; m > b : boucher. Changeons deux sons à la fois b > c , ch > p : couper …
On peut jouer à ça autant qu’on veut (vous connaissez le jeu ; c’est juste une révision, une répétition pour inscrire cette science dans votre mémoire … et transmettre aux voisins).
Le changement radical de sens à partir d’un petit mais décisif changement de son, pas n’importe lequel, un son décisif à cet égard dans une langue donnée, c’est ça précisément le travail des phonèmes ; et vous avez bien compris qu’on leur a donné un nom particulier et qu’on ne les appelle pas simplement « son » à cause de ce travail-là. Ce n’est pas par snobisme.
Et ce dont il faut maintenant achever de bien prendre conscience (sans davantage réciter les pages de Martinet recommandées avant), c’est que ces sons caractéristiques, tellement efficaces, sont en nombre incroyablement réduit. Revenons au Tlf (Trésor de la langue française) qui en compte 29 et examinons en détail. Il y a des omissions surprenantes au regard de la norme scolaire : un seul é (représentant indifféremment é, è et ê ) ; un seul in (alors que les dictionnaire distinguent encore phonétiquement un et in) ; un seul a (plus de â distinguant patte de pâte) ; un seul o pour le o ouvert et le o fermé (mais la différence côté orthographique étant inextricable, tout le monde s’en fout) … On a par contre un NG qui n’a rien à voir avec notre brave gn. Ici, c’est le ng de parking (un phonème anglais récemment adopté, parait-il, quoique beaucoup francisent en n-g). Mais gn , où est-il ? Il n’existe plus, ne cherchez plus ; il a disparu au profit d’une prononciation en deux sons N + Y. Pour cherchez oignon, il faut écrire O-N-Y-ON.
Profitons de oignon pour revenir à nos moutons. L’orthographe de oignon a été réformée en 90, car certainement plus personne ne disait oi comme dans oiseau (Tlf WAZO) ; les réformateurs et l’Académie avaient donc proposé ognon. Mais pas encore onion. En retard d’une guerre quand tout le monde ou presque prononce ainsi, comme pour les « Minions » du fameux dessin animé. On peut sans doute en discuter encore. Le Tlf en tout cas a franchi le Rubicon ; ceci, évidemment, pour faciliter l’utilisation de l’entrée phonétique de son site.
un job d’enfer
une boss infernale
On peut revenir alors à l’écriture, et considérer que pastiche et pastis, par contre, pour l’œil, c’est assez différent. (Et on ne donnera par conséquent pas cher de cette pub d’affiche qui joue sur l’oral, mais qui visuellement est ailleurs.) En fin de mot, ici, il se passe un tas de choses auxquelles on est forcément sensible inconsciemment (quand on est pratiquant aguerri de l’écriture). Pour comprendre comment s’opère dans le cerveau la reconnaissance des mots (et de leur orthographe) il faut s’intéresser à une multitude de micro-sytèmes.
Voyons justement ces fins de mots en [ i∫] , ich(e).
Dans le dictionnaire de rimes Le Robert, nous trouvons 84 iche contre une petite douzaine de ich , et quels !
haschich, bakchich, stockfisch, flysch, naturlich, Boul’Mich, sandwich, frisch, Marlène Dietrich, Mastricht, Irtych. Plus des sh : kaddish, yiddish, karkemish, finish, kish, scottish.
On voit le caractère souvent exotique de l’écriture sans e.
Ensuite le fameux e du féminin. Très capricieux pour les noms : une fleur, du beurre. Ce qui fait que les adversaires de la féminisation des noms de métier ne jugent pas judicieux que l’on écrive « une professeure ». Ce e « du féminin » peut en effet réserver de mauvaises surprises. Par exemple un boss exigerait son homologue féminin … une bosse ?
D’une façon générale, pour justifier l’existence ou non d’un e en fin de mot, on peut formuler cette règle … totalement inefficace pour apprendre l’orthographe : quand il y a un e alors (=>, mathématique si … alors) on prononce la consonne qui se trouve avant ; s’il n’y a pas de e alors … ça dépend. Des fois oui, des fois non. Pour expliquer la prononciation et l’écriture ou non des consonnes finales, Henriette Walter a écrit tout un chapitre de son livre « Le français dans tous les sens » (cf lecture). On y voit l’intervention délibérée des lettrés sur le bon usage oral. Et après, les cuistres font des discours sur le « génie de la langue » ! Mais au final, personne ne sait plus ce qu’on doit dire ou ne pas dire, écrire ou ne pas écrire, car ce qui est réputé distingué à une époque ne l’est plus à l’époque suivante. L’écriture, elle, ne peut pas suivre la « valse ». Et les gens, les simples gens, ne savent plus où ils en sont. Un vrai pastis (de l’occitan provençal pastís: « pâté » ou « mélange »)!
L’écriture, par définition, est là pour durer, « les paroles s’envolent, les écrits restent ». En outre, on peut les « tenir à l’œil ». Il y a toutes sortes de raisons valables ou inavouables pour maintenir une orthographe compliquée et intangible. Mais a-t-on le droit, en république, de l’expliquer aux gens ?
Voici en tout cas ce que nous expliquions un jour à de jeunes amis rappeurs à propos d’une faute dans un texte que l’un d’eux nous avait donné à dactylographier dans un échange de savoirs (orthographe contre « langue des cités ») :
« Les fautes sont souvent intelligentes.
« Dans ce texte de rap, on trouve écrit, à quelques lignes d’intervalle : pognion et opignion. La citation ci-dessous d’une linguiste (une savante dans la connaissance du fonctionnement du langage) prouve que ses oreilles n’ont pas trompé celui qui a écrit ces mots et qu’il a très bien analysé les mots pognon et opinion. À la fin, on entend rigoureusement la même chose [nion] (et pas seulement dans les « quartiers »). Alors pourquoi, en effet, ne pas écrire pognon comme opinion ? Ici le rappeur a réglé élégamment le problème en faisant plaisir à tout le monde : gnion
Ceci pour dire qu’il y a deux erreurs orthographiques, incontestablement, le dictionnaire le dit. Mais pas d’erreur contre l’intelligence : la linguiste le confirme »
Citation de la linguiste :
«
la nasale palatale, que certains prononcent encore dans brugnon, dans accompagné ou à la finale de trogne, se confond de plus en plus avec la succession –ni- que l’on trouve dans niais, union ou panier. C’est pourquoi cette nasale palatale ne figure pas dans le tableau de 18 consonnes de base du français
»
— Henriette Walter, « Le français dans tous les sens » — p. 243
Voilà. C’est pas facile, l’orthographe. Ni celle des mots, qu’on appelait « l’orthographe d’usage » quand les gens instruits acceptaient l’idée qu’elle pouvait être un tantinet capricieuse ; ni celle, grammaticale, que les mêmes adoraient, parce qu’ils étaient convaincus qu’elle reflétait la puissance logique des cerveaux, dont le leur bien sûr. On ne sait plus trop, tant de déconvenues ont abattu l’orgueil des cerveaux humains. Mais après avoir surtout observé, dans ce chapitre, ce qui relève du visuel lexical, tel ou tel mot isolé saisi par le regard du lecteur-promeneur pressé, il faudra aussi, profondément, étudier l’arbitraire grammatical dont nombre des signes n’exigent même pas de savoir s’ils doivent ou non être prononcés, excepté dans les liaisons.
Pourrait-on simplifier? Certains en ont beaucoup rêvé. Nous allons commencer dès ce chapitre à nous en préoccuper (cf lexique). Mais, comme d’hab’, n’espérez pas de miracle.
Pour l’instant, il faut obéir aux maitres, jadis nommés « instituteurs » parce qu’ils « instituaient » l’ordre et la loi avec le savoir nécessaire. Noble tâche ! Exige-t-elle que l’on mente sur les tenants et aboutissants des méthodes et des contenus.
Lexique
Allez, encore un petit coup d’arbitraire, mais dans son sens disciplinaire. À cause de l’écriture, justement.
l’arbitraire-arbitraire
Au sens linguistique (cf ch 3 et ch 4), et quand il s’agit de la langue orale, l’arbitraire est soumis aux lois du langage. Le choix d’une forme plutôt que d’une autre est contrôlé notamment par l’exigence de contraste pour éviter les confusions dans la conversation ; mais à l’écrit, si l’orthographe est vraiment un outil parfait pour la communication, les différences rajoutées sur l’oral doivent efficacement distinguer les idées exprimées … en fonction des probabilités que la confusion puisse réellement se produire. La controverse à ce sujet sera évidemment interminable.
Ex d’un quiz des mois d’été 2012 dans Science et avenir : « je [ ] prie, ne [ ] pas [ ] le cou, un [ ] pourrait te piquer par ce [ ] orageux. »
La langue orale semble assez bien rodée pour éviter les confusions dramatiques. Mais à l’écrit le risque est-il à ce point plus grand ? En tout cas, dans l’écriture, ce n’est pas seulement l’immanence des formes optimales que l’on observe, mais également l’intervention constante des érudits. Nous ne dirons pas que tout dépend de leurs caprices, mais des caprices, il y en a, c’est certain ; comme le prouvent les lectures qui suivront.
Réforme et/ou rationalisation de l’orthographe
Depuis qu’elle existe, on n’arrête pas d’en parler et d’y travailler. Et presque rien ne bouge.
Les confrontations savantes sont indispensables pour faire avancer la science et essayer d’en tirer des applications pratiques. Celles-ci peuvent être risquées, mais le risque que rien ne bouge n’est pas meilleur pour la santé.
Ainsi, nous vous recommanderons, à la fin de l’ouvrage, pour être des citoyens responsables, d’adhérer à l’association erofa qui s’obstine, dans un silence sépulcral, à vouloir poursuivre la quête d’une orthographe française simplifiée. « Sépulcral », le mot n’est pas trop fort puisque, dans les dictionnaires, la petite réforme de 90 s’installe et que plus personne n’y trouve à redire. Donc, elle a triomphé … Mais pas du tout ! Les raisons scientifiques et idéologiques qui avaient conduit ses auteurs et des citoyens importants chargés de responsabilités d’État à la défendre ont disparu dans le trou noir de l’indifférence générale, c’est à dire de l’obscurantisme, le même qui faisait se lever les boucliers en 90. En d’autres termes, la réforme de 90 est acceptée parce qu’elle n’est plus dangereuse politiquement. Et de ce fait, elle est bien morte puisqu’elle ne sert plus à la réflexion ; c’était son but essentiel.
Que peut Érofa, l’association qui poursuit l’idée et s’obstine à survivre ? Cette association courageuse prend des risques, surtout les savants qui y militent et qui savent qu’ils seront jugés par leurs pairs ; il ne faut pas croire que le monde des savants est celui des Bisounours.
Ainsi sur l’accord du participe passé. L’accord du pp terrifie tout le monde ; la courbe de réalisation individuelle des accords parfaits est asymptotique ; les plus experts (même les plus convaincus de l’excellence de ces règles biscornues) tremblent devant les subtilités extrêmes.
L’association (après plusieurs autres études, sur s et x et sur les consonnes doubles) a osé attaquer le dossier de la simplification de l’accord du pp ( très vieille histoire, Clément Marot l’avait même mise en vers - voir lecture). Si les conclusions de l’Érofa étaient connues, ce serait un coup de tonnerre dans le ciel serein du cimetière.
Conclusions résumées :
le pp conjugué avec avoir ne s’accorde avec rien,
le pp conjugué avec être s’accorde toujours avec le sujet.
Hors le cercle des cuistres, cette solution finale magique aurait sans aucun doute toutes les chances d’être plébiscitée.
Alléluia ! On va forcer le silence et on va plébisciter.
Du calme ! il faut avouer quelques petites difficultés « sémantiques » résiduelles. Ex :« X est tombé et s’est cassé la jambe ». Le résultat de l’histoire est une jambe cassée, un objet parfaitement défini et identifiable auquel on mettra une attelle (on ne procédera pas à l’emballage total de la personne concernée pour éviter une rupture de la moelle épinière). Par conséquent, si on ne met pas un e à cassé, c’est parce que « jambe est placé après » ; on applique ici, par un tour de passe-passe « transformationnel » qui remplace être par avoir, les vieilles règles tarabiscotées (« X a cassé la jambe de lui-même ; il ''l’''a cassé''e ''; il se ''l''’est cassé''e''»). Mais si on décide de mettre un e parce que X est une fille, il faut complètement oublier que le participe passé était réputé avoir un rôle adjectival : désormais, on devra seulement appliquer une nouvelle règle d’accord du verbe avec le sujet. Pourquoi pas. Une petite règle de conjugaison de plus, des tonnes d’emmerdements en moins.
Ces petites difficultés « sémantiques » rencontrées ne sont rien à côté des arguties dont les cuistres se pourléchaient les babines depuis des siècles et qui d’ailleurs, à l’oral, s’étaient sérieusement émoussées depuis que le passé composé tendait de plus en plus à se solidifier pour devenir un temps comme les autres. Cette tendance-là, il y a longtemps d’ailleurs, très longtemps qu’elle était à l’œuvre (lisez attentivement sur Wikipédia l’article sur « Clément Marot et le participe passé ». On y constate que « l’usage » concernant l’écriture est très dépendant des décisions humaines explicites des dominants). Le destin adjectival du pp devient souvent anecdotique, voire franchement incongru. « Le Président de la république a remonté l’avenue des Champs-Elysées. Il l’a remontée sous les applaudissements de la foule.» Voici une « avenue remontée » dont la qualification est assez cocasse. Mais …
Mais sur l’étiquette de cette marque d’huile « extraite à froid », la propriété essentielle est, elle, évidemment soulignée par l’action.
Mais la « jambe cassée » introduite par être est-elle récupérable si X (le sujet) s’appelle Gontran ? …
Mais, mais … le jeu en vaut-il la chandelle de résister à la simplification radicale à cause de ces nuances et ambigüités, au regard de l’immensité de l’économie offerte.
OK, OK ; finissons-en avec ces querelles byzantines … Quand est-ce qu’on vote ?
Toutefois, toutefois, il faut prendre quand même conscience du redoutable choix théorique bien plus fondamental qui, en amont, décide de cette règle proposée ô combien pratique. Voici ce qu’écrit Érofa : « La syntaxe est première et, lorsqu’il y a conflit entre la syntaxe et la sémantique, la sémantique doit céder le pas à la syntaxe. »( p 15 de son fascicule sur l’accord du pp). Dans la confrontation des théories, dont vous pourrez vous approcher dès le prochain chapitre, vous verrez que la formule ne coule pas de source. Elle peut avoir ailleurs des conséquences dangereuses. C’est comme l’énergie atomique : tranquille en France depuis 50 ans, mais évitons Tchernobyl et Fukushima.
Donc, plébiscitez la simplification radicale de l’accord du pp (qui d’ailleurs, avec être pourrait encore évoluer dans l’usage oral ; dressez l’oreille), mais restez vigilant sur les risques que présente la justification théorique. C’est à dire les mauvais usages que les cuistres malveillants et opportunistes, grands amateurs de dressage, pourraient faire d’une dictature de la syntaxe. Pour ce qui nous concerne, nous en restons à Jakobson : la syntaxe est une sémantique obligée. Et c’est l’Usage en effet qui l’installe et la contrôle dans la pratique réelle des innombrables paroles qui s’échangent entre les êtres parlants. Mais l’écriture, c’est autre chose : depuis l’origine, c’est l’expression du pouvoir des pharaons. Le veau d’or est peut-être plus urgent à détrôner, mais, comme on n’envisage plus la révolution, on ne peut que souhaiter et défendre une longue démocratie des réflexions communes et des palabres non censurés. Alors ? … Alors la linguistique est nécessairement un « sport de combat ».
Lectures
Henriette Walter, La valse hésitation des consonnes finales,
« Le français dans tous les sens » le Livre de poche pp. 96,97,98
«
Évolution naturelle et évolution dirigée
Après le XVIe siècle, il est difficile de retrouver les tendances naturelles de la langue à partir de ses manifestations, car les grammairiens interviennent sans cesse pour l’unifier et la fixer.
À partir du XVIIe siècle, il faudra donc toujours faire la part des interventions venues « d’en haut », qui freinent, canalisent ou contrarient les évolutions linguistiques résultant des nouveaux besoins communicatifs.
Les pages suivantes décrivent les tendances qui se manifestent au cours du XVIe siècle sur le plan deIa prononciation, de la grammaire et du vocabulaire, juste avant que les amoureux du « bon usage » ne brouillent les pistes en agissant en sens inverse.
La valse-hésitation des consonnes finales
C’est sans effort et sans même y penser que nous prononçons tous aujourd’hui mer ou enfer en faisant sonner le r, mais nous ne le faisons pas pour aimer ou chauffer, prononcés comme aimé ou chauffé. Pourquoi?
S’agirait-il d’une règle particulière aux infinitifs? Non, puisque nous disons mourir et pouvoir, en prononçant le rfinal. D’autre part, nous disons tous cahier, fusil, tabac ou bonnet sans prononcer non plus la consonne finale, mais nous la prononçons dans hier, péril, sacou net. Dans tous ces cas, l’usage oral est aujourd’hui parfaitement fixé et ne tient pas compte de l’orthographe, qui comporte dans tous ces cas une consonne finale.
Pour d’autres mots, l’usage est moins bien établi, et la consonne finale est prononcée par certains et supprimée par d’autres :
Almanach, chenil, nombril, persil, sourcil, suspect, ananas, circonspect, août, exact, but, fait (un), cerf, gril
Comment déterminer le bon usage? .
Une enquête récente sur la prononciation d’un groupe de personnes de tous âges, de résidence parisienne et très scolarisées, montre que, pour ces mots, les usages sont partagés : ce sont les mots les moins fréquents (comme chenilou cerf) qui sont prononcés en majorité avec la consonne finale, tandis que, pour les plus fréquents (comme persil ou sourcil), c’est la prononciation sans consonne finale qui l’emporte.
Telle est l’image de la réalité d’aujourd’hui, qui montre que l’usage n’est pas complètement établi sur ce point.
Le désordre de nos liaisons
Pour comprendre la situation anarchique actuelle, il faut remonter à la fin du XIIe siècle, époque à partir de laquelle toute consonne finale de mot :
- se prononce uniquement quand le mot suivant commence par une voyelle;
- ne se prononce pas, quand le mot suivant commence par une consonne.
Exemple: petit-t-enfant mais peti garçon.
Nous reconnaissons là les débuts de ce que nous appelons la liaison, qui, pendant des siècles, ne connaissait pas d’exception. Telle était la règle au XVIe siècle : aucune consonne finale ne se prononçait à moins d’être suivie par une voyelle. (Cf encadré)
Consonne finale prononcée ou non?
De nos jours, seules les consonnes finales de certains mots sont soumises aux règles de la liaison. En effet, des mots comme bac, péril, bonheur ou nef ne sont jamais soumis aux phénomènes de liaison : leur consonne finale se prononce toujours. Mais des mots comme trop, heureux, tout, petit (ainsi que beaucoup d’autres), qui se terminent également par une consonne écrite, sont prononcés comme dans l’ancienne langue, c’est-à-dire sans consonne finale, sauf en liaison, lorsque le mot suivant commence par une voyelle : j’en ai tro, tro grand mais trop-p-étroit ; père heureu, heureu père mais heureu-z-événement, ,etc. De plus, cette liaison devant voyelle n’est pas constante.
Comment a-t-on pu passer de la régularité décrite par les grammairiens du XVIe siècle, lorsque tous les mots subissaient le même traitement, à l’arbitraire de la prononciation actuelle, qui défie l’orthographe et déroute les étrangers qui veulent apprendre le français?
Le point de rupture se situe vers le milieu du XVIe siècle : on constate alors que les consonnes finales sont progressivement réintroduites dans la prononciation, en partie sous l’ action des grammairiens. Toutefois, leurs avis ne vont pas toujours dans le même sens et chaque mot a finalement son histoire particulière. Nous savons, par exemple, que les puristes du XVIIe recommandaient de dire mouchoi pour mouchoir, et que Vaugelas préconisait de dire couri et non pas courir. De même, on considérait alors i faut comme la bonne prononciation et il faut comme pédant et provincial. À l’inverse, au XVIII siècle, certains grammairiens stigmatisaient la prononciation tiroi(pour tiroir), qu’ils trouvaient vulgaire.
Plus près de nous, nous savons que, jusqu’au début du XIXe siècle, péril s’est prononcé péri et qu’au milieu du XXe siècle on hésitait entre bariet baril. En 1987, la forme bari (sans l prononcé) n’a pas complètement disparu des usages, puisqu’elle a été employée par le journaliste Jean Amadou au cours d’une émission de télévision.
LES LIAISONS AU XVIe SIÈCLE
Les grammairiens du XVIe siècle nous donnent des règles très précises pour l’emploi des liaisons.
Sylvius (Jacques Dubois) écrit en 1531 : « À la fin du mot nous écrivons mais nous ne prononçons pas l’s ou les autres consonnes, excepté lorsqu’elles sont suivies d’une voyelle, ou placées à la fin d’une phrase, ainsi nous écrivons les femmes sont bonnes mais nous prononçons les avec un son élidé, femme sans s, son sans t, bones. » Un autre grammairien, Henri Estienne, en donne en 1582 une représentation quasi phonétique:
… que nou ne vivon depui troi mois en cete ville.
Remarquons que dans cette fin de phrase, seul le mot mois est graphié avec la consonne finale s, qui se prononce, puisque ce mot se trouve devant un mot commençant par une voyelle, ce qui n’est pas le cas de nou, vivon, depui et troi.
»
— Henriette Walter, La valse hésitation des consonnes finales, « Le français dans tous les sens » le Livre de poche pp. 96,97,98
Clément Marot et le fameux participe passé
«
C’est au XVIe siècle qu’apparaît la règle de l’accord du participe passé avec avoir. Nous la devons à Clément Marot (1496-1544). Ce dernier l’avait empruntée à un professeur italien qui, enseignant le français à des Italiens, essayait de trouver un système sous-jacent au fonctionnement du participe passé. Marot a formulé ainsi la règle du participe passé avec avoir
Nostre langue a ceste façon
Que le terme qui va devant
Voluntiers regist le suyvant.
Les vieux exemples je suyvray
Pour le mieulx: car, à dire vray;
La chanson fut bien ordonnée
Qui dit m’amour* vous ay donnée.
Et du bateau est estonné
Qui dit: M’amour vous ay donné.
Voilà la forceque possède
Le femenin quand il precede.
Or prouvray par bons temoings
Que tous pluriels n’en font pas moins:Dieu en ce monde nous a faictz;
Faut dire en termes parfaictz:
Dieu en ce monde nous a faictz;
Faut dire en parolles parfaictes:
Dieu en ce monde les a faictes;
Et ne fault point dire en effect:
Dieu en ce monde les a faict.
Ne nous a fait pareillement,
Mais nous a faictz tout rondement.
L’italien, dont la faconde
Passe les vulgaires du monde,
Son langage a sinsi basty
En disant: Dio noi a fatti.En graphie moderne, on aurait eu :
Notre langue a cette façon
Que le terme qui va devant
Volontiers régit le suivant.
Les vieux exemples je suivrai
Pour le mieux: car, à dire vrai;
La chanson fut bien ordonnée
Qui dit: «M’amour vous ai donnée».
Et du bateau est étonné
Qui dit: «M’amour vous ai donné».
Voilà la force que possède
Le féminin quand il précède.
Or prouverai par bons témoins
Que tous pluriels n’en font pas moins:Dieu en ce monde nous a faits;
Faut dire en termes parfaits:
«Dieu en ce monde nous a faits»;
Faut dire en paroles parfaites:
«Dieu en ce monde les a faites»;
Et ne faut point dire en effet:
«Dieu en ce monde les a fait».
Ni «nous a fait» pareillement,
Mais «nous a faits» tout rondement.
L’italien, dont la faconde
Passe les vulgaires du monde,
Son langage a ainsi bâti
En disant: Dio ci à fatti.C’est cette règle (le mot amour était féminin), fondée sur l’opposition entre le participe passé avec être et le participe passé avec avoir, que nous observons aujourd’hui. À l’époque de Clément Marot, elle n’aurait connu qu’un succès relatif: les écrivains suivaient plus ou moins cette nouvelle règle. On pouvait écrire «la lettre qu’il a écrite», aussi bien que «il a une lettre écrite» ou «il a écrite une lettre». À long terme cependant, il parut plus commode d’avoir une règle afin que le français soit plus comparable au latin. Les imprimeurs apprirent par cœur les célèbres vers de Marot, sans savoir que, pendant des siècles, cette fameuse règle fera la vie dure aux écoliers! Dans son Histoire de la langue française, le grammairien Fernand Brunot précise que, au XVIIe siècle, la prononciation pouvait jusqu’à un certain point justifier la règle de Marot. Ainsi, le «e» final, par exemple, de «rendue» ou de «chantée» s’entendait grâce à l’allongement de la voyelle finale, mais uniquement avant une pause. Bref, le participe passé terminé par les voyelles -i, -u et -é était souvent marqué par un allongement à l’oral, mais il n’y avait rien de rigide. D’autres reprendront la règle de Marot, dont Vaugelas et Malherbe qui l’étendra aux verbes pronominaux, mais ce n’est qu’au XIXe siècle que les règles du participe passé seront imposées dans les écoles de France, de Belgique, des cantons suisses romands et du Canada français.
»
— Histoire de la langue française par Jacques Leclerc. Université Laval du Québec. [Histoire du français, La Renaissance, L’affirmation du français]
Et si vous trouvez que c’est un peu trop succinct, vous pouvez approfondir grâce à wikipédia : Accord du participe passé en français à la Renaissance
orthographe au bon lait de brebis
«
La fourmil de 18 mètres
A mis une plume à son chapeau
C’est pas beau, a dit le maitre
Tu copieras dix fois le mot
Fourmimi, fourmilion
À l’école, que t’apprend-on?Elle a dû manger son chapeau
Elle est rentrée dans son studio
Elle a fermé la porte à clé
Elle s’est vautrée dans le canapé
Elle a allumé sa télé
Fourmimi, fourmilière
lombago et UrticaireDans son logi
0 le doux ni
L’ennui lui gratte le nombri.
La télé distille sans répi la lost-stori d’un yuppi insoumi, yanki post-hippi impi, géni mercanti proscri décati au whiski, qui fait pleurer dans les chaumières.
Elle, prépare le rôti,
l’hachi de ri de veau au ri curri sauce muscadet sur li de salsifi et cèleri,
et un clafouti ;
En grignotant un p’ti radi sur un blini, quel appéti! Pourquoi s’en faire?
Soudain,
Un brui à l’hui !
D’abord un gazouilli, un chuchoti ;
Pui un charivari, une hystéri, un défi pour le gourbi en torchi.
Ce sont le colibri, le cabri, la brebi, le canari, la perdri, la pi, le goupi, la souri ( verte qui courait dans l’herbe, mais maintenant elle a aussi un longbago) et même la bactéri de Benladen qui réclament leur part du gateau.
Quel jambori !
Avec son tokivoiki, elle téléphone à la mairi.
Hélas! cafouilli, crachouilli, bureaucrassi, embrouillamini, et même quelques lazzis … .
Avi de nervis en treilli dans nos vis ; ni messi, ni sosi de fauciyémarteau, ni paradi, ni juri populaire, pas même un crucifi en bui pour faire beau.
Au matin blème, un cooli payé au smi (mais rubi sur l’ongle) qui livrait un coli piégé fut abattu d’un coup de fusi, et son caddi transformé en voiture bélier.
Collision de colis, confettis de caddi, couli de cooli dégoulinant sur les lambris, moucheti sur le crépi, incendi de l’abri ; défi à la plomberi, plus d’eau au pui sous le tailli, clapoti au tuyau, pipi d’oiseau. Finie la fourmil, tampi.
Mais quel gachi, quelle chienli ! À quel pri ?
Un érudi un peu dandi, prenant parti, eut la foli d’en faire un rapport de cinq pages avec croqui sur la mort des utopis. En eut le tournic. Tournicoti tournicoton !
Avec un c comme facéti pour des lanternes»
— Vellou
"Fondamentaux"
[modifier | modifier le wikicode]
1 - 2 - 3
← Petit Larousse illustré 1918. Apprentissage de la natation.
b - a - ba
ça vient de loin, c'est mieux que rien …
mais,
« il faut rappeler sans cesse que l’école est le lieu, non de l’invention de l’avenir (que les citoyens seuls peuvent et doivent assumer) mais de la conservation du passé dans la reproduction du présent. Il faut le dire clairement: l’école a une fonction avant tout conservatrice; elle ne peut ni ne doit remplacer l’action politique, ni, a fortiori, changer une société qu’elle a pour fonction de reproduire. Et le progressisme pédagogique, parce qu’il confond deux ordres différents (disons, pour simplifier, l’ordre du pouvoir et celui du savoir) compromet en fait le progrès même pour lequel il combat. »
— Comte-Sponville, Colloque philosophique de Sèvres, 6-8 mars 1984)
Voilà que, dans l’histoire de l’Humanité, tout le monde peut aller à l’école ; et même doit y aller. On ne va pas s’en plaindre. Cette révolution toutefois n’opère pas au moment du biberon. Le langage y prend soudain une tout autre allure, de quoi surprendre le petit enfant naïf, mais normalement curieux et intelligent. Or, aux commencements de ce formidable progrès qu’est l’école laïque, gratuite et obligatoire, on n’a pas dix ou quinze ans devant soi pour mener l’affaire à bien, on ne peut pas attendre que la raison rationnelle sorte de sa chrysalide. Alors, demandez le programme ! Mais n’allez pas le chercher aux archives nationales, pour l’essentiel il est toujours là, semble-t-il.
Pendant un siècle et demi, tous les enfants de France ont donc « fait de la grammaire » à l’école élémentaire. Ils en ont fait, il n’y a pas de doute. Tous ! Et pourtant, la grammaire formelle n’est pas de cet âge affirment nombre de psychologues et de linguistes.
S’ils continuent aujourd’hui à en faire, il y a peu de chances qu’ils échappent davantage qu’aux temps héroïques au funeste destin de ne rien y comprendre quelles que soient les théories savantes convoquées (toutes respectables et utiles à la recherche) et quels que soient les prodiges d’ingéniosité pédagogique que les « instit’ » déploient.
La grammaire scolaire explicite est une activité métalinguistique (Voilà ce mot savant qui se met à faire, pour vous, son travail avec efficacité). L’activité métalinguistique est un don universel et n’est pas nouvelle pour l’enfant. Un bébé qui apprend à parler fait de la grammaire sans le savoir. "Je venirai" dit-il, ou je suis monté dans "une censeur".
Parce que :
je vais finir ----------> je finirai
je vais venir ---------> je venirai
la maison ------------> une maison
l’ascenseur ----------> une censeur
C’est ce que les psycho-linguistes appellent de "bonnes fautes" qui témoignent qu’une "machine à faire de la grammaire" est dans la petite tête, en marche, qui pose des questions à la langue entendue pour pouvoir en tirer des lois pratiques et efficaces réutilisables dans d’autres situations. (Cette machine mystérieuse n’est donc pas un disque qu’il suffirait de graver pour qu’il répète les phrases utiles et surtout correctes qu’il faut savoir.) Le petit enfant n’arrête pas de faire de la grammaire ; pour autant, il ne fait pas de discours à propos de ce qu’il fait. La « machine à grammaire » pose des questions, mais ne s’en pose pas.
L’activité métalinguistique n’est généralement pas réfléchie. Mais, à la grande école, plus question d’apprendre sans réfléchir, de « faire de la prose sans le savoir », puisque l’école est, par définition, le royaume de la lumière !
Pour apprendre à lire, il faut donc écouter attentivement ce que raconte le maitre ou la maitresse à propos des lettres et des sons. Cette première tâche, en fait, n’exige pas une tellement grande réflexion. Quand l’enfant est futé et pas trop épouvanté, il a tôt fait d’en prendre et d’en laisser, de s’apercevoir intuitivement qu’il peut s’en sortir à moindre cout, ce qu’il ne manque pas de faire.
Ceci demandera des explications techniques. Disons déjà qu’au cours préparatoire on peut apprendre à lire sans (trop) réfléchir. Des indices suffisent pour deviner les mots, notamment des indices concernant leurs sons ; mais aussi leur forme (au jeu de « mémory », les petits enfants battent à plate couture les vieux grands-pères ; mais même les babouins, d’après une récente étude, sont aptes à repérer des régularités dans l’ordre des lettres propre à telle ou telle écriture – La Recherche, janvier 2013). On peut ainsi donner l’impression à la maitresse qu’on fait scrupuleusement tout ce qu’elle explique jour après jour. Par ailleurs, le cerveau trie et classe, repère les régularités, digère les exceptions. Il fait son boulot de bon petit cerveau humain apte au langage. Nous reviendrons là-dessus quand il faudra bien aborder la fameuse querelle globale-syllabique.
Par contre, quand arrive la grammaire, il faut absolument sortir le grand jeu. En particulier, il faut faire quelque chose qui ne coute pas d’effort particulier aux adultes (qui se mettent alors en colère parce qu’ils ont l’impression que les gosses se moquent d’eux), une activité qui consiste simplement à aller et revenir le long de la ligne écrite, puisqu’un élément de la phrase n’a d’existence que par rapport aux autres. Or la pensée d’un enfant ne sait pas trop revenir en arrière, elle n’aime pas trop non plus considérer quelque chose de plusieurs points de vue à la fois. Elle va toujours de l’avant dans le sens de l’action. Ce qui ne lui interdit pas, au contraire, d’être efficace. Tout dépend de la tâche demandée et de comment elle est demandée.
Écoutons un très ancien psycho-linguiste. La date est en gras, plus grosse et soulignée exprès pour qu’on l’entende enfin. Parce que ça fait un sacré bout de temps qu’on aurait dû l’entendre si ce qu’il dit est vrai :
« L’enfant ne connait que des situations, des emplois : il écoute et il parle, puis il lit et écrit. Comment peut-on lui demander de réfléchir sur la langue, alors qu’il commence à peine à tenter quelques combinaisons sur les choses concrètes? Cette attitude de l’enfant est aussi celle de tout le monde, à l’exception des linguistes, des enseignants et de leurs élèves ; chacun écoute, parle, lit, écrit ; et si chacun réfléchit à ce qu’il écoute et lit, combine ce qu’il dit et écrit, c’est à propos des choses représentées et évoquées, non à propos de ce avec quoi elles sont représentées et évoquées. Il reste bien entendu qu’en deçà de cette réflexion consciente se déroulent des processus psychiques complexes. C’est vers ces processus que tendent les efforts d’analyse des linguistes et des enseignants qui cherchent à percer et à utiliser les structures profondes de l’organisation de la langue. »
— J. Wittwer, Contribution à une psycho-pédagogie de l’analyse grammaticale, p. 15, 1964
Comme l’auteur, en plus, n’écrivait pas « pour passer le temps », il faisait en conséquence quelques propositions psycho-pédagogiques :
« C’est à l’étude (du) transfert réversible "réception-émission" que sera consacré le premier chapitre.
Le second chapitre rappellera quelques conditions historiques et pédagogiques du développement de l’analyse grammaticale et montrera, par des exemples, la netteté de l’échec de l’analyse traditionnelle.
Les trois derniers chapitres chercheront à poser quelques jalons sur la voie d’une psycho- pédagogie efficace de l’analyse grammaticale: le chapitre II montrera comment l’analyse d’une proposition SUJET-VERBE-OBJET nécessite des opérations mentales d’un niveau moyen de 12 ans. »
Piaget, le célèbre psychologue, situe à cet âge le moment où l’esprit passe de l’intelligence concrète à l’abstraction. On a critiqué un peu ou nuancé sa thèse, mais l’essentiel de ce qu’il dit reste certain. En tout cas, c’est une bonne précaution d’en tenir compte :
« Jusque vers (onze, douze ans), les opérations de l’intelligence enfantine sont uniquement « concrètes », c’est-à-dire ne portent que sur la réalité elle-même et, en particulier, sur les objets tangibles susceptibles d’être manipulés et soumis à des expériences effectives. Lorsque la pensée de l’enfant s’éloigne du réel, c’est simplement qu’elle remplace les objets absents par leur représentation plus ou moins vive, mais cette représentation s’accompagne de croyance et équivaut au réel. »
« toute habitude est […] irréversible […] Il en est de même des perceptions, qui suivent le cours des choses, et des actes d’intelligence sensori-motrice qui, eux-aussi, tendent vers un but et ne reviennent pas en arrière […] Il est donc très normal que la pensée du petit enfant commence par être irréversible et que, en particulier, lorsqu’elle intériorise des perceptions ou de mouvements sous forme d’expérience mentale, celles-ci demeurent peu mobiles et peu réversibles. L’intuition primaire n’est donc qu’un schème sensori-moteur transposé en acte de pensée, et elle en hérite naturellement les caractères. »
— Piaget, Six études de psychologie, folio, essais - 1964, p. 90 et p. 50
12 ans ! le sujet, le verbe et le complément d’objet ! … C’est dire quel espoir de développement intellectuel on peut fonder sur l’appropriation prématurée des règles tarabiscotées d’accord du participe passé. Supposons que, dans un effort héroïque d’adaptation et au risque d’être trainé dans la boue par les traditionalistes, les responsables des programmes reculent d’un an ; si c’est avant 12 ans alors … pipeau ! Et la seule solution professionnelle qui reste aux enseignants est toujours la même : mécaniser à outrance en espérant que, plus tard, les lumières de la raison remettront les choses en place. Il faut s’y prendre autrement ; car quand on fait semblant, on n’apprend rien d’autre qu’à faire semblant, nous a expliqué Freinet.
Donc, grammaire, amers souvenirs ? … Si la réponse est oui, alors ça ne veut pas dire que vous étiez stupide ; vous aviez votre âge, c’est tout. Sans doute aussi, vous ne saviez pas compenser votre "insuffisance conceptuelle" par quelque adresse à flairer les trucs des exercices ; il y aurait fallu un peu plus d’entregent, un accord culturel plus profond entre vous, le milieu social que vous représentiez, et l’enseignant. En bref, vous ne saviez pas faire semblant de faire de la grammaire avec l’institutrice(teur).
Mais soyez magnanime si vous êtes quand même devenu syndicaliste, ne tirez pas sur les pianistes. Ils font ce qu’ils peuvent et ce ne sont pas eux qui décident des contenus d’enseignement. Quand ces contenus changent tous les dix ans, ou du moins ont l’air de changer sous le vent impétueux des judicieuses critiques scientifiques et pédagogiques, les pauvres enseignants sont sommés de sortir de leurs tranchées et de partir à l’assaut baïonnette au canon, chacun droit devant soi jusqu’à la ligne bleue du renouveau. Les plus prudents ou malins vont rester terrés, les autres vont tourner casaque à la première hécatombe, quelques-uns iront jusqu’au bout et se feront conspuer, ridiculiser, étriper, voire insulter par les réactionnaires. Le philosophe Comte Sponville les prévient pourtant (et nous, nous répétons la citation - il faut répéter pour que les leçons fondamentales rentrent dans les têtes) :
« il faut rappeler sans cesse que l’école est le lieu, non de l’invention de l’avenir (que les citoyens seuls peuvent et doivent assumer) mais de la conservation du passé dans la reproduction du présent. Il faut le dire clairement: l’école a une fonction avant tout conservatrice; elle ne peut ni ne doit remplacer l’action politique, ni, a fortiori, changer une société qu’elle a pour fonction de reproduire. Et le progressisme pédagogique, parce qu’il confond deux ordres différents (disons, pour simplifier, l’ordre du pouvoir et celui du savoir) compromet en fait le progrès même pour lequel il combat. »
— Comte-Sponville, Colloque philosophique de Sèvres, 6-8 mars 1984
(les Actes du Colloque ont été publiés aux PUF, sous le titre "Philosophie, école, même combat")
La grammaire à l’école élémentaire ne peut être qu’une succession de trucs et bouts de ficelle pour réussir des exercices-types qui, peut-être, un jour, serviront. Et, comme par hasard, ces exercices se déroulent selon des procédures linéaires. Nous vous faisons revoir (réviser) l’analyse grammaticale dans sa réalité élémentaire (et si ça a changé, nous demandons à voir : nous n’en voyons nulle trace dans le « soutien scolaire » ni dans les sites bienveillants consacrés à la question).
Nous ne disons pas que ce qui va suivre est ce qu’on enseigne à l’enfant, mais ce que celui-ci doit tenter, à part soi, de faire pour s’en sortir avec l’intelligence normale et la perspicacité dont il dispose.
Par exemple. « De la majuscule au point », il y a « qui » ou « que », petits mots caractéristiques qu’il faut extirper du flux et analyser. « Je vois "qui", je dois dire « qui : pronom relatif » --> je cherche l’antécédent (c’est le nom juste avant) --> je dis : « la proposition subordonnée relative est complément de l’antécédent » --> je dis: « qui est sujet du verbe de la proposition subordonnée » (je le cherche, il est juste après) → etc. Mais je ne vois pas "qui", je vois "que". « Zut, une vacherie » se dit l’enfant. En effet : lequel "que" ? Pronom relatif --> même topo, mais « que » est complément ; « que » conjonction --> un autre programme à régurgiter. Mais lequel « que » ?.. Heureusement, l’instituteur a encore des trucs ; il en a plein ses poches, ce serait bien étonnant qu’il n’en ait pas un pour ce mot-là ; il n’y a qu’à lui faire confiance ! C’est vachement éducatif. Ça ressemble à de la grammaire comme vous ressemblez à un cheval. Mais, redisons-le, on peut devenir cheval de cirque, ce n’est pas un si mauvais destin.
Non, ne tirez pas, décidément, sur ces aimables pianistes qui jadis préparaient au certif 50% de leur effectif, lesquels en plus n’iraient pas plus loin. Au boulot, après le certif ! Pour atteindre l’objectif, les élèves devaient non seulement faire semblant de faire de la grammaire (pour les questions de la dictée) mais devaient surtout ingurgiter les trucs d’orthographe grammaticale les plus efficaces possibles auxquels il fallait bien, quand même, donner une allure de cohérence générale.
Ces trucs, en eux-mêmes, ne sont pas si stupides (s’ils ne reposaient sur rien, ils ne marcheraient pas).
Ils consistent généralement:
1--> ou bien à reconnaitre, comme ci-dessus, des mots balises mémorisés dans des inventaires pas trop longs (ex. le célèbre « mais où et donc or ni car ». Sacré Charlemagne et sacré Ornicar ! Mais toujours célèbre, Ornicar, si on en juge à cette petite plaquette de vulgarisation de la grammaire en vente sur les autoroutes – voir lecture)
2 --> ou bien à essayer de les définir par le sens qu’ils ont par « nature » ; et alors, dans la phrase, ils pourront avoir ou non telle ou telle « fonction ». Mais c’est plus compliqué qu’une recette de cuisine au moment où on mélange pour de vrai les ingrédients.
Envisageons de traiter l’affaire sujet-verbe et compagnie, toujours avec la prétention simulée de faire comprendre et, comme but réel, de faire réaliser les indispensables accords, c’est-à-dire mettre les « s » et « nt » au bon endroit.
Voici une petite phrase vicieuse extraite d’une petite dictée (il faut faire des dictées, c’est ainsi qu’on apprend l’orthographe, réclame le peuple tout entier). Il s’agit d’une école à la campagne.
"Des plantes grimpantes ornaient la façade".
Employons le procédé de substitution verticale.
Nous demandons de prêter l’oreille au premier mot changé, pour comparer l’oral et l’écrit
Des plantes grimpantes ornaient la façade
Une
On s’aperçoit que le verbe est un mot qui varie avec le temps et la personne du sujet, mais qu’avec la personne ça ne s’entend pas forcément. Il faut donc d’autres moyens pour repérer le verbe ainsi que son sujet qui le fait varier. L’un fait trouver l’autre et vice-versa. Le sujet fait changer le verbe, mais pour trouver le sujet il faut poser la question "qui est-ce qui ? » Cercle vicieux parfait. Alors, autre procédé scolaire, on évoque le fait que "le plus souvent", "généralement" le verbe évoque une action. Avec cet exemple on ne peut mieux tomber puisque « grimpantes » est … l’adjectif qualificatif et « ornaient » un verbe particulièrement décoratif.
3--> ou bien à opérer des substitutions diverses.
Ça, c’est peut-être un peu plus profitable au plan culturel, parce que ça reflète plus directement la structure. Ça peut rester effectivement utile, en tant que truc orthographique pour toutes ces difficultés de la langue écrite qui s’obstinent, pour la plupart d’entre nous, à ne jamais passer en régime d’orthographe automatique, et ça peut servir de base à une réflexion quand elle devient possible. Il n’y a pas de mal à dire à l’enfant qu’il comprendra plus tard, mais que, pour l’instant, ce n’est qu’un truc utile qui sera expliqué un jour ; on ne cachera rien au futur citoyen.
Substitutions d’un mot à un autre, de temps, ou de genre
- ex. pour savoir si le verbe du premier groupe entendu [ é ] dans la phrase s’écrit « é » ou « er », on remplace par un verbe d’un autre groupe où la différence s’entend :
| participe passé : | il a chanté | il a souri |
| infinitif : | il va chanter | il va sourire |
- autre ex : a ou à
| il a mangé à la cantine |
| il avait mangé à la cantine |
Ces manipulations correspondent effectivement à la réalité de la langue ainsi qu’à des méthodes d’analyse employées par les linguistes. La substitution verticale tout particulièrement. (Appelons-la ainsi en raison de l’apparence qu’elle prend, quand on l’explique sur papier, d’une colonne de mots perpendiculaire à la ligne d’écriture à l’endroit où on se pose des questions ; colonne de mots qui ne font pas partie de la phrase mais qui peuvent, si on le veut, en faire partie à la place du mot en question.)
| Exemple : L’analyse grammaticale | a | mauvaise réputation |
| avait a eu aura va avoir |
En linguistique on parle de deux axes :
l’axe paradigmatique (vertical) et l’axe syntagmatique ( horizontal), notions essentielles dont vous n’aurez pas fini d’entendre parler si vous vous intéressez à ces questions ; mais vous les avez déjà vues à l’œuvre notamment au ch 4.
Mais terminons-en pour ce qui concerne l’école. L’école qui ne peut pas expliciter ce qu’il y a derrière chaque truc enseigné fournira donc le même enchainement de réflexes qu’à l’exercice précédent.
a , à ?
- j’essaie de dire avait
- je peux dire avait ---> j’écris a
- je ne peux pas dire avait ---> j’écris à
Et ensuite, en cas de besoin pressant (c’est à dire, si le maitre insiste)
- a --> je dis « c’est le verbe avoir »
- à --> « est une préposition »
… Parce qu’il s’agit de se cultiver, sacrebleu ! Et pas seulement de savoir si oui ou non il faut un accent .
Mais, dira-t-on, c’est bien beau de critiquer, comment faire autrement ?
On pourrait essayer de mobiliser le « sentiment linguistique », « l’intuition de la langue » ! Ça devient subtil, mais il n’est pas stupide de penser que c’est, sans qu’on sache très bien comment, ce qui marche le mieux … avec ceux pour qui ça marche, et sans qu’ils le sachent. Soit l’énoncé :
- le schtroumpf schtroumpf
Qui est-ce qui [schtroumpf] ? — C’est le [schtroumpf] — Qu’est-ce qu’il fait, qu’est-ce qu’il lui arrive au [schtroumpf] ? — Il [schtroumpf] ; i [schtroumpf], le [schtroumpf].
Nous avons bien, en effet, comme une sorte d’intuition qui tendrait à confirmer ce que racontent les linguistes, que la grammaire est dans notre tête et qu’elle y fonctionne toute seule sans qu’on ait besoin d’aller la tripoter.
Mais on va voir immédiatement autre chose : que si on a pensé sujet-verbe, c’est à cause des questions posées. On aurait pu penser aussi bien nom-adjectif.
Expérience :
« Qui c’est, ce petit personnage rigolo ?
— C’est le [schtroumpf] [schtroumpf] qui part au bois chercher de la salsepareille avec ses amis le [schtroumpf] futé et le grand [schtroumpf]. »
Vous êtes bien pris. Nous avions manipulé en douceur votre petit ordinateur grammatical personnel. Maintenant vous ne "pensez" plus sujet-verbe, mais nom-adjectif à partir pourtant du même "message" : le [schtroumpf] [schtroumpf]. Et tiens, à la fin, encore du nouveau : le « grand [schtroumpf] » et le « [schtroumpf] futé » ; l’adjectif après ou avant le nom. Ici, c’est bonnet blanc et blanc bonnet pour le sens. Il n’y a qu’une habitude. Mais comparons:
- « un certain réformisme » et « un réformisme certain »
Ah ! c’est vraiment pas pareil (quoique, politiquement … mais ce n’est pas la question).
La langue est, décidément, un outil prodigieux et un peu diabolique. C’est comme si elle profitait de toutes les combinaisons possibles pour, à son gré, mettre du sens. Ici, c’est sur l’axe horizontal qu’elle opère et qu’elle joue.
Ce sentiment grammatical, qu’on a dans la tête, nous permettrait donc de distinguer deux schtroumphs possibles:
- « le [schtroumpf] [schtroumpf] » et « le [schtroumpf] [schtroumpf] »
Comme dans ces dessins d’illusion où les cubes inversent leurs reliefs.
Le vertige grammatical vous saisit ? Arrêtons là.
Pour ce qui concerne la grammaire scolaire, notre souci présent, pour aboutir à l’exigence finale d’une grammaire explicite, consciente, éclairante, on pourrait du moins choisir autre chose que la phrase (de la majuscule au point !) comme os de seiche donné d’emblée à picorer pour fortifier l’intelligence conceptuelle. On pourrait, par exemple, commencer par constater, pour des « objets tangibles susceptibles d’être manipulés et soumis à des expériences effectives », de curieuses différences de désignation : une table, un stylo, un stylo vert, le stylo vert d’Aglaë, un bonbon, un bonbon au chocolat, le bonbon au chocolat qui reste au fond de la boite ; « Apporte-moi le tabouret ; apporte-moi la chaise. - Laquelle, Monsieur ? » …
Et continuer, bien sûr, « l’analyse », jusqu’à la phrase évidemment, mais sans jamais oublier de coller aux référents possibles (ch 4) ; possibles selon Piaget.
Nous avons voulu montrer, le plus agréablement possible, que la grammaire, c’est pas simple. La linguistique, cependant, propose diverses théories explicatives qu’il n’est pas question de rejeter et que nous allons essayer de comprendre un peu. Toutes sont évidemment intelligentes, mais débouchent sur des formulation de plus en plus compliquées. On ne peut pas transposer directement à l’école. C’est pourtant ce qui a été essayé … et les vautours réactionnaires se sont bien régalés !
Mais, nous, citoyens, nous pouvons essayer de comprendre :
→ Il y a la démarche qui colle délibérément au sens produit par l’agencement des mots entre eux. Qui essaie de voir ce qui se produit quand la langue « fonctionne » et comment elle fonctionne pour que du sens soit produit.
Le fonctionnalisme est la théorie du monsieur dont nous recommandons la lecture. Cette recommandation de notre part n’a évidemment pas la valeur d’un choix scientifique. C’est de la politico-linguistique.
Que dit Martinet sur le point de vue fonctionnaliste :
« Il n’est pas surprenant que le terme de « structure » soit devenu le signe de ralliement des descriptivistes contemporains. Ce terme sous-entend évidemment une cohérence des composantes mais il indique en même temps la prédominance de l’ensemble sur les parties. En revanche, le terme de "fonctions" qui est également très à la mode dans certaines disciplines, n’a pas beaucoup de succès en linguistique. Il fait évidemment penser aux différentes possibilités d’utilisation du langage, il suggère des contacts avec le monde en général, ces même contacts que nous avons dû laisser hors du champ de notre recherche pour atteindre le stade d’une discipline parfaitement autonome. Mais, puisqu’il est généralement admis qu’une langue fonctionne comme un instrument permettant d’obtenir certains résultats, on ne peut guère contester que le fonctionnement même de cet instrument doive être l’une de nos préoccupations majeures.
Nous pourrions être tentés de définir la "fonction" comme la contre-partie linguistique de la relation entre un élément d’expérience et l’ensemble de l’expérience … »
— André Martinet, Langue et fonction, p. 12 et p. 73
La grammaire alors n’est pas un prétexte à stériliser la vie et mécaniser la pensée.
→ Mais il y a aussi la démarche qui s’efforce, par effort délibéré de doute systématique (et scientifiquement, c’est tout à fait respectable), de mettre à part l’individu parlant pour n’utiliser, sur des phrases bien délimitées, que des procédés quasi mécaniques de découpage et de substitution de mots par d’autres, afin de fournir des listes de mots classés sans surtout se mettre à évoquer des "valeurs sémantiques" où nous savons que tant de pièges se profilent.
Cette démarche conduit le chercheur à travailler sur des enregistrements ou des textes déjà écrits. Il rassemble un ensemble de documents, clôt cet ensemble et s’interdit ensuite d’en appeler d’autres à la rescousse (afin d’éviter l’intrusion de ses propres préjugés linguistiques. En quelque sorte, il se met en garde contre lui-même). Et si, par exemple, dans cet ensemble de paroles (orales, écrites) retenues, il trouve:
- « je vais chez le coiffeur »
- et « je vais au coiffeur »
- « la réunion aura lieu en mairie »
- et « la réunion aura lieu à la mairie »
Il ne cherchera pas ailleurs du "bon français", il constatera, sans plus, qu’il y a ce français-là dans son inventaire, quitte à chercher ultérieurement, dans un plus vaste inventaire (mais non moins clos - On les appelle corpus -) si « chez » et « au », « en » et « à la » n’obéissent pas à une loi de distribution. Nous devinons sur les phrases présentées ici que cette loi de distribution est liée à des types de « discours » et non à des types de phrases.
Aller en voiture - à la nage > phrase
en mairie - à la mairie > discours
Premier discours: celui de l’édile municipal soucieux de consacrer la dignité du lieu où il officie. Deuxième discours: celui du quidam qui a toujours été "à la mairie" et se demande confusément quelle configuration de vol il doit prendre pour aller « en » désormais.
Vous voyez soudain où nous voulons en venir et combien tout ceci n’est pas neutre. Alors que les procédures choisies pour l’analyse linguistique (scientifique), elles, à priori, le sont.
Pour revenir à nos ognons proprement linguistique, mais motivés par l’idée que ça aura à voir avec nos intérêts civiques, nous devrons signaler que cette dernière façon de procéder qui s’interdit de faire intervenir le sens, sauf pour vérifier que quand même les phrases qu’on triture ont un sens, a atteint un degré de complexité extrême qui n’a évidemment que peu de rapports avec nos petits exemples. La mathématique des ensembles règne en maitresse ; ce qui justifiera un détour touristique (chapitre IX), mais nous ne pourrons même pas vous convier à descendre de l’autocar, et à quoi bon s’émerveiller derrière une vitre. Sauf peut-être pour se dire qu’il s’accumule, dans les domaines rentables (pas dans l’instruction publique), du travail d’ingénieur de haut niveau, avec sans doute derrière, pour le soutenir, l’équivalent d’une « académie des sciences » (et pour le permettre, dans le libéralisme, quelques capitaux). La linguistique mathématisées fabrique déjà des miracles ; « google » est un de ces miracles.
→ Il y a la démarche enfin, encore plus exigeante, qui cherche à expliquer cette structure proprement grammaticale qui met les mots en ordre tout au fond de l’esprit et sans qu’on ait besoin d’y réfléchir. Cette "boite noire" mystérieuse propre à l’espèce humaine. (Nous n’affirmons rien sur la question, bien entendu, mais nous rapportons ce qui se discute entre savants – si vous voulez être au courant, lisez le plus récent livre de vulgarisation : «Le langage, introduction aux sciences du langage », ouvrage collectif « coordonné par Jean-françois Dortier », éditions « sciences humaines » 2010). Certains disent que la faculté de langage est innée, tellement les enfants vont vite à apprendre une langue dans un « bain de langage ». D’autres prétendent qu’on peut parfaitement expliquer le phénomène par l’exercice normal des facultés intellectuelles dont dispose très vite le petit enfant. Forcément, nous serons forcés de considérer de près ces théories dont l’intérêt pour les apprentissages est évident, mais sans pouvoir, bien entendu, décider de la vérité. C’est notre différence avec les vautours réactionnaires : notre vie intellectuelle et morale est plus incertaine.
Tard venues dans l’histoire, les sciences humaines ne peuvent être plus simples que la physique ou la biologie. Cela n’interdit pas d’en avoir une compréhension culturelle. Comprendre qu’elles procèdent désormais, comme toutes les autres sciences, par hypothèses suivies d’expérimentation fait partie de cette compréhension. Ce qui conduit nécessairement à des remises en cause pédagogiques ; mais là … :
« Il faut se garder d’une confusion grossière. Si une grammaire générative est en quelque sorte l’algorithme des phrases de cette langue, elle ne représente pas du tout les opérations par lesquelles passe le locuteur avant de prononcer une phrase […] Autrement dit une grammaire générative génère, engendre les phrases d’une langue, mais n’a rien à voir avec le processus d’émission / réception de ces phrases, processus qui est du ressort de la psychologie.
Dans l’état actuel de nos connaissances, la plupart des règles que nous manipulons sont hypothétiques et doivent sans cesse être réajustées par un travail d’observation et de manipulation de phrases( …)
Le travail […] est une recherche de données pour construire une hypothèse de règles, et une recherche de preuves pour confirmer cette hypothèse. Les observations, les manipulations, les classements que nous ferons nous paraissent aussi beaucoup plus productifs au niveau pédagogique que les leçons où l’on apprend et où l’on applique des règles que le linguiste qualifie lui-même d’hypothétique. »
— Christian Nique, Manipulations syntaxiques en grammaire générative, 1975 ! (p. 123 et p. 18)
Voilà ce qu’écrivait un autre psycho-linguiste il y a plus de quarante ans (c’est moins vieux!). Il saute aux yeux qu’il n’est pas content du tout de l’exploitation soi-disant pédagogique qu’on faisait à l’école des travaux de ses confrères. Mais pour éviter les errements qu’il dénonce, dépasser la vieille grammaire scolaire mécanique et s’approprier le progrès de la science, il aurait fallu une autre formation des instituteurs et des programmes profondément transformés. Des instituteurs compétents et considérés comme tels n’aurait plus accepté d’enseigner des notions impossibles et/ou complètement dépassées grâce à des trucs de montreur d’ours. Car ces façons de faire pas spécialement « libératrices », que nous venons d’évoquer et qui à l’évidence se perpétuent, n’échappaient pas jadis à la critique des enseignants. Les gens ne sont pas stupides ; les instituteurs non plus. Quelques-uns pouvaient approuver le principe du dressage (par conviction idéologique, il y a des réactionnaires partout et donc aussi dans le corps enseignant) ; ou être indifférents (par égoïsme) ; d’autres se sentir impuissants. Mais tous s’informaient. Malheureusement, quand les idées nouvelles de la linguistique (comme celles des mathématiques) sont entrées à l’école (moitié par opportunisme, moitié par militantisme), les tentatives d’application pédagogique ont tourné en eau de boudin. Et la réaction a été terrifiante. On en est encore là.
L’enseignement de la grammaire à l’école est donc aussi et d’abord politique. CQFD.
C’est aux citoyens de continuer de s’instruire puisque l’école ne le peut pas (voir Comte Sponville). Et après, ils décideront des moyens prioritaires ou non qu’il faut mettre en œuvre pour échapper à l’obscurantisme.
Lexique
Une jolie brochette de mots en ique. Pas de quoi malgré tout s’affoler.
sémantique : ce qui concerne le sens, la signification.
D’abord on pourrait penser que la langue est forcément affaire de sens. (On sait que même des propos qui "n’ont pas de sens" -par exemple, ceux d’un poivrot - en ont un tout de même).
On ne voit pas par quelle opération chimique ou chirurgicale on pourrait fabriquer de la langue "désémantisée" comme du café décaféiné. Mais dans ce chapitre on a pu entrevoir :
1 - que ce n’est plus si évident de trouver exactement où il est. Où va se nicher le sens dans les propos des petits schtrouphs, personnages transparent s’il en est pourtant ?
2 - que les linguistes se sont souvent efforcés, pour étudier les langues sans préjugés, de faire comme si chaque fois la langue en question leur était inconnue. Ils travaillent d’abord sur la forme et non sur le contenu sémantique.
Syntaxique (→ syntaxe)
« On appelle syntaxe la partie de la grammaire décrivant les règles par lesquelles on combine en phrase les unités significatives »DLL
Sauf que les dites « combinaisons selon des règles » produisent elles-mêmes de la « signification ».
Paradigmatique : En linguistique moderne, un paradigme est constitué par l’ensemble des unités entretenant entre elles un rapport virtuel (1) de substituabilité (2). D L L.
Ne nous affolons pas:
(1) virtuel : possible.
(2) substituabilité : mot de la famille de substitution ; substituer : remplacer
On trouve des exemples dans les pages précédentes.
Syntagmatique : les rapports syntagmatiques concernent l’axe horizontal.
Exemple d’un rapport syntagmatique significatif :
Le chasseur tue le lion
Le lion tue le chasseur.
Là, on a deux phrases qui permettent l’émergence soudaine et émerveillée de la conscience grammaticale.
Nous reviendrons, évidemment, dans les chapitres suivants, en lexique et dans le texte, sur ces notions essentielles.
Lectures des années 70, pour approfondir la complexité :
Sauvageot, Peytard et Genouvrier, Oswald Ducrot
0/ Mais d’abord, aujourd’hui, où en est-on dans la vulgarisation ?
Voici l’idéologie dominante sur l’autoroute. Que dit la première page de l’aide-mémoire qu’on vous y propose ? Ou bien on apprend la grammaire comme le code de la route, ou bien le langage est un galimatias.
Ceci dit, la plaquette est un excellent aide-mémoire. L’outil est pratique. Les auteurs devraient en être heureux et s’en contenter. Ou annoncer aussi, mais franchement, leur conception du monde.
« la grammaire
MAIS… OÙ EST DONC ORNICAR ?
À la question : « À quoi sert la grammaire ? », répondons par une autre question : « Que se passerait-il si elle n’existait pas ? » Imaginons en effet un instant ce que pourrait être la langue française sans la grammaire. Une offre Marie Paul à rose ; qu’en ont ces l’homme que ses. Quelques notions élémentaires – de grammaire- suffisent à y mettre de l’ordre : Paul offre une rose à Marie ; quand on sait l’homme que c’est. Ah ! Voilà qui fait sens ! (Remarquez que, du coup, quand on connaît la grammaire, on fait moins de fautes d’orthographe!) La grammaire permet de comprendre quel est le rôle joué par chaque mot et, au final, de savoir de quoi l’on parle, ce qui est bien la raison d’être du langage. À l’instar de la route, la langue a donc son code : c’est la grammaire. Pas de code et c’est le capharnaüm assuré (imaginez que vous rouliez en ville sans avoir appris le code de la route...)
Maintenant que vous êtes (nous l’espérons!) convaincu de l’utilité de la grammaire (il ne viendrait à personne l’idée de contester le fait de devoir apprendre le code de la route), voyons d’un peu plus près en quoi consiste « l’espèce de sorcellerie évocatoire » dont Baudelaire qualifiait le savant maniement de la langue, et quelle logique la sous-tend.
(…) »
— AEDIS, – La grammaire . Petit guide n° 130
1/ Observations fines (mais seulement descriptives) sur cette complexité des problèmes posés
« la relation objectale entre le verbe et le mot qui sert de complément d’objet ne s’établit souvent que par l’intermédiaire d’un troisième élément. Ainsi, quand nous entendons dire : Il a attendu une nuit, aucune de nos grammaires ne désignera la séquence une nuit comme le complément d’objet du verbe il a attendu. On y verra un « complément circonstanciel de durée » et cette même énonciation pourra revêtir la forme : Il a attendu pendant (durant) une nuit. En revanche, si l’on nous dit : Il a attendu la nuit, nous supposerons que la personne dont il est parlé n’a rien entrepris avant la nuit, et, dans ce cas, nous nous représenterons que la nuit est le complément d’objet de ce même verbe il a attendu. Que la substitution de l’article la à l’article une n’est pas déterminante dans tous les cas ressort d’une autre opposition : Il a travaillé une nuit / Il a travaillé la nuit. Dans ces deux derniers énoncés, les séquences une nuit et la nuit jouent l’une et l’autre le rôle de complément circonstanciel de durée et peuvent être changées en pendant une nuit, pendant la nuit, de nuit, etc. La distinction des articles dans la première formule a suffi à différencier la relation établie entre le verbe et la séquence qui le suivait tandis que dans la seconde, il n’en a rien été et la différenciation a porté sur un autre aspect des choses, elle a opposé le défini à l’indéfini, l’unité à un concept générique. Pourquoi cette différence ? Parce que le verbe attendre est conçu comme « transitif », ce qui veut dire qu’il peut recevoir un complément d’objet alors que le verbe travailler a été employé ci-dessus dans une acception « intransitive », autrement dit, sans relation avec un objet. Mais cette interprétation n’a-t-elle pas été tout simplement suggérée par le mot qui suivait le verbe? C’est ce qui apparaît quand on nous dit : Il a travaillé son piano, ou piano nous apparaît comme l’objet de il a travaillé, alors que, dans : Il a travaillé sa semaine, le mot semaine fera figure de complément de durée !
La relation de verbe à objet se détache donc assez mal de celle de verbe à complément circonstanciel. Ce qui le confirme c’est que, dans : Il a attendu toute la nuit, la séquence toute la nuit nous fait l’effet d’un complément circonstanciel, alors que, dans : Il a attendu la nuit, nous pensons avoir affaire à un complément d’objet. L’adjonction d’un déterminatif (toute) a suffi à transformer la relation entre verbe et mot complément. Le sens intrinsèque des mots joue donc un rôle important dans l’établissement de la relation entre le verbe et les mots qui se combinent avec lui. »
— A. Sauvageot, – Analyse du français parlé – Hachette 1972 , p. 19, 20
2/ Pour approfondir la complexité.
Comment les enseignants furent instruits dans les années 70
- B. Grammaire formelle et grammaire mentaliste
« C’est en 1660 que paraît un court traité de grammaire qui passe aux yeux de certains linguistes contemporains pour l’ancêtre de leurs analyses : Grammaire générale et raisonnée contenant les fondements de l’art de parler expliqués d’une manière claire et naturelle : les raisons de ce qui est commun à toutes les Langues, et des principales différences qui s’y rencontrent. Et plusieurs remarques nouvelles sur la langue française, plus connue sous le nom de Grammaire de Port-Royal; ses deux auteurs, Antoine Arnauld et Claude Lancelot, étaient en effet des solitaires de la célèbre abbaye.
Le livre est important et marque un tournant dans l’histoire de la grammair : « Avant eux, on insérait des analyses de sens dans des cadres formels; avec eux, le sens devient premier et l’étude des relations logiques prévaut sur celle des formes (1). » Comme l’écrit A. Arnauld au début de sa grammaire : « On ne peut bien comprendre les différentes sortes de signification qui sont enfermées dans les mots, qu’on n’ait bien compris auparavant ce qui se passe dans nos pensées, puisque les mots n’ont été inventés que pour les faire connaître. »
Analyser la langue suppose donc le recours aux critères définis par la logique (ce n’est pas un hasard si Port-Royal publie simultanément une Logique).
La langue est un être de raison : les encyclopédistes du XVIIIe siècle vont reprendre l’affirmation : « Le langage est pris pour un miroir de la pensée, dont on reconnaîtra, tout au plus, qu’il est parfois imparfait (2) »
∼∼∼
Tant à Port-Royal que chez les encyclopédistes, la recherche grammaticale va progresser; de nouveaux horizons s’ouvrent par ailleurs sur un problème qui passionnera tout le XVIIIe siècle : l’origine des langues. Pour ce qui regarde le propos que nous nous sommes fixé, nous voyons se dessiner une approche mentaliste du fait grammatical que nous retrouvons envahissant dans nos manuels contemporains. Comme le remarque P. Guiraud, « la linguistique moderne (établit) le caractère essentiellement alogique du langage. Le préjugé logique n’en continue pas moins à peser très lourdement sur la grammaire actuelle, tant dans l’enseignement de la langue à l’école que dans la fixation de l’usage (1) ».
Feuilletons au hasard un manuel : le verbe est défini comme exprimant l’action ou l’état, le sujet comme celui qui fait l’action, la subit ou se trouve dans l’état exprimé par le verbe, le complément d’objet comme ce sur quoi passe l’action du verbe, etc. Définitions redoutables par l’effort d’abstraction qu’elles imposent à l’élève et, sinon fausses, du moins très contestables (le verbe, dans ce mur penche exprime-t-il l’action ou l’état ? Devenir est-il un verbe d’état ? Dans la phrase : il s’évanouit, que « fait » le sujet ? On pourrait à loisir multiplier les exemples …). Nous reviendrons sur ce difficile problème; constatons pour l’heure qu’il n’est pas si aisé de ramener les faits de langue aux catégories de la pensée et qu’à s’y aventurer sans plus de précautions on risque d’enfermer la grammaire dans une scolastique sans intérêt. »
— Peytard et Genouvrier, – Linguistique et enseignement du français – Larousse 1970 , p. 82, 83
3/ L’hypothèse d’une « grammaire profonde »
« la « linguistique structurale » se contente de classer les éléments d’après leur distribution dans le corpus, elle prend seulement en considération la façon dont les morphèmes sont combinés dans les énoncés, c’est-à-dire, dans la terminologie de Chomsky, la « structure superficielle » de l’énoncé. Que l’on considère les deux énoncés :
a) Je te promets de venir.
b) Je te permets de venir.
Pour un « structuraliste » les verbes promettre et permettre ont, dans a et dans b le même contexte. L’environnement Je te … de venir comporte, dans les deux cas, exactement les mêmes sons et les mêmes morphèmes (un pronom sujet, un pronom complément d’objet indirect et un infinitif précédé de de). Au vu des énoncés a et b, le « structuraliste » sera donc induit à placer les verbes promettre et permettre dans le même paradigme.
Il y a cependant, entre a et b, une différence essentielle. Dans a il s’agit de ma venue et dans b, de celle de mon interlocuteur — ce qui devrait amener à placer promettre et permettre dans des catégories verbales très distinctes. L’un met en rapport l’infinitif qui le suit (venir) avec le sujet (je), l’autre avec l’objet indirect (te). Seulement, la « religion du corpus » interdit au structuraliste de s’intéresser à cette différence, qui n’a aucune marque visible dans le texte.
Pour Chomsky, en revanche, les relations combinatoires apparentes dans le texte ne concernent que la « structure superficielle » de l’énoncé, et le linguiste doit chercher derrière elles une « structure profonde » qui se manifeste seulement dans la façon dont les interlocuteurs interprètent et jugent les énoncés. C’est ainsi qu’on doit donner à a et b une structure profonde très différente. On mettra à l’origine dea deux structures, analogues à celles de :
a1) Je te promets
et a2) Je viendrai.À l’origine de b on placera, en revanche les structures de :
b1) Je te permets
et b2) Tu viendras;a est donc obtenu par une transformation T qui emboîte la structure de a2 dans celle de a1, et b par une transformation U, qui emboîte b2 dans b1. Il se trouve que T et U, dans l’exemple que nous avons choisi, produisent des phrases dont la structure superficielle est identique, mais cela n’empêche pas que les structures profondes qui sous-tendent les deux énoncées, et qui servent de base aux transformations, sont très distinctes .
Une fois admise l’idée que les structures superficielles sont tirées, par transformation, des structures profondes, on voit réapparaître en linguistique deux idées que le « structuralisme » avait fait oublier. En effet, si les structures superficielles des énoncés diffèrent, et de façon très sensible, selon les langues, il n’est pas impossible que, pour la structure profonde, toutes les langues recourent au même type de construction. Il n’est donc plus déraisonnable à priori de parler d’universaux linguistiques. Le transformationalisme redonne force d’autre part à l’idée d’une faculté du langage qui serait innée à l’enfant et lui permettrait l’acquisition de sa langue maternelle. L’enfant dispose, en effet, comme élément d’information principal, des énoncés qu’il entend prononcer autour de lui; or, ces énoncés lui apparaissent d’abord dans leur structure superficielle. On voit mal comment l’enfant pourrait reconstituer leur structure profonde, c’est-à-dire opérer. des transformations inverses de celles que pose le linguiste (trouver par exemple je viendrai dans je te promets de venir), s’il ne savait pas déjà, avant toute information empirique, de quel type doivent être les structures profondes. Un modèle à priori de la structure profonde semble être ainsi la condition nécessaire de l’apprentissage de la langue 1. Les structures profondes ne peuvent pas être découvertes par l’enfant, mais seulement redécouvertes. »
— Oswald Ducrot, – le structuralisme en linguistique – 1968 , p. 118,119 120
Machine-grammaire
[modifier | modifier le wikicode]Qu’est-ce qui se passe là-dedans 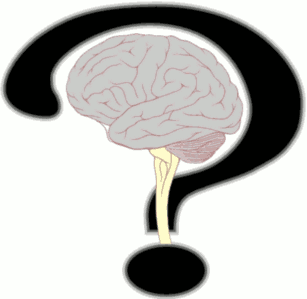
La science reste un espoir,
mais ne remplacera pas la politique
Au fil des pages, nous nous sommes éloignés de la conception encore dominante de la langue comme inventaire de la réalité : un nom pour chaque chose et chaque chose à sa place. La langue comme nomenclature.
Il n’y a personne de sérieux et compétent qui nie aujourd’hui la complexité, le foisonnement, l’imbrication et l’intrication des structures, leur mouvement, leurs interactions. Personne qui ose mettre la langue au carré dans une grammaire définitive et un dictionnaire achevé.
Il n’y a partout que des linguistes affairés qui compilent les observations et les expériences, qui confrontent passionnément des hypothèses capables, sinon de tout expliquer, du moins de donner une vision globale plus cohérente de l’énorme volume des connaissances accumulées.
Et quand quelqu’un croit être sur une piste, il y en a toujours un autre qui glisse un contre-exemple, la peau de banane qui fiche tout par terre. Le train-train de la science dans sa démarche hypothético-déductive. Le copain peut toujours protester qu’il faut choisir un point de vue pertinent et « rejeter à la périphérie les faits marginaux », l’autre rétorque que le petit détail qui ne colle pas dans la théorie est classiquement le germe d’une théorie supérieure. Il y a des histoires célèbres dans les autres sciences qui obligent à être modeste. C’est donc de plus en plus passionnant ! Ils s’amusent comme des fous ! Et parfois, ils se disputent grave ! C’est plus grave. Ça compromet gravement les espoirs qu’il faut fonder sur eux pour espérer s’en sortir par le haut.
Parce que, hors le cercle des spécialistes qui peuvent se permettre de transporter leurs pénates sur une autre planète pour continuer tranquillement leurs travaux, la science du langage, qui est une science humaine, est férocement engagée déjà dans les conflits humains. Là, il ne s’agit pas de mégoter, il faut choisir. Mais comme il n’y a pas de vérité unique, chacun choisit selon son idéologie, c’est à dire (plus ou moins consciemment) ce qu’il croit être ses intérêts, ou financiers, ou de vanité. Et donc il faut procéder à un travail linguistique particulier qu’on appelle l’analyse de discours pour décoder les manipulations auxquelles on est exposé continuellement (revoir, pour le comprendre simplement, l’exemple, somme toute assez anodin, que nous donne Michel Serres → lecture ch 6).
Ce qui est en jeu en fin de compte dans l’incertitude, c’est ce qu’on appelle la façon « correcte » de parler et d’écrire. Et c’est notre problème à tous, tout à fait banal et pas scientifique du tout. Il ne faut pas tourner autour du pot puisque, à un moment ou un autre, la question se pose avec sa conséquence immédiate : avoir ou non le droit à la parole, et donc pouvoir intervenir là où se profilent tous les dangers.
Pour fournir une réponse qui ne soit ni de révolte ridicule, ni de vœu pieu, il faut suivre un parcours difficile et délicat dans la théorie et la pratique. Pour la théorie, on sera excusé si on taille désormais un peu gros. Pardonnez au camarade qui a osé mettre le nez à la lucarne du laboratoire pour renseigner sur ce qui y mijote. Il n’a probablement pas tout compris, le contraire serait étonnant. Mais on peut améliorer l’information et élargir le débat. On peut envisager des jurys de citoyens pour l’expertise civique. S’ils n’existent pas, ce n’est pas la faute de la République, c’est la faute des « braves gens » déçus par les « Trente désastreuses » années du capitalisme sans scrupules et sans contre-pouvoirs et qui ne croient plus à rien. Mais les gens, braves ou pas, doivent choisir un avenir ; on ne peut pas avoir le capitalisme et le communisme à la fois.
Pour ce qui concerne le langage, que nous présentons comme la condition nécessaire de la démocratie, deux catégories de problèmes, au départ pourtant très logiquement distincts, se recoupent sous nos yeux ou se superposent à en donner la berlue. Les uns relèvent toujours de la méthodologie scientifique, les autres d’opinions philosophiques férocement opposées (sans compter les querelles de personne qu’il faudrait laisser au vestiaire). Et, par conséquent, nous ne dirons pas qu’être libre est facile, mais il faut comparer les situations : en France nous sommes libres, et par conséquent nous avons un devoir de responsabilité.
Méthodes
Donc, il arrive aujourd’hui à la linguistique l’aventure qui est arrivée à ses grandes sœurs : les sciences naturelles. Elle passe du classement des faits, tels qu’ils apparaissent à l’œil nu, à des théorisations tellement efficaces qu’on se prend parfois à espérer (ou craindre) qu’elles dévoilent la réalité.
Évoquez, pour comprendre, l’image de l’entomologiste du XIXe siècle, à quatre pattes au-dessus de sa fourmilière en train de noter tout ce qui s’y passe ; ou celle du naturaliste embarqué avec le capitaine Cook, cherchant les espèces rares ; ou encore celle des savants tout gris dans les muséums classant, sur des étagères, les échantillons reçus.
… Et aujourd’hui, l’écologie (on a commencé par cette comparaison), science des systèmes vivants en inter-relations qui commence à avoir des applications pratiques.
Idem pour la météorologie qui grignote les jours de prévisions exactes à coups d’ordinateurs.
Pour ne rien dire de la prodigieuse aventure de la physique nucléaire. L’atome, personne ne l’a vu et personne ne le verra. La représentation qu’en ont les physiciens est totalement mathématique et les formules qui expliquent et prédissent n’ont été construites qu’à coups de « si … alors ».
Si ce proton en avait deux (quarks), alors Y. Oui, mais si Y était Z, alors truc-machin. Truc-machin, vous avez dit truc-machin ? Expérience. Boum ! Bravo, vous avez gagné, ce proton en avait deux.
Eh bien, entendez bien la nouvelle évoquée plus haut : les linguistes se sont mis aussi à « l’hypothético-déductif ». Boum ! Enfin presque ! Mais confiance, elle arrive la traduction automatique presque fiable. Pas celle qu’on lisait sur certains produits commerciaux et qui faisait rire, mais celle dont on peut déjà profiter sur google.
… Pour la réforme de l’orthographe, on attendra encore un peu. Quelques-uns osent encore s’en préoccuper, des fous solitaires, que la souffrance des enfants révolte, et qui turbinent dans leurs tanières ; ou des groupuscules de citoyens autour de quelques savants généreux qui essaient d’être rigoureux (nous avons déjà parlé d’eux).
… Pour la pédagogie, la démagogie suffira pendant encore quelques décennies.
Donc, foin de modestie, « engagez-vous » (vous en savez assez déjà pour vous « indigner »).
Cependant, Citoyens, nous ne saurions trop vous recommander d’être vigilants car, à l’évidence, les travaux vont devenir rigoureusement incompréhensibles aux profanes (voir plus loin), et ce ne sera pas une raison suffisante pour faire confiance aveuglément, parce que ce n’est pas seulement aux savants que vous avez affaire. Les ingénieurs, parce qu’ils connaissent les lois de l’aérodynamisme, construisent des objets volants : ça ne signifie pas que Boeing est un canard sauvage.
C’est le moment de chercher secours philosophique.
Philosophie (des sciences humaines)
Il n’est pas un savant qui n’ait, comme tout un chacun, ses petites idées à lui derrière la tête.
On tiendra compte ici essentiellement de l’attitude culturaliste et de l’attitude structuraliste qui peuvent s’interpénétrer et s’interpréter de différentes manières.
La première considère comme primordial le fait que l’homme nait dans la culture et non directement dans la nature comme les animaux. Un homme n’existe pas hors d’une culture humaine, d’une civilisation, d’un pays, d’une époque, d’un milieu, d’une famille. Et l’humanité ne peut survivre que grâce à la culture, synthèse des connaissances accumulées que chacun de ses membres doit assimiler en tout ou partie pour que l’aventure continue. Ces connaissances culturelles sont, d’une certaine façon, même quand elles sont des mythes, toujours des connaissances vraies puisqu’elles permettent que « ça » tourne. C’est dans la pratique qu’elles ont été mises au point, elles sont nées du travail et des efforts intelligents des hommes pendant des générations et des génération. Pour survivre. C’est la seule raison qui explique qu’elles soient opérationnelles.
La langue peut être définie comme un de ces produits culturel. À bien prendre, ce n’est pas autre chose qu’un outil fabriqué. Le merveilleux outil de la communication et de la pensée dont le réglage continuel exige les tâtonnements obstinés et quotidiens des millions d’êtres humains communiquant ensemble dans leur(s) langue(s).
Si, demain peut-être, au lieu d’un savoir-faire empirique, on avait une connaissance scientifique de la langue, aussi précise que celle qu’on a de l’atome, quelle efficacité merveilleuse cela ne nous donnerait-il pas ! En attendant, préservons l’outil concluent aussitôt certains conservateurs lucides (les autres ne méritent que le mépris). Pour les culturalistes conservateurs (et les marxistes sur ce point ne disaient fondamentalement rien d’autre), le slogan utile est : ne touchons à rien, parce que l’humanité avance, non sans déchirements, mais avance ! Et la langue n’est pas à l’ordre du jour.
La seconde n’a rien à voir directement avec la notion de structure linguistique. Il s’agit de la désignation d’un courant de pensée qui, par contre, s’est inspiré des enseignements de la linguistique « structurale ». On peut isoler une idée particulière dans ce courant qui s’oppose à « l’optimisme culturaliste » : il s’agit du degré de « liberté » d’évolution des sociétés (sinon des individus) en fonction d’une « nature humaine » qui la limite.
«
Par delà l’image consciente et toujours différente que les hommes forment de leur devenir [il y a] un inventaire de possibilités inconscientes qui n’existent pas en nombre illimité.
»
— Levi-Strauss
Un culturaliste optimiste sursaute quand il entend ça. Quoi ! l’histoire serait un éternel recommencement et il y aurait des limites naturelles au progrès de l’homme ? L’homme serait coincé dans sa «nature humaine » ? « Il n’y a pas de nature humaine », les vieux ont été bercés par cette assertion pendant un bon moment du XXe siècle.
Aussi, lorsque Chomsky émet l’hypothèse de structures linguistiques innées, il a beau être le meilleur homme du monde, champion des droits civiques et de la libertés des opprimés, il provoque des réactions vives. Mais nous, d’avoir peut-être sous le crâne une boite noire préfabriquée pour classer, dès vingt mois, « les parties du discours » qu’est-ce que cela peut nous faire ? Si ça nous permet « d’apprendre la grammaire » avec moins de souffrance à l’école, schtroumph de schtroumph quelle aubaine !
Voire !
Relisons ce que dit Jakobson à propos de la grammaire en tant qu’obligation sémantique (ch.4). Chomsky, dans ses premiers travaux sur un modèle mathématique de la compétence, distinguait une partie sémantique et une partie grammaticale et, très grossièrement, on aurait presque pu dire que, dans sa machine, le module grammaire produisait des phrases grammaticales mais vides de sens, tandis que d’autres composants de l’ordinateur remplissait ces formes vides avec du sens, puis avec des phonèmes pour que les énoncés puissent sortir intelligibles et acceptables par la bouche-micro. Or, après discussions serrées entre linguistes, il lui fallut affiner un peu. La composante sémantique a dû reculer dans les profondeurs. La voilà installée au poste de commande (on s’en serait douté!) d’un langage profond, fondamental, très intelligent qui permet la pensée. Et même le langage servirait d’abord à penser avant de servir à communiquer (cf les dossiers de La Recherche, aout 2012) … Avec la même quincaillerie innée ? Brrr ! ça sent le métal hurlant !
Entre « l’âme» mystérieuse et les « limites potentielles de la liberté dans l’espèce», faites votre choix.
En tout cas, en psycho-neuro-linguistique, rien, pour l’instant, n’est conclu. Il ne faut pas s’affoler, mais il faut avoir l’œil. Les avoir à l’œil. Pas les savants, mais ceux qui sont toujours prêts à utiliser leurs découvertes, les profiteurs de tout poil de tout ordre admis.
Le scientifique, comme tout le monde, a ses préférences politiques et morales. Il sait qu’il doit se méfier de lui-même, mais son boulot est précis. S’il est générativiste, voici son projet :
définir A pour obtenir B
A : un ensemble fini de règles de type mathématique → le développement de ces règles dans les circuits logiques d’un ordinateur (ou dans notre cerveau conçu comme un ordinateur : une « machine grammaire ») → l’ensemble infini des phrases prononçables dans une langue donnée : B
Comme B doit correspondre, à la sortie, avec tous les phénomènes observés, il a du pain sur la planche. Par exemple, ces phonèmes qui n’ont de rôle distinctif, quand ils l’ont encore, que pour certains mots. Alors, ils ne sont pas phonèmes selon la définition ; on parle d’eux en tant qu’archiphonème. Dans les zones non-distinctives, d’autre lois se mettent à jouer, très intéressantes : pression articulatoire pour assouplir la parole, identification de sens pas forcément stupide (exemple net/è/ → n[è]ttoyer- la norme voudrait /é/) ou récupération sociale pour placer un « accent » d’originalité. C’est l’accent de Marie-Chant[â]l qui ne se doute pas qu’elle fait la poubelle d’un archiphonème quasiment décédé. Mais nos accents à nous, diversement populaires, relèvent exactement des mêmes lois, et par conséquent nous n’avons pas à en rougir ; quand nous savons à quel point ils sont véniels et à quel point ils sont identiques dans leur nature à ceux d’autres individus mieux socialement situés.
Le savant, lui, poursuit son labeur d’utilité pratique pour la traduction automatique et la reconnaissance vocale.
« Voyons, voyons, se dit le linguiste programmateur, nous allons produire le phonème /x/ : que dit le phonéticien ?
- J’ai observé que /x/ se prononce [y] quand il est situé entre truc et machin mais [z] après scoubidou et [v] quand le capitaine a 55 ans.
- Carte perforée s’il vous plait (c’est par nostalgie ; de toute façon, ce travail est hors du temps) ;
| /x/ | -> | truc y machin |
| -> | scoubidou z | |
| -> | v/ le capitaine a 55 ans |
Exécution
Quelque temps plus tard :
Mon cher, un de mes informateurs m’a signalé qu’il connaissait plusieurs capitaines de 55 ans qui prononçaient [w].
Ah ! Il faut revoir.
Nous disons : /x/ → quatre allophones … ». (Le savant est bien content aujourd’hui d’avoir un ordinateur.)
Laissons travailler les savants. Imaginez plutôt ces savoirs et les pleins pouvoirs entre les mains d’un maniaque de la pédagogie. Voire d’un réformateur de l’orthographe résolument révolutionnaire, partisan d’une écriture absolument phonétique. Mais pour qu’elle soit la même dans toute la France, il n’y a pas d’autre solution que d’unifier les prononciations. C’est tomber de Charybde en Scylla. On simplifie de façon radicale l’orthographe et on décrète l’orthoépie (la« phonétique normative ») d’urgence nationale … Si, si, ce réformateur existe : fréquentez internet.
Si l’on veut chercher vraiment secours dans la linguistique, comment traiter le problème des variantes et des nuances qui est le seul problème, à vrai dire, qui concerne directement les usagers ?
Prenons un exemple simple et tranquille de première articulation (il y a 60000 mots dans le Petit Robert, un exemple lexical sera moins chaud que le doute méthodique sur un phonème douteux parmi les 36 phonèmes officiels) : « tifs » et « cheveux ». « Tif » a un indice de classement dans les registres de langue, c’est « familier », dit le dictionnaire ; mais comme on n’est pas toujours en train de l’ouvrir, on se dit que ça peut facilement glisser vers « populaire » et « vulgaire » . C’est comme « patate » et « pomme de terre ». Vous connaissez la blague québécoise : avant, au Québec, on était pauvre, mais on avait sa dignité. Tous les jours de la semaine on mangeait des patates, mais le dimanche, alors là, petits plats dans les grands, on mangeait des pommes de terre.
Dans la classe ouvrière (pardon ! « populaire »), la liste des interdits est rangée dans un tiroir avec les papiers de la sécu. Elle est plus ou moins longue selon le « retard scolaire » des parents, mais elle est nette et sans bavure. Parce que, dans la classe populaire, on n’a ni le loisir ni l’occasion de pouvoir se dire : « Oh, ciel, j’aurai dû prononcer ce /un/ là en tordant un peu plus le museau. J’ai encore oublié, quel dommage ! Mais ma foi tant pis ; et tiens, puisqu’on en est là, je vais suggérer aux potes qu’ils laissent tomber. » (cf ch6, lectures sur « le parler du roi »)
Les « registres de langue », c’était une idée pédagogique intelligente et généreuse, pleine de lumière, mais quelle mauvaise plaisanterie dans la concurrence des classes sociales !
Ceci étant, il faut cesser de vivre avec la menace de ses fautes de français dénoncées par le voisin, d’autant plus teigneux qu’il se sent lui-même précaire.
C’est pourquoi on va poursuivre un peu ce chapitre. Et en offrir quelques autres.
Lexique
Génératif, grammaire générative
Le mot est emprunté aux mathématiques.
Il s’agit toujours de construire un « modèle » de la langue, mais de la même façon que les physiciens doivent construire un modèle de l’atome, d’après ce qu’ils savent à son sujet, mais sans jamais, et pour cause, l’avoir vu.
Ce modèle n’est donc pas la réalité elle-même, mais une construction de l’esprit capable, et là les opinions divergent :
- soit d’expliquer réellement ce qui est caché ; de « dévoiler » la réalité cachée,
- soit, du moins, d’en savoir juste assez pour prévoir ses effets. Mais en ignorant ce qui est caché « au fond » (par exemple, on peut prévoir les heures de lever et de coucher du soleil en s’imaginant que c’est lui qui tourne autour de la terre. L’explication est fausse, mais les règles de prédiction sont à peu près justes. Elles seront beaucoup plus précises quand, en ayant changé de conviction, on calculera autrement. Mais il restera de minuscules incertitudes que la « relativité » d’Einstein permettra d’affronter ; laquelle actuellement est remise en cause. Etc.)
Ces notions concernant la démarche hypothético-déductive sont indispensables pour se représenter ce qu’on appelle une grammaire générative. C’est une « machine-grammaire », c’est-à-dire, ni plus ni moins, une programmation d’ordinateur.
Le problème linguistique proprement dit reste cependant parfaitement clair : il s’agit de rendre compte du fait que les règles d’une langue permettent d’énoncer tout ce qu’on veut, une infinité de phrases. Les règles elles-mêmes ne pouvant être en nombre infini.
Le problème de la constitution d’une machine-grammaire (modèle scientifique de la langue) est donc de formuler un ensemble fini (limité) de règles capables de produire automatiquement des phrases de la langue et seulement des phrases de la langue (pas du charabia).
Éventuellement, on pourra découvrir après coup que ces règles sont celle du cerveau. Mais ce n’est pas du tout obligatoire. Le fonctionnement du cerveau reste encore fort mystérieux malgré les progrès actuels des neurosciences rendus possibles par l’imagerie cérébrale. Des savants neuro-linguistes y travaillent actuellement avec acharnement. Comme ce sont aussi des citoyens généreux, ils publient des livres de vulgarisation (voir la liste ch 6).
Mais terminons-en avec la méthode hypothético-déductive.
| Règles | Phrases de la langue | |
|---|---|---|
| ensemble fini, mis au point par le linguiste |
---------------------> | ensemble infini |
Et profitez-en pour prendre bien conscience de la rupture que cette notion introduit dans l’idéologie dominante en matière de langage. C’est absolument anti-nomenclature. Pour prétendre accéder à la dignité d’être humain pourvu d’une langue, il n’y a pas lieu de se présenter à l’examen avec un bagage de façons de dire apprises par cœur (toutes les « phrases correctes » de la langue et tous les « mots précis » du dictionnaire). Tout être humain est pourvu de règles génératives, ou alors c’est un débile profond comparable, pour ce qui concerne le langage, aux animaux, lesquels, ainsi qu’on l’a vu, sont seulement pourvus (exceptés un peu nos cousins les grands singes) d’un catalogue de signaux adaptés aux comportements les plus habituels de leur vie en société.
Tout être parlant possède une langue, et celle-ci dispose de la capacité que définit Jakobson : « Toute expérience cognitive peut être rendue et classée dans n’importe quelle langue existante ». Et si cet être parlant n’utilise couramment que 2000 mots de vocabulaire, en cela il ressemble à Racine qui écrivit toutes ses tragédies avec un stock équivalent .
… Mais pas composé des mêmes mots évidemment, puisque l’expérience du monde de Racine et celle d’une « racaille » d’HLM sont différentes. Nous excluons, bien sûr, le facteur diachronique qui a pu remplacer un terme par un autre, nous pensons à des différences de paradigmes, et pas seulement aux paradigmes du fameux « concret » auquel serait réduit la pensée des jeunes pauvres (des marques et des types de motos au lieu de grands sentiments). Ainsi, Racine n’a pas besoin d’un stock de mots pour exprimer les nuances de la fuite sous menace, mais pour les tragi-comédies du samedi soir, c’est absolument nécessaire : barre-toi, tire-toi, casse-toi, dégage … Et c’est ainsi que deux mots français-pas français peuvent se retrouver au premier plan de l’actualité et même sur les télés du monde entier.
Évidemment, ceci n’exclut pas qu’un « jeune » de banlieue gagnerait à élargir un peu son champ référentiel et, partant, son vocabulaire actif. Par exemple : classe ouvrière, capitalisme, compromis historique, révolte anarchisante, et passage à l’acte psychotique. Ce ne serait pas pour lui du luxe, quoi qu’il en pense.
Mais pas plus que : système synchronique, phonèmes (et non sons), activité métalinguistique … pour un enseignant de gauche honnête et consciencieux.
Ils ont tous une grammaire largement commune (à proprement parler, celle du français), et tout à gagner à ne pas faire semblant de ne pas se comprendre. Au moins après la classe.
Universaux linguistiques
L’hypothèse de Chomsky selon laquelle on ne peut expliquer l’apprentissage précoce et rapide du langage qu’en postulant l’existence dans le cerveau d’un mécanisme grammatical inné propre à l’espèce humaine a fait l’objet de recherches précises.
Les savants se sont intéressés, en particulier, aux langues créoles, des langues neuves où l’on peut saisir, en quelque sorte, les lois « naturelles » du langage à la source. Hagège, dans son livre « l’homme de parole », parle de « laboratoire créole ».
Ces savants ont démontré que les structures grammaticales des langues créoles étaient étrangement communes, quelles que soient les populations plus ou moins disparates qui les avaient créées.
Chomsky recherche des « universaux de langage » innés ; alors que, pour Hagège, les grammaires se révèlent semblables parce que ce sont les plus commodes qu’on pouvait inventer et non parce que les cerveaux des inventeurs étaient « pré-cablés ». Les inventeurs ont tout simplement, en triant dans la pagaille linguistique mise en place par l’esclavagisme, choisi les lois les plus efficaces d’un code commun, des outils simples « à leur main » (c’est à dire à leur … langue). Ceci en deux générations à peine, ce qui n’est déjà pas mal pour des « sauvages » déracinés et réduits à la condition de bête de somme.(vous pouvez lire ce que pense Chomsky et ce que pense Hagège dans «Les dossiers de La Recherche » hors-série aout 2012).
Mais Hagège dit plus. De ces lois choisies parmi d’autres dans le bazar et réarrangées en grammaire par des esclaves bricoleurs, il affirme qu’elles sont les plus efficaces, non parce qu’elles sont rudimentaires, au contraire, parce qu’elles sont les plus essentielles.
C’est un véritable retournement de perspective. Nous nous étions posé la question d’une qualité grammaticale supérieure éventuelle des langues dites de « culture ». Hagège, lui, émet l’hypothèse que les langues présentent des règles diverses en proportions diverses, mais que certaines de ces règles sont plus importantes que d’autres. Il les appellent « traits dominants » par comparaison avec ce qui se passe dans la sélection des espèces vivantes. Et ces traits dominants ont un avantage sélectif.
Question : l’anglais international, dénigré comme « broken english » (un vrai sabir, mais qui permet quand même d’échanger des notions scientifiques ou politiques, excusez du peu !) est-il riche lui aussi en « traits dominants » ? Martinet, dans « le français sans fards », soulignait déjà l’efficience d’un anglais sans complexe au regard du français des puristes. Le triomphe de l’anglais ne serait pas seulement dû à la suprématie américaine. La vie qui ne se met pas à l’écart des grands axes d’échanges socio-économiques ne serait-elle pas en train de trancher de l’efficience linguistique ? Après le « laboratoire » créole, celui de la « jet society ».
Par contre, aucun espoir pour un « laboratoire HLM ». Pas pour des raisons misérabilistes, mais parce que jamais plus on ne laissera les esclaves se débrouiller seuls avec leurs problèmes linguistiques.
On y perdra en qualité.
Ni Martinet ni Hagège ne rendront la parole aux pauvres, mais ils permettent quand même de jeter un autre regard sur l’aliénation. On voit les enjeux considérables de leurs discussions savantes :
- philosophiquement et moralement, tant chez Chomsky que chez Hagège, les capacités langagières « universelles » mettent à mal le racisme et le racisme social.
- Techniquement, le jour où l’on connaitra vraiment les mécanismes linguistiques universels, on pourra espérer les maitriser selon des fins humaines.
Lecture
La traduction automatique
Notre référence sera un numéro spécial de La Recherche d’octobre 85 (numéro spécial consacré à « l’intelligence artificielle » - on peut le trouver encore en vente sur internet).
Le texte sur la traduction automatique est difficile à lire, mais ce n’est pas pire que ses illustrations. L’important est de constater que la technologie, près de 30 ans après, a fait évidemment de grands progrès, mais il n’y a pas eu de révolution. La Recherche vient de publier dans son n°spécial de juin juillet 2013 (particulièrement consacré aux « particules élémentaires) un dossier linguistique de 17 pages qui confirme : les robots ne remplacent pas l’homme. En 1985 on le prévoyait. Toutefois ils donnent à l’homme des pouvoirs qui peuvent devenir terrifiants. Dans Le monde diplomatique de juillet 2013, on explique la montée en puissance actuellement constatée de big brother :
« Au lieu d’apprendre à un ordinateur à exécuter une action, comme conduire une voiture ou traduire un texte – objectif sur lequel des cohortes d’experts en intelligence artificielle se sont cassé les dents durant des décennies -, la nouvelle approche consiste à le gaver d’une quantité d’informations suffisante pour qu’il déduise la probabilité qu’un feu de circulation soit vert plutôt que rouge à chaque instant, ou dans quel contexte on traduira le mot anglais light par « lumière » plutôt que par « léger » (article : « Au-delà de l’espionnage technologique – Mise en données du monde, le déluge numérique »). Ceci ressemble étrangement au mode de raisonnement analogique et statistique dont est précocement équipé le cerveau humain : « Des découvertes récentes en sciences cognitives indiquent que très tôt, avant même l’apparition du langage (soit avant deux ans), les bébés font déjà des statistiques pour comprendre et anticiper les événements qu’ils perçoivent. »(La recherche, juillet-août 2013, n° spécial cerveau, p46). Ce mode de raisonnement est pratique et efficace, banal et habituel …, mais éventuellement faillible quand on s’obstine toute sa vie à vouloir s’éviter les exigences de la raison. Quoi qu’il en soit, ces découvertes permettent aussi de réfléchir à ce qu’est la compétence linguistique, et ce qu’elle ne peut pas être : un « gavage » de mots sans référence et sans chaleur qui ne permettront pas de faire mieux que des machines.
Sans trop vouloir approfondir (et pour cause), voici un résumé de ce que chacun peut comprendre. En remerciant, au passage, ces revues scientifiques ou politiques de nous préparer à l’avenir. Si nous le voulons.
Voici ce qu’on théorisait et anticipait en 1985 :
1- La science avance :
« Pas de miracle en vue » ; « Mais le pessimisme n’est pas non plus de rigueur. »
« La maitrise du langage a depuis toujours été considéré comme une pierre de touche pour l’intelligence. L’informatique apporte à ce problème ancien un éclairage nouveau. »
Quel stupéfiant éclairage en effet ! Et, au regard, la recherche pédagogique révèle son incommensurable médiocrité. Bien entendu : où est le fric ? On appelle ça le pilotage de la recherche par l’aval.
2- Pour avancer dans la direction imposée, pour rendre leurs ordinateurs « intelligents », les informaticiens sont obligés de sortir d’une conception mécaniste de la pensée. L’école linguistique dite pragmatique (cf lexique ch 11) est donc appelée à la rescousse. Les notions qu’elle propose sont d’ores et déjà nécessaires pour construire des programmes un peu efficaces.
Ce qui est remarquable, et encourageant pour les plus humbles pratiquants du langage, c’est que ce sur quoi achoppe encore la technologie la plus formidablement en pointe, ce soit la mise en œuvre des connaissances (et de l’intelligence) « d’un lecteur moyen ».
Donc, faites confiance à nos vrais savants et écartez de votre vue ceux qui dégoisent sur la misère langagière des pauvres.
Allez vérifier aussi combien ces prédictions scientifiques étaient pertinentes et quels progrès réels ont été faits. Mettez-vous sur [google→traduction] et tentez une expérience : phrase française → traduction automatique dans une autre langue → cette traduction retraduite en français. Le résultat est parfois cocasse, mais généralement époustouflant.
Ce qui suit n’est qu’un court extrait de l’article en 85 de Daniel Kayser consacré aux « machine qui comprennent notre langue ». Il commence par un schéma sur deux pages (qui, dans le numéro de La Recherche, se font face). C’est dans l’article la « figure 3 ». Le texte en dessous qui le commente est un bon résumé de l’ensemble des questions traitées dans l’article. Mathématique « moderne » et linguistique à l’œuvre ; ce que l’enseignement public obligatoire et gratuit avait rejeté.
«
Figure 3. Un système de compréhension des langues naturelles doit, par décomposition et analyses successives, transformer la demande initiale en une formule censée en exprimer le sens. Après avoir été soumise à l’analyseur morpho-syntaxique qui détermine quels sont ses mots et sa structure, chaque phrase subit un traitement sémantique; il n’est pas possible d’expliquer techniquement ici le procédé par lequel l’arbre syntaxique est construit, ni la façon dont des « morceaux » de programme sont associés aux règles de grammaire, de façon à provoquer la construction progressive de la formule. On s’est borné à donner des " photographies " du traitement syntaxique (achevé) et du traitement sémantique (à différents stades). La séquence qui fait passer de la phrase à la formule du « sens » est appelée par les informaticiens « phase de compréhension ». Elle est suivie d’une phase d’exécution qui confronte cette formule aux données stockées dans la machine, et qui permet d’élaborer une réponse.
La " formule " est exprimée ici en logique des prédicats du premier ordre, qui est la forme de logique de loin la plus utilisée par les informaticiens. Elle signifie, en clair : " compter les éléments x de l’ensemble tel que : — chaque x ait la propriété de se trouver en France, — chaque x ait la propriété d’être une région, — pour chaque x, il existe un élément y tel que : — y ait la propriété de se trouver dans x; — y ait la propriété d’être une ville; — y ait la propriété d’avoir une population supérieure à celle du chef-lieu de x. La dernière étape nécessaire au processus de compréhension, l’étape pragmatique, qui tient compte des conventions du discours, est rarement intégrée dans les programmes actuels. Elle devra dans l’avenir être prise en compte par les " machines à comprendre " des textes, mais les problèmes qu’elle pose sont extrêmement complexes.»
— Daniel Kayser, article de 1985 de "La Recherche"
Les extraits de l’article qui suivent sont consacrés à « l’étape pragmatique » qui « devra dans l’avenir être prise en compte par les « machines à comprendre » des textes, mais les problèmes qu’elle pose sont extrêmement complexes ».
L’étape pragmatique
«
La dernière étape que nous allons envisager maintenant, l’étape pragmatique, est rarement intégrée dans les programmes actuels, c’est pourquoi nous ne l’avons pas citée parmi les quatre étapes standard des systèmes de compréhension. Elle cherche à modifier le résultat de l’analyse sémantique par la prise en considération d’éléments extérieurs au texte analysé. L’exemple classique, « Pouvez-vous me dire l’heure qu’il est ? », est une question qui, au sens propre, appelle une réponse par oui ou par non. Les conventions sociales, qui déconseillent les formes trop impératives du type « Dites-moi l’heure qu’il est ! », conduisent tous ceux qui entendent cette question à en modifier le sens, sans même qu’ils s’en rendent compte et à l’interpréter comme une manière polie de demander l’heure.
L’intérêt porté à la pragmatique dans le problème de la compréhension, s’il n’a pas débouché sur de véritables solutions, a eu le mérite de mettre en lumière un point important. Le texte à comprendre n’est que « différentiel » : l’auteur n’exprime pas une situation, il exprime la différence entre la situation qu’il veut décrire et celle qu’il sait que le lecteur connaît déjà. Toute « machine à comprendre des textes » digne de ce nom devra donc posséder les connaissances générales du lecteur moyen auquel les textes sont destinés. Pour cela, elle devra être capable de faire des inférences à partir des données qu’on lui fournira. Considérons un exemple cité par J. Pitrat : « Le professeur envoya l’élève chez le censeur parce qu’il voulait …
… lancer des boulettes. » (« il » = l’élève)
… avoir la paix. » ( « il » = le professeur)
… le voir. » (« il » = le censeur, « le » = l’élève)
Il apparaît que la compréhension de cette phrase, même au sens propre, est impossible sans avoir recours à un puissant mécanisme inférentiel. En effet, on ne peut pas s’attendre à ce que le concepteur d’une « machine à comprendre » fournisse à l’ordinateur toutes les connaissances nécessaires sous forme directement exploitable. Dans le cas d’espèce, il aurait fallu penser à écrire : « Un élève peut lancer des boulettes. », « Un professeur ne peut pas lancer des boulettes. », « Un censeur ne peut pas lancer des boulettes. », ce qui est non seulement irréaliste … mais faux !Les inférences au cœur de la compréhension.
La seule solution viable consiste à déclencher des raisonnements à partir de connaissances beaucoup plus générales. Chacun sait que :
« Il est (malheureusement) usuel que les élèves s’ennuient en classe. »
« Une personne qui s’ennuie peut chercher à se distraire. »
« Un élève qui se distrait en classe risque une punition. »,
etc.
Sur la base de ces connaissances, et de bien d’autres du même style, le lecteur est capable de comprendre des textes comme l’exemple de Pitrat, de même que la plupart de ceux qui concernent des espiègleries scolaires. Mais il ne peut le faire que s’il est capable de combiner ces connaissances pour en inférer de nouvelles, qui dépendent du texte à comprendre.»
— Daniel Kayser, article de 1985 de "La Recherche"
Pour qu’il comprenne, il faut donc respecter le lecteur.
«
Une distinction importante entre l’approche classique et l’approche « à profondeur variable » consiste à considérer, dans ce dernier cas, que les mots peuvent renvoyer simultanément à plusieurs objets, plus ou moins précisément définis. Cette constatation n’a pas la prétention d’être originale; mais elle justifie que l’on doute de la réductibilité de la compréhension à un raisonnement logique, quel qu’il soit. Ceci n’exclut pas que l’on puisse construire un système formel répondant aux spécifications de la profondeur variable, mais il serait abusif de qualifier un tel système de « logique », car les notions de validité, de complétude et de cohérence, qui sont au cœur de la démarche des logiciens, n’y auraient que peu d’importance.
Pas de miracle en vue.
Même si le déroulement des recherches dans le domaine qui nous occupe n’a jamais été un exemple de rationalité (voir l’historique des travaux en traduction automatique de Makoto Nagao, La Recherche, n° 150, p. 1530, 1983), on en est arrivé à un stade où l’on distingue bien ce qui est possible de ce qui ne le sera que dans fort longtemps. Qn parle plus volontiers maintenant d’« outils d’aide à la traduction », tel Ariane 78 (voir La Recherche, n° 1S0, p. 1536, 1983 ou La Recherche, n° 103, p. 912, 1979) que de traduction entièrement automatisée, ou encore d’« interfaces en langage naturel » (voir des produits comme Lifer ou Intellect aux Etats-Unis, ou comme Saphir et Spirit (fig. 2 et 4) en France) plutôt que de robots qui comprennent tout. D’une manière générale, les logiciels que l’on trouve actuellement sur le marché sont utiles si l’on songe aux services qu’ils peuvent rendre à des utilisateurs non initiés aux langages informatiques. Il ne faut cependant pas se leurrer sur leurs capacités : ou bien leur « compréhension » est très limitée (Spirit) ou bien elle est fine, mais alors le domaine d’application est minuscule (tous les autres systèmes).
Cet article a voulu montrer pourquoi, malgré des proclamations parfois excessives, il ne fallait pas s’attendre à des résultats miraculeux. Mais le pessimisme n’est pas non plus de rigueur : les progrès dans ce domaine sont et resteront assez lents, mais ils sont continus, à la fois sur le plan des améliorations techniques (analyseurs morpho-syntaxiques, raisonneurs déductifs, stratégies de raisonnement) et sur le plan théorique (méthodes de représentation des connaissances, modélisation des processus d’inférence). Les informaticiens sont conscients qu’ils ne doivent pas se lancer seuls dans l’aventure, d’autant que des éléments essentiels ont déjà été dégagés par d’autres disciplines, au premier rang desquelles la linguistique, la logique mathématique, la psychologie cognitive, mais peut-être aussi la philosophie et les neurosciences.
Cette communauté d’intérêt autour des problèmes de représentation et d’utilisation des connaissances préfigure-t-elle une réorganisation des champs disciplinaires ? Il serait prématuré de l’affirmer, mais cela n’est certes pas exclu. Il est significatif de constater que cette importante convergence entre des recherches initialement fort éloignées s’opère à propos d’une question « sensible » entre toutes; en effet, la maîtrise du langage a depuis toujours été considérée comme une pierre de touche pour l’intelligence. L’informatique apporte à ce problème ancien un éclairage nouveau, mais il est ridicule de prétendre qu’elle le résoudra : ce n’est bien sûr pas le genre de problèmes qu’il faut s’attendre à voir un jour « résolu », c’est plutôt une question qui peut servir de levier à une modification profonde de nos conceptions et, comme souvent dans les sciences, le vocabulaire même dans lequel nous la formulons sera bientôt considéré comme dépassé.
»
— Daniel Kayser, article de 1985 de "La Recherche"
Débranchez-les !
[modifier | modifier le wikicode]
Et pendant ce temps-là …
… Pendant que les savants dévoilent la réalité,

voici, extraites d’un vieil opuscule publicitaire d’électroménager (à côté des codes téléphoniques et de la liste des centres antipoisons), des pages témoignant d’une préoccupation populaire, banale et récurrente, concernant la norme.
La langue française est d’une extrême complexité. Chacun de nous s’exprime souvent très mal. Il nous a paru utile de corriger ici les erreurs qui reviennent le plus souvent dans notre langage. | |||
| Il ne faut pas dire : Partir en vacances Partir à Paris J’ai lu sur le journal Comme par exemple Je m’en rappelle Je reviens de suite La voiture à papa Descendre en bas Monter en haut On est arrivé Ce n’est pas de sa faute Je vais au coiffeur, au Docteur Au diable vert Il n’arrête pas de parler Il est furieux après vous Il a demandé après vous J’ai très faim, très soif Il a causé à son fils Il a parlé avec son fils Il parle français comme une vache espagnole |
Il faut dire : Partir pour les vacances Partir pour Paris, ou aller à Paris J’ai lu dans le journal Aussi par exemple Je me le rappelle Je reviens tout de suite La voiture de papa Descendre Monter Nous sommes arrivés Ce n’est pas sa faute Je vais chez le coiffeur, le docteur Au diable Vauvert Il ne cesse de parler Il est furieux contre vous Il vous a demandé J’ai grand faim, grand soif Il a causé avec son fils Il a parlé à son fils Il parle français comme un basque l’espagnol |
Il ne faut pas dire : D’ici la semaine prochaine Il a agi pareil que vous Il boit pire que jamais Aller de mal en pire Vous n’êtes pas sans ignorer En face la gare Il nous rabat les oreilles Je l’ai entendu de mes oreilles Nous entr’aider mutuellement Rêver à quelqu’un Nous avons convenu de partir ensemble Il est plus beau en naturel Quant à vous De manière à ce que Ce cheval risque de gagner Une occasion à profiter Il s’en est accaparé Je m’attends à ce que Dans la Seine et Marne Il a hérité d’une maison de son frère Je vais contacter M. Durand |
Il faut dire : D’ici à la semaine prochaine Il a agi comme vous Il boit pis que jamais Aller de mal en pis Vous n’êtes pas sans savoir En face de la gare Il nous rebat les oreilles Je l’ai entendu Nous entr’aider Rêver de quelqu’un Nous sommes convenus de partir ensemble Il est plus beau au naturel Tant qu’à vous De manière que Ce cheval a des chances de gagner Une occasion à saisir Il l’a accaparé Je m’attends que En Seine et Marne Il a hérité une maison de son frère Je vais prendre contact avec M. Durand |
| En public, au restaurant, chez des amis, ou ailleurs, une dame de qualité n’appelle jamais son mari « PAPA » sous prétexte qu’il est père de famille. Un Monsieur n’appellera jamais sa femme « MAMAN » parcequ’elle est mère de famille. « PAPY » et « MAMY » sont réservés au vocabulaire des petits enfants. | |||
| TÉLÉ-CONFORT LE GRAND SPÉCIALISTE DE L’ÉLECTRO-MÉNAGER | |||
On fait donc suivre un également vieux texte de Jean Dutourd de l’Académie française, qui tenait rubrique dans un journal populaire. Il s’adresse à monsieur Fillioud, ministre de la communication de Mitterand.
« Un mot qui meurt, c’est comme un soldat qui tombe. Un barbarisme c’est un traître, un membre de la cinquième colonne qui prépare le désastre final. Arrêtez la boucherie ! Vous êtes le seul à pouvoir le faire. Personne ne sait (et peut-être même pas vous) que vous êtes le personnage le plus important du cabinet actuel. Celui dont dépend la vie ou la mort de la France.[ …]
Mais aurez-vous la force d’être rigoureux ? Vous battrez-vous pour le bon usage avec autant de cœur que pour le socialisme? [ …]
Contrairement à ce que pense votre collègue M.Badinter, c’est avec des châtiments terribles que l’on empêche les hommes de commettre de mauvaises actions. Il faut proclamer la loi martiale quai Kennedy, rue Cognacq-Jay, aux Buttes-Chaumont, sinon vous n’arriverez à rien. Il faut instituer un tribunal d’exception, qui prononcera des peines effrayantes, allant de la mise à pied temporaire sans salaire jusqu’au renvoi définitif sans indemnités, pour faute professionnelle grave.
Il n’est pas admissible que des fonctionnaires de l’Etat disent « sophistiqué » pour « compliqué ». En français, sophistiqué signifie uniquement captieux ou faux. Un « sanctuaire » n’est pas un refuge, fût-ce un refuge inviolable, mais un lieu de culte. « Crédible », pris dans le sens de sérieux ou inspirant confiance, est une horreur absolue.
Autre abominations jargonnantes : « approche » pour examen ou abord (l’approche d’un problème) ; « déstabilisation » pour subversion ; « conforter » pour encourager, fortifier ; « sur le tas » pour à pied d’œuvre ; « se vouloir » pour prétendre ; « infrastructures » pour fondement ; « structure d’accueil » pour … je ne sais pas quoi. Et que penser d’« impensable » ? Je dirai, parodiant Napoléon : « Impensable » n’est pas français.[ …]
Il s’est établi à l’audiovisuel un usage de la forme interrogative à laquelle il me paraît nécessaire de mettre le holà. Cela consiste à supprimer l’inversion, en exprimant l’interrogation par le ton de la voix. « Venez-vous ? » devient ainsi « Vous venez ? ». Cela donne ces tournures élégantes : « Vous habitez où ? Vous faites quoi ? Vous partez quand ? » Le bijou, le chef-d’œuvre dans le genre, que j’ai entendu de mes oreilles, est : « Dieu, pour vous, c’est quoi ? »[ …]
Le président de la République lui-même, qui écrit un excellent français, n’est point à l’abri des miasmes insidieux de la caméra. Mes cheveux se sont dressés sur ma tête quand j’ai entendu sortir de sa bouche, lors de sa conférence de presse, le mot « opportunité » dans le sens d’occasion. Quoi, lui aussi ! le premier magistrat de l’Etat, le gardien de la Constitution, ai-je pensé avec désespoir. Dieu me pardonne, des idées de Haute Cour m’ont traversé la tête !
»
— Jean Dutourd, de l’Académie française
Évidemment, il ironise, c’est de l’humour. Mais le fond reste là. France Soir étant un journal populaire, ça ne pouvait pas faire de mal, sur cette question académique, que le lecteur moyen se demande confusément si c’est du lard ou du cochon. Surtout que l’agression est peut-être plus subtile que l’air qu’elle se donne. Puisque le lecteur moyen de France Soir est de toute façon incapable de maitriser ce français-là et qu’à la télé, évidemment, il ne prendra jamais la parole, Dutourd lui offre, au fond de son canapé, l’identification à l’agresseur. Il lui propose le plaisir pervers de jouer au crochet avec les maitres du langage, d’envoyer, en imagination, qui il voudra à la trappe sur un simple « mot magique » révélé par l’Académie (il en a forcément déjà dans la tête une petite liste). Cette terrible compensation est l’ultime perfectionnement nécessaire à l’outil terroriste (n’ayons nous non plus peur des mots) pour l’adapter à l’univers nouveau des médias où les humains peuvent avoir l’illusion d’abolir les distances géographiques et sociales. Ainsi, le pauvre sans culture reconnue continuera à se taire (et à laisser tomber le projet de citoyenneté), mais il pourra se défouler de façon hallucinatoire (et voter à droite).
Et voici, aujourd’hui, le livre de Julien Lepers déjà cité, « les fautes de français, plus jamais ». Le pauvre animateur télé l’a publié pour se faire pardonner tout le mal qu’il a pu faire en la matière. Les auditeurs à l’affut lui ont tiré dessus pendant des années et des années. Il fait mea-culpa et publie le « on doit dire, on doit pas dire » du XXIe siècle.
Dans une république souple, il faut toujours l’ordre et la loi, et donc - on n’a pas le choix - moins de coercition venue d’en haut et davantage de régulation venue d’en bas… Mais peut-être plus ces règlements de compte de cour de récréation entre grands, moyens et petits instruits. Sinon, on préfèrera bientôt être commandé encore par des cyniques dominants plutôt qu’insulté par des ignorants ou des imbéciles. Heureusement notre mentor audio-visuel, lui justement, résiste ; mollement, mais c’est quand même bon signe :
« Opportunité fait également renâcler les puristes. On devrait employer, préconisent-ils, occasion. Cependant, opportunité complète le sens d’occasion d’une nuance positive : une opportunité est une occasion positive. Pourquoi ne pas se contenter d’aubaine, me direz-vous ? Tout simplement parce qu’aubaine introduit une autre nuance : une aubaine est une occasion positive inespérée.
Si vous découpez dans les petites annonces une offre d’emploi conforme à vos espoirs et vos capacités, c’est une occasion : une chance à saisir.
Si l’on vous propose un poste conforme à vos compétences tout en vous annonçant que peu de candidats ont postulé, c’est une opportunité.
Si l’on offre une sinécure royalement payée à un fainéant que rien ne qualifie, c’est une aubaine.
On voit bien qu’aucun mot français ne recouvre toutes les nuances de opportunity, « opportunité ». Je vote donc pour qu’on l’adopte. »
— Julien Lepers, les fautes de français, plus jamais. p. 96
Mitterrand est donc réhabilité. Qu’on se le dise.
Ceci étant, opportunité/occasion continue son travail de persécution grâce à l’aide bénévole des puristes du canapé. Dans le courrier des lecteurs de télérama, on peut lire en septembre 2016, après une protestation contre une expression à vrai dire un peu ridicule : « le pire, c’est qu’à force d’être prononcée cette expression sera reprise par grand nombre de gens. C’est déjà le cas pour « opportunité » à la place d’ « occasion » ; à quand la « voiture d’opportunité » ? ».
Et encore, elle a de la chance, la puriste, de ne pas vivre au Québec où sa conscience linguistique serait encore plus mise à mal ; au Québec, quand on achète un « gâteau d’occasion », c’est pour des « grandes occasions » , anniversaires, mariages … Qui mettra de l’ordre dans tout ça ?
Il faut donc reprendre le dossier au plus près de l’actualité afin de comprendre pourquoi on peut y observer autant d’absurdités.
Les glissements de sens des mots sont insensibles et inconscients chez ceux qui les produisent. Et c’est tout le monde, même les cuistres. Nous pouvons, nous aussi, du fond de nos canapés, étudier la question pour nous gausser. Par contre, il sera important de prendre conscience que ces innovations langagières ne sont pas forcément innocentes.
Ainsi certains commentateurs politiques de gauche se sont mis à dénoncer, avec à-propos, la langue de bois en cours dans la politique économique. Des expressions, devenues banales, servent à faire accepter la soumission aux lois implacables du capitalisme :
Licenciement massif = plan social,
prélèvements sociaux = charges patronales
et concurrence universelle des travailleurs entre eux pour faire baisser les salaire et augmenter les revenus des pharaons de la finance = compétitivité.
Etc.
Ces « abominations jargonnantes », comme l’écrivait Jean Dutourd, devraient déclencher les foudres des adorateurs du français parfait. Silence radio ! C’est le cas de le dire.
Il est vrai qu’à gauche on n’est pas non plus à l’abri, et de longue date, des glissements sémantiques. Ainsi, depuis toujours, on y honnissait la charité cul-bénit : donc, on n’employait pas le mot charité quand la compassion imposait des actes concrets. Il en est résulté que « solidarité » est en train de se confondre avec « charité » ; ça veut dire : on donne aux pauvres. En linguistique, encore une fois, il n’y a pas de mal à ça ; ce n’est pas le premier mot qui perd son sens, ici malgré l’étymologie ; les mots changent de sens, c’est un phénomène naturel (on ne va pas tout ré-expliquer) ; et sur ce mot précis mal utilisé on peut s’entendre quand même : il y a donc désormais la « charité-cul-bénit » et la « charité-solidarité » de gauche. Le problème est qu’il manque un mot maintenant pour désigner ce qu’est la vraie solidarité. À moins que sa réalité soit également en train de disparaitre, hors du régime des contrats d’assurance individuels. Et ça, c’est bien plus grave !
Que disent les dictionnaires ?

|

|
| Charité | Solidarité |
| Résultat discret de l’amour du prochain | Solide contrat d’entraide obligatoire |
La charité, en attendant le monde parfait, est certainement aussi indispensable que la solidarité ; on n’en dira plus de mal, on respectera ceux qui ne voient plus comment faire autrement pour améliorer le sort des malheureux. On pourrait même nuancer, amalgamer et faciliter les démarches privées et publiques avec le mot « care » promotionnel (prononcer [kèr], c’est de l’anglais). Bref, charité et solidarité resteraient complémentaires avec d’autres désignations. Mais il ne faut pas les confondre, car« la morale est due quand l’amour fait défaut » (Comte-Sponville). La « solidarité-charité » produit une réflexion pratique biaisée (puisque, n’est-ce pas, on pense avec des mots et qu’il n’y a pas de pensée un peu élaborée sans langage). L’éradication de la pauvreté indigne ne relève plus, avec ces mots nouveaux, de l’instauration de droits (droit au logement, etc), comme le réclame depuis toujours ATD ¼ monde. Récemment encore dans un rapport sur « misère, violence et paix (à lire sur [www.atd-quartmonde.org/ La misère est violence]). Citation : « Les politiques qui visent à réduire d’un certain pourcentage la pauvreté sont elles-mêmes des violence car elles affirment dès le point de départ que tous ne seront pas concernés. » Ces politiques relèvent d’actes de compassion publique aléatoires, c’est-à-dire de « l’assistanat » comme le dénonce ensuite la Droite. Laquelle a des raisons objectives d’ailleurs de protester : des profiteurs et des voyous, il y en a partout. N’est-ce pas, la Droite ! …
Il ne s’agit donc pas d’avoir ou non pitié, mais de prendre ou pas des décisions politiques créant des droits légaux. Ceci dans le cadre d’un fonctionnement démocratique. C’est-à-dire en les soumettant au jugement du peuple actuellement en quête de boucs émissaires.
Pauvres élus !
Ici, pour nous, il s’agit simplement d’éclairer d’abord la pensée des mots.
Même la pensée inconsciente et apparemment débonnaire.
Un dernier exemple, pour une revendication féministe possible, au moins aussi valable que « l'écriture inclusive » :
| Masculin | féminin |
| garçon | fille |
| fils | fille |
| homme | femme |
| mari | femme |
- Il manque deux mots pour l'égalité.
Quand on prend conscience de ces malversations autour de la langue qu’on nous a dit parfaite, on ne peut qu’être très triste. Le sens des mots du « bon français » n’apparait plus du tout blanc-bleu et illuminé par l’étymologie. Mais on ne sombrera pas pour autant dans l’anarchie.
Et par ailleurs, la Culture reste désirable (pour se reposer un peu de l’obsession politique). On peut prendre un plaisir immense à découvrir l’histoire des mots : d’où ils viennent, comment et pourquoi ils changent, et changeront encore (diachronie), et ce qu’ils signifient pour les uns et les autres au moment présent (synchronie). On peut réfléchir aux divers « usages » et aux modes éventuellement passagères avec bonne humeur, comme le propose Alain Rey. Dans l’ouvrage récent qu’il vient de publier, nous trouvons, page 109, une gentille critique d’un usage inapproprié de « trop » au regard de « très » que « trop » se permet de remplacer dans la tchatche juvénile. Mais c’est cet emploi justement que le facétieux Alain Rey choisit comme titre de son livre. Peut-être pour attirer la clientèle visée. S’il réussissait ce serait un magnifique succès politique.
Que la jeunesse achète donc (ou se fasse offrir) « Trop forts les mots », le nouveau livre d’Alain Rey, afin que le pourcentage de cuistres vaniteux et égoïstes, qui forcément sortiront un jour de ses rangs, diminue substantiellement dans l’avenir autogestionnaire.
Pour résister aux cuistres réactionnaires, consultez Alain Rey, et notamment « À mots découverts, chroniques au fil de l’actualité » (Robert Laffont) où la nuance bienveillante enrichit la pensée, autorise à vivre et, en plus, ne paralyse pas la citoyenneté.
Lecture
Alain Rey « Le conflit des mots »
«
Choisir un mot, ce matin, ce serait choisir son camp. Le vocabulaire de la situation sociale évolue. Au centre, le mot grève, dont l’histoire est étrange, depuis les grèves de la Seine où l’on cherchait un emploi jusqu’à l’arrêt de travail démonstratif. Mais surtout, les mots qui l’accompagnent. Ils sont de deux sortes : d’un côté perturbation, du latin turbare, « agiter, troubler », galère, mardi noir, on vient d’entendre un auditeur dire nuisance, façons de dire qui expriment le point de vue des usagers et qui satisfont le pouvoir ; de l’autre, mobilisation, manifestation, revendication, selon les salariés. Reste le point de vue de la police, du genre lénifiant. On connaît ses évaluations contrastées : deux cent mille selon la police, un million selon les organisateurs.
Les métaphores suivent : raz de marée, tsunami, déferlante du côté des grévistes et des syndicats ; désordre, pagaille et chaos de l’autre. Quant aux économistes et aux sceptiques, ils ont tendance à soupirer ou à ricaner sur ces grèves qui sont le sport favori des Français. Conflit, la encore, entre le tout économique et le minimum social.
Ces affrontements de mots ne font que traduire ceux de la société. Mais ils expriment aussi un progrès. Il fut un temps, pendant des siècles, où les mots étaient tous du côté du pouvoir : ordre, désordre, révolte, émeute, et même rogne et grogne.
Aujourd’hui, les intérêts des travailleurs, des pauvres, des maltraités se disent et s’expriment dans un vocabulaire. Voyez mobilisation, qui concernait l’armée, le départ forcé pour la guerre, et qui traduit une action sociale ; ou bien revendication, qui n’était qu’un terme de droit. Devinez qui emploie le premier ce mot à propos d’une demande, d’une « revendication » sociale : c’est un socialiste, Proudhon — celui de « la propriété, c’est le vol » —, vers 1860
Car l’évolution des manières de dire, l’apparition du vocabulaire d’en bas, celui de la rue, dont le futur sénateur Raffarin disait qu’elle ne devait pas gouverner, a une histoire précise. Tout a basculé certes en 1789, mais surtout vers 1848, époque de révolutions en chaîne. C’est alors que socialisme, syndicat, prolétariat, ce dernier aujourd’hui un peu délaissé, prennent leur valeur actuelle. La lutte des mots a-t-elle relayé feu la lutte des classes ?
»
— Alain Rey, 4 octobre 2005, « à mots découverts », chronique au fil de l’actualité. Robert Laffont
L’ordre et la loi
[modifier | modifier le wikicode]
« Ce passage de l’existence (à la limite purement) biologique, à l’existence humaine (enfant d’homme), Lacan a montré qu’il s’opérait sous la Loi de l’Ordre que j’appellerai Loi de Culture, et que cette Loi de l’Ordre se confondait dans son essence formelle avec l’ordre du langage […] loi du langage, en quoi se fixe et donne tout ordre humain, donc tout rôle humain »
— Althuser, – Freud et Lacan. Dans « Positions », éditions sociales, 1976, p. 24, 25
La norme est « incontournable », mais la linguistique est quand même un sport de combat.
D’après tout ce qui a déjà été dit, vous vous doutez sans doute que cette vilaine question (ici traitée à part, une bonne fois, mais qui restera désormais obsédante au fil des pages qui vous restent à lire jusqu’à la conclusion) n’est pas simple. Je n’arrêterai pas de souffler le chaud et le froid.
Le signe, vous ai-je dit (les linguistes me l’ont appris), est arbitraire. « C’est comme ça et c’est pas autrement. » En plus, sa « valeur » réside dans le « système de la langue ». Il en résulte que lorsque l’on touche à un signe, on touche à tous les autres. Il en résulte des arrangement « écologiques » finalement harmonieux. Mais d’aucuns prophétisent des catastrophe en chaine, quasiment nucléaires, contre lesquelles ils mettent en garde en alléguant que si l’histoire passée raconte des changements continuels, le présent est caractérisé par un état parfait d’équilibre.
… Donc, autant se tenir tranquille et accepter l’usage recommandé.
Mais recommandé par qui ? … Vous le savez.
La langue cependant doit s’apprendre, c’est incontestable. On ne gazouille pas le français en naissant comme un petit oiseau. Il faut apprendre leur langue aux enfants. Si on se met alors à chercher, à propos de chaque mot, la petite bête, on n’est pas sorti de l’auberge : « C’est du lait. - J’en veux pas. - Veux-tu que je l’appelle chocolat ? »
Il ne serait pas bon, psychologiquement, de priver les enfants de certitudes linguistiques. Avec des mots sûrs et des usages clairs, le monde, pour eux, se met d’aplomb. « Bonjour, Madame Dupont » et non « Salut, la vieille ».
Ceci entendu, il demeure que la moitié au moins de la population, à cause d’un supposé « bon usage » coincé à perpète au travers de la gorge, n’ose plus ouvrir la bouche, ni écrire un mot. « Voisin, prête-moi ta plume ! » …
Alors ? Trop c’est trop !
La norme, c’est comme les médicaments : à bonne dose, ça guérit, mais tout le flacon vous envoie au cimetière.
En outre, sans succomber aux délices trompeurs du passéisme, un fait troublant du passé de l’humanité doit retenir notre attention : « à six ans […] dans les sociétés primitives […] l’apprentissage de la langue est considéré comme terminé […] à la satisfaction de l’entourage » (Martinet – Le français sans fard). Six ans, c’est l’âge où commence chez nous les pleurs et les grincements de dents dans la confrontation à l’écrit plus ou moins identifié à la langue dite « soutenue », langue de promotion sociale qu’on pourrait aussi bien appeler franchement langue dominante, mais qui s’appelle elle-même, modestement, « langue correcte » ; voire, plus modestement, avec l’effet connotatif des mots de l’ordre industriel, « langue standard » (si vous ne pouvez pas vous offrir le luxe, procurez-vous au moins les produits de base).
Ce qui pose problème dans tout ça, c’est évidemment le poids des rapports sociaux et non la supposée perfection atteinte par la langue officielle. Mais ces rapports sociaux ne sont pas anodins, on n’y touche pas non plus sans risque, l’histoire nous l’a appris ; autant regarder cette autre réalité en face une bonne fois.
À moins de supposer un saut qualitatif des langues des « sauvages » aux langues « civilisées », qui poserait quelques petits problèmes philosophiques et moraux, il faut assumer cette maladie sociale du langage qui touche massivement qui on sait. Et si maladie il y a, comment soigner ? Ma comparaison médicale n’est pas innocente. Vous savez très bien que, quand il souffre de « dyslexie », votre rejeton est conduit au dispensaire (enfin, y était conduit jusqu’à aujourd’hui, et y sera encore si l’école n’est pas trop « dégraissée », et si la sécu n’est pas en faillite). Là, un personnel scrupuleux et bienveillant de docteurs et d’infirmiers orthophonistes nantis d’un vocabulaire très précis, de plus en plus précis, infiniment plus précis au fur et à mesure que la complexité du malheur se découvre à eux, s’emploie à faciliter la tâche, commencée il y a 150 ans et poursuivie depuis sans relâche, qui consiste, selon des plans variables et à doses alternativement de cheval ou homéopathique, à coup de punitions ou par les vertus présumées du libéralisme relationnel (dénoncé depuis sous le nom de « laxisme »), à injecter la grammaire et la conjugaison orthographiques dans les profondeurs d’un peuple inculte.
J’ai la naïveté de trouver anormal, sans me vautrer dans le rêve d’un âge d’or, que ce qui se faisait "naturellement" dans l’espèce humaine puisse prendre, aujourd’hui, ces formes démentielles. J’ai en outre la prétention de penser qu’avec la langue que je parle "naturellement" avec mes amis, j’arrive à penser.
Tous les êtres humains sont des êtres parlants. Ou alors, c’est grave docteur ? Je ne sais pas vous, mais moi, si, pour parler, je dois m’aligner sur la perfection de Jean Dutourd en toutes circonstances, je suis condamné, de fait, au silence. Donc, je préfère parler au risque de quelques « fautes » plutôt que « m’écraser » et me ratatiner l’intellect. Comme je constate que, grosso modo, tout le monde réussit à parler encore, j’en conclus que la vraie question du langage est escamotée. Car comment est-ce possible qu’on parle encore quand tout le monde corrige tout le monde et s’attend à être corrigé ? En fait, la vraie question se ramène à « qui corrige qui et où ? » Et si tout le monde parle, plus ou moins, c’est parce que personne n’ose vraiment parler ailleurs qu’à sa place dans la société, CQFD. Le sociologue Bourdieu explique cela très bien (→ lecture).
Il faut apprendre « ce que parler veut dire ». Mais on ne peut obliger personne à apprendre ce qu’il ne sait pas, surtout quand il croit savoir. Aussi, comme je suis particulièrement vindicatif et méchant en la matière, pour toutes sortes de raisons qui me regardent, je me suis accordé une doctrine provisoire au sujet du beau langage. Elle est d’une simplicité biblique : « Tous ensemble, oui, ou personne ». Je suis certes moins bon que Jean Dutourd, mais pas pire que le tout venant des petits instruits, mes semblables. Au jeu de con des fautes de français, en trois minutes, quand je le veux, plus personne ne parle. Après, tous bien à plat et d’équerre, on peut, si on veut, tous ensemble ouè, échanger sur ces questions des savoirs raisonnables et opérationnels.
Voilà, c’est fait ! Je prends position. Et – vous en êtes-vous aperçu ?- je parle désormais à la première personne et non à l’abri d’un « nous de modestie », au vrai, nous de précaution. Car, à partir de maintenant, plus d’objectivité du tout. Tout va tourner autour de cette opinion. Ce sera l’idée fixe ; c’est une contradiction et c’est une bataille : nous sommes sous la norme et nous la reconnaissons nécessaire, et cependant nous la combattrons.
Politiquement, il s’agit de porter soudain au premier plan un minuscule fragment de superstructure, une broutille du point de vue de l’interminable histoire du genre humain et des enjeux colossaux actuels des conflits géopolitiques. La famine dans le Tiers-monde et la crise mondiale ont évidemment une autre importance. Il n’empêche : la non-communication entre les citoyens est un problème grave sur lequel, d’urgence et nécessairement, pour trouver des solutions démocratiques, il faut prendre position.
Je prends, à priori, le parti de la parole face à la langue, « malgré que » j’ai(e) compris les termes de la contradiction. C’est dur la dialectique quand il faut agir.
Car la norme, c’est la langue, pensent les enseignants, puis ensuite tous les Français. C’est la langue incarnée sur terre. Mais, répondrai-je, la langue n’a pas été créée par Dieu le père (il parait que le personnage fait, dans ces temps de désillusions, grandement défaut à l’espèce humaine, mais comme, de toute façon, Il oblige ses créatures à prendre leurs responsabilités, c’est tout un de faire avec lui ou sans lui). Tout le monde sera bien d’accord, en prenant le temps d’y réfléchir, que ce sont les hommes qui font la langue, même s’ils la font inconsciemment. Et on peut affirmer scientifiquement qu’ils continuent le travail. Car la langue n’est pas devenue parfaite et immuable ; elle n’était donc pas parfaite ; ou quand l’a-t-elle été ?
Vous du moins savez maintenant ce qu’il en est de ces contradictions ; de même que vous saviez déjà que les hommes sont divisés en classes qui ne se font pas de cadeaux. Il y a eu un moment de flottement sur cette notion après la fin de l’Union soviétique, mais même les journalistes de droite parlent aujourd’hui des « classes moyennes » ; et si moyennes alors « classes en dessous » et « classes au-dessus», ça va de soi en toute logique mathématique et … linguistique. Vous êtes alors en nécessité, par déduction, non de vous révolter anarchiquement (égale : bêtement ; égale : battu d’avance), mais de vous « indigner » contre ce qui vous empêche de vivre. Ou de vous enrichir, pour grimper au-dessus ; mais attention, « la caque sent toujours le hareng » et, dans la crise qui cogne dans tous les sens, ce n’est peut-être pas très prudent de choisir l’égoïsme.
La norme linguistiques relève du combat quotidien, pacifique certes, mais tenace, et essentiel quand l’essentiel de la vie est en question : le droit d’être.
Avant de vous y mettre, quelques conseils préalables, d’ordre tactique, ne sont pas superflus.
Si vous engagez la discussion avec quelqu’un sur ce sujet, je vous conseille, outre le plus grand sang-froid, de prendre la précaution préalable suivante : vous faites d’abord préciser à votre interlocuteur (n’ayez pas peur d’insister lourdement : c’est un sujet passionnel où on oublie vite toute rigueur logique) s’il accepte ou non que le débat porte sur le fond et non sur l’opportunité sociale. Car si l’idée qui hante sa cervelle, c’est qu’il faut « parler comme un livre » pour réussir dans la vie, il n’y a pas besoin de perdre une heure avec lui. J’ai connu jadis quelques familles d’instituteurs qui conversaient au passé simple afin de forger le moral d’attaquant de leur progéniture. Vous pouviez bien leur citer Benveniste, vous perdiez votre temps.
Pareil avec celui éploré et généreux qui, dans son coin de banlieue, essaie de rétablir, en maternelle, l’intégrité du mot « télévision » (et après sans doute « vélocipède » et « chemin de fer métropolitain »). C’est « dans leur intérêt » ; c’est pour que Mohamed et Rachida (Rachida qui?) aient leur chance à HEC. Ne le détrompez pas.
Doucement avec le langage !
« L’ordre du langage » nous gouverne, d’autant plus sûrement que nous n’y pensons pas. « Nous sommes tous « agis » et « parlés », post et pré-synchronisés ». En dernier recours, pour celui qui commande, c’est tellement commode, quand on a été bien dressé, à l’ancienne, quand la revendication tourne au vinaigre, de pouvoir moucher l’insupportable : « mouche ton nez, dis pardon au monsieur et apprends ton imparfait du subjonctif, le bescherelle est dans ton cartable à roulettes !» Si le procédé est efficace avec nos enfants quand ils commencent, comme on dit, à ergoter, pourquoi la hiérarchie n’userait-elle pas d’un procédé semblable ? Les psychiatres, vous le savez, soignent aussi les malades mentaux avec des mots. Rien qu’avec des mots, quoi qu’on dise de la psychanalyse. C’est dans les souvenirs d’enfance refoulés, justement, qu’ils vont chercher la clef des guérisons … ou de la résignation. Parce que si la psychanalyse est aujourd’hui décriée, ce n’est pas tant parce que ses résultats sont incertains (ils le sont, elle n’a jamais dit le contraire), mais parce qu’elle coute trop cher. Tout bénéfice pour les thérapies comportementales (quand même meilleures que les tranquillisants), mais avec des mots aussi : debout, couché.
Tout le monde connait aujourd’hui la puissance du langage. Quand les dictatures fanatisaient les foules avec des slogans vulgaires, ce n’était que balbutiements, on fait beaucoup mieux depuis. La manipulation par le langage est devenue un travail d’expert professionnel. Le métier a été inventé aux USA, et ça s’appelle « spin doctor ». Il s’agit d’ « un conseiller en communication et marketing politique agissant pour le compte d’une personnalité politique, le plus souvent lors de campagnes électorales », nous explique Wikipedia. Avant, la « propagande » se faisait à la bonne franquette, empiriquement. Non sans résultats éventuellement désastreux, ainsi qu’on sait. Mais c’est dire les pouvoirs nouveaux qui s’avancent. Il ne reste plus alors, pour ne pas être à leur merci, qu’à trouver les contre-poisons. Ils existent, ils s’appellent le « factcheking » et le repérage des « éléments de langage ». Mais c’est du boulot, c’est du boulot encore. Et quand ça se passe aux plus hauts niveaux en appui sur la puissance informatique, comment suivre ?
Alors, l’ordre du langage … trop ou trop peu ?
Révolte ou folie ? Folie ou révolution ?
Révolution puis totalitarisme ?
Essayons de faire encore de la linguistiques. Mais, sachons-le, dans l’urgence, pour affronter les contradictions qui déchirent les « classes du dessous » qui ne sont plus assagies par l’idéal des militants altruistes. L’enjeu est considérable, c’est la paix ou la guerre.
Lexique
norme
Le dictionnaire dit :
« (1) - règle, loi, selon laquelle se diriger
(2) – tech. Prescription réglant la fabrication, la présentation d’un produit. »
Ce sont ces idées qui sont présentes à l’esprit quand on se met en tête « d’apprendre le français » à quelqu’un. (1) est une question de morale, (2) une question technique. Toutes deux évoquent une obligation extérieure à l’individu.
Ce qui fait que, fondée ou pas (dans la 2e acception, le produit fabriqué hors norme est mauvais), la norme ne se discute pas. C’est loi et prescription. On applique d’abord et on réclame après, comme à l’armée.
Ce qui fait qu’il n’est nul besoin de justifier la norme en se référant aux lois internes de la langue. Il n’y a pas besoin de dire : « On dit comme si, comme ça » parce que c’est « mieux » ou « plus beau », ou « plus logique », ou « plus clair »…, il suffit de dire « C’est comme ça parce que c’est comme ça ». Et, tout compte fait, pour le moment présent, c’est quasiment plus hygiénique pour la santé mentale des jeunes éduqués (ou pour leur future honnêteté intellectuelle), en raison de l’habituel cortège de fausses raisons linguistiques qui accompagnent partout les prescriptions. Il vaut mieux que l’arbitraire (qui peut avoir l’allure de l’arbitraire du signe) ne s’accompagne pas d’obscurantisme ; c’est du moins mon opinion.
Registres de paroles – niveaux de langue
On peut aborder ces questions sous des angles différents.
- Sous l’angle revendicatif, ainsi que nous l’avons fait tout au long des pages précédentes.
Avec un point de vue minimal et un point de vue maximal (auquel je ne crois absolument pas)
→ minimal : un bon tien vaut mieux que deux tu l’auras. Casser les reins à la parole déjà existante sous prétexte de langue est un scandale ; respect ; primum vivere.
→ maximal : luttons pour avoir les moyens d’offrir au peuple de France tous les niveaux de langue permettant à chacun, en virtuose, de jouer sur le grand orgue des registres.
- Déjà, dans les deux cas de figure, on a acquis l’idée qu’il existe différentes façons de parler français, pas tranchées au couteau, mais distinguables et classables cependant.
Il y a le français soutenu, le français populaire, les patois, les argots.
Il y a le français savant, le français familier, le français précieux, ou à l’opposé, mais pareil, le français vulgaire ; Il y a les français grossiers et ça, ce n’est pas pareil.
On ne dit pas n’importe quoi à n’importe qui. On ne dit pas « merde » à son père, on ne lui dit pas « zut » non plus. Mais on dit « zut » à son copain ou à son frère quand les parents entendent et, éventuellement « merde » quand ils ne sont pas là.
La langue porte des « signifiés sociaux ». C’est une réalité. Et c’est une réalité également que l’on soit jugé (classé) selon sa façon de parler.
À partir de quoi, évidemment, on mélange tout. On va confondre grossier et vulgaire ou on va insinuer que la langue familière n’exprime que des pauvretés, sans faire le constat qu’en langue soutenue, les scribes bien dressés peuvent remuer avec leurs mots bien astiqués, toute leur vie, des broutilles d’idées et que, par conséquent, comme on dit, c’est le fond qui importe le plus : le contenu.
Si l’on me suit sur ce terrain, quand quelqu’un parle, on distinguera toujours « ce qu’il dit » de « ses fautes de français ». Mais, sur le second point, on ne suivra pas certains linguistes qui parlent pour tout un ensemble de fautes vénielles (cette litanie des « on doit dire, on ne doit pas dire » -cf les catalogues déjà cités) de « surnormes ». Certes, du point de vue de la communication, c’est insignifiant. Mais la surnorme en question est tout à fait fonctionnelle : c’est le « no man’s land », le champ de mines des interdits qui protègent les installations. Après, il y a les miradors et les mitrailleuses. Mais déjà ce premier « rideau » (jamais mémorisé, notez-le bien, et pourtant « ce n’est pas le diable » à apprendre, on apprend bien plus de choses dans sa vie. Mais probablement que dans l’ordre inconscient du symbolique, c’est le diable!) suffit à protéger les rentiers socio-culturels. En réalité, c’est un système très au point et très efficace, pas du tout marginal et négligeable. Et on l’a vérifié par l’absurde avec le président Sarkosy qui, voulant être peuple (faux cul! Pardon, hypocrite), s’est mis parfois à « parler comme un charretier » : il s’est fait un tort considérable.
Le fond de cette question, c’est que le langage est totalement intriqué dans les rapports sociaux et n’échappe pas aux turpitudes de la lutte des classes. Mais, comme ça nous égarerait un peu de délimiter au moment présent ces classes, retenons l’incontestable : les manières de parler « distinguent » ; elles tiennent un rôle essentiel dans la distinction. Elles sont inscrites dans un « marché » et peuvent y procurer des « bénéfices » (cf lecture).
On peut alors toujours formuler l’idéal du parleur idéal qui possède toutes les catégories et variétés de langue et n’est amputé d’aucune, qui passe, avec grâce et esprit d’à-propos, de l’une à l’autre. Le problème reste de le devenir. Pardi !
Et, en attendant, doit-on se taire ?
Lectures
- Bourdieu « Ce que parler veut dire – L’économie des échanges linguistiques (1982). Bourdieu explique dans son livre que l’utilisation du langage s’ordonne dans un « marché » où a lieu « formation des prix et anticipation des profits » (titre du ch.2). Extraits des p 64 à 67, 55 et 85
- Et, pour rire un peu, « le warrant-varan et le référentiel bondissant »
D’abord Bourdieu :
« Plus le marché est officiel, c’est-à-dire pratiquement conforme aux normes de la langue légitime, plus il est dominé par les dominants, c’est-à-dire par les détenteurs de la compétence légitime, autorisés à parler avec autorité.
…
À mesure que décroit le degré d’officialité de la situation d’échange et le degré auquel l’échange est dominé par des locuteurs fortement autorisés, la loi de formation des prix tend à devenir moins défavorable aux produits des habitus linguistiques dominés.
…
Cela dit, la loi officielle, ainsi provisoirement suspendue plutôt que réellement transgressée, ne cesse d’être valide et elle se rappelle aux dominés dès qu’ils sortent des régions franches où a cours le franc-parler (et où peut se passer toute leur vie). »
d’où :
. Le « discours détraqué » des pauvres
«La vérité de la compétence populaire, c’est aussi que, quand elle est affrontée à un marché officiel ( …), elle est comme anéantie (…) (Les dominés) sont voués au silence ou au discours détraqué» p 67
. L’ « hypercorrection » des petits instruits.
« Le rapport malheureux que les petits bourgeois entretiennent avec leurs propres productions ( …), leur sensibilité spécialement vive à la tension du marché, et du même coup, à la correction linguistique, chez soi et chez les autres, ( …) les pouss[ent] à l’hypercorrection, leur insécurité ( …) engendrant les « incorrections» par hypercorrection ou les audaces angoissées de l’ aisance forcée. » p 85
. L’ « hypocorrection » des bourgeois intellectuels..
« L’évitement conscient ou inconscient des marques les plus visibles de la tension et de la contention linguistique des petits bourgeois (par exemple, en français, le passé simple qui « fait vieil instituteur ») peut porter les bourgeois ou les intellectuels vers l’hypocorrection contrôlée qui associe le relâchement assuré et l’ignorance souveraine des règles pointilleuses à l’exhibition d’aisance sur les terrains les plus périlleux. Introduire la tension là où le commun cède au relâchement, la facilité là où il trahit l’effort, et l’aisance dans la tension qui fait toute la différence avec les formes petite bourgeoise ou populaire de la tension et de l’aisance, autant de stratégies -le plus souvent inconscientes - de distinction. »
— Bourdieu, – Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques (1982) p. 55
Le warrant-varan, marrant
«
Le Monde
Dimanche 20 – Lundi 21 mai 2007« Un vocabulaire commun pour tous » Alicia Suminski, vous êtes responsable produits warrants et certificats chez Euronext. Comment expliquez-vous le succès de ces produits ? Les émetteurs ont élargi leur gamme. Le contexte boursier favorable, avec un niveau de volatilité limité, a favorisé la découverte de ces nouveaux produits par les investisseurs individuels.
Avec l’Allemagne et l’Italie, la France fait partie des trois premiers marchés européens avec, en avril, 68,5 millions d’euros échangés par jour. De nouveaux émetteurs arrivent sur le marché français à l’instar de Merrill Lynch ou de Goldman Sachs. Le potentiel de développement n’est pas épuisé.
Euronext proposera bientôt une nouvelle classification. Quelle est sa vocation ?
Chaque émetteur ayant sa propre terminologie, il peut être difficile pour un particulier d’appréhender les risques encourus. En concertation avec les émetteurs, Euronext a donc établi une classification simple. Deux grandes familles sont créées : les produits d’investissement et les produits à levier.
Le risque de perte sur les produits d’investissement est équivalent à celui du sous-jacent. Il n’y a pas d’effet démultiplicateur à la baisse. Cette famille comprend les produits d’indexation pure, qui répliquent exactement la performance d’un sous-jacent (les certificats 100%), les produits qui offrent un niveau de protection du capital à la baisse (les Protect), et ceux qui permettent de bénéficier d’un rendement amélioré dans certaines conditions du marché (Discount, Bonus, Jet). Dans la famille des produits à levier, on retrouve les warrants classiques, les combinaisons de warrants (Cappés, Floorés), les produits Bear à barrières désactivantes comme les turbos et les powers. Cette classification sera effective dès la fin de cet été et sera notamment disponible sur le site Internet d’Euronext.Les émetteurs vont-ils enfin harmoniser leur offre ?
Chaque émetteur conserve sa liberté en matière de créativité et d’appellation de ses produits. Conscients qu’une meilleure lisibilité permettrait d’élargir le marché, certains commencent à harmoniser leurs gammes. La classification a pour objectif d’instaurer un vocabulaire commun à l’ensemble des produits.
Propos recueillis par J.D.»
… et combien précis et efficaces !
vous admirerez la date et repérerez dans le texte "Goldman Sachs"
Petit commentaire pour ce merveilleux document
… Quand on pense à ce qu’ont entendu les pauvres enseignants chercheurs en éducation physique qui, un jour, pour promouvoir des démarches pédagogiques actives, au lieu des classiques exercices stéréotypés, ont essayé de faire comprendre l’essentiel d’un jeu de ballon collectif. Le jeu est un continuel retournement de situation qui restructure à chaque instant les dispositifs tactiques des équipes et les décisions que chaque joueur doit prendre. Le ballon est le repère en perpétuel mouvement et rebond qui détermine les choix à faire. Tout le monde se réfère à lui. Le ballon est un « référentiel bondissant ».
Que n’avaient-ils pas dit, ces pinailleurs de la pédagogie, ces péroreurs qui ont failli couler la vieille école républicaine ? Ou peut-être pas dit, d’ailleurs, car il parait que la traque sur l’origine de l’expression tourne court. Mais ce n’est pas ça l’essentiel. Ni même que parfois le langage des chercheurs est un peu jargonnant. L’essentiel, c’est l’obscurantisme qui doit venir à la rescousse de l’enseignement public quand celui-ci est impuissant à améliorer son rendement. D’où : un ballon, c’est un ballon et b+a = ba. Le « référentiel bondissant » a donc été plébiscité par l’obscurantisme. Depuis, il tourne en boucle. Il illustre toute conversation où les moyens, petits et minuscules instruits veulent montrer qu’ils ne s’en laissent pas conter par le « pédagogisme ».
… Mais que n’ont-ils exercé, les contempteurs du pédagogisme, en d’autres domaines, leurs formidables bon sens et esprit critique. Ils auraient pu traquer notamment les signifiants et signifiés abusifs de « l’économisme ».
Quand j’ai mis de côté ce petit article désormais rigolo, c’était pour polémiquer contre les peigne-culs réactionnaires et égoïstes qui ricanaient à propos du « référentiel bondissant », je n’imaginais même pas que le « marché » pouvait s’effondrer quasiment le lendemain. Moi, je détestais le darwinisme dans l’économie et dans l’éducation. Et je cherchais partout des solutions, comme tant d’autres camarades en désespoir politique.
Pile-poil sur le lézard caché !
Vous devez donc non seulement remarquer la date de ce texte, mais aussi et surtout la conclusion que les experts économiques, à qui on n’a jamais fait de reproches linguistiques, tiraient alors de leurs formidables talents d’analyse : les « produits » « arrivaient sur le marché français », car le « potentiel de développement n’était pas épuisé ».
La recherche pédagogique, elle, ne méritait aucune pitié. Il fallait trainer dans la boue les bavards inconséquents qui se permettaient de mettre en doute le pouvoir structurant des exercices mécaniques dans une école « libératrice ». Les experts libéraux, eux, avaient le droit de poursuivre leurs passionnantes études et de vulgariser leurs mirifiques applications grâce à ce « vocabulaire commun ». Les « produits à levier à barrières désactivantes » n’étaient pas des « référentiels bondissants », c’étaient des outils efficaces pour la « destruction créatrice » dans le marché mondial, le meilleur des mondes possibles.
- varan [varã]
- Reptile saurien, grand lézard carnivore d’Afrique et d’Asie, pouvant atteindre 2 à 3 m de long
- warrant [varã]
- Billet à ordre dont le paiement est garanti par un gage portant sur des marchandises.
Heureusement que, grâce à l’orthographe, on ne peut pas confondre.
Qui corrige qui, quoi et pourquoi ?
[modifier | modifier le wikicode]Casquette à l’envers, casquette à l’endroit !
L’envers vaut l’endroit
Quand on a envie de corriger le langage des autres (et remettre les casquettes à l’endroit), il faut commencer par tourner sept fois sa propre langue dans sa bouche (et examiner ses propres incivilités). Il faut faire ce qu’il faut toujours faire quand on hésite sur les façons de se comporter : distinguer les faits et leur gravité, les théories explicatives et les opinions qui s’expriment ; ou ne s’expriment pas, et c’est pas meilleur signe. Après seulement, quand on est honnête, on décide. Avant, on risque de tenir des propos dangereux, surtout dans la situation internationale actuelle. Pour pouvoir attaquer de front, sous un angle désormais rigoureusement politique, les questions traitées dans les chapitres précédents, je veux mettre au premier plan le dernier enjeu, parfaitement délimité par les opinions qui s’expriment, notamment dans les élections. Les imbéciles pensent qu’il peut être réglé « au karcher » par un pouvoir fort et tant qu’à faire xénophobe. Cette méthode est un pas de plus vers le chaos mondial. Mais il ne faut pas non plus « assister » les « défavorisés », surtout quand ils ne le demandent pas et qu’ils réclament le « respect ». Les « jeunes », surtout. Il vaut mieux leur parler sans commisération, ce sera plus « tranquille ». De sorte que ce soit la solidarité qui commande et non la charité. Car la charité ne fonctionne bien que quand le monde est en ordre solide. S’il ne l’est pas, elle exaspère.
Et craignez, par dessus tout, ceux qui dressent les pauvres contre les pauvres.
Les faits linguistiques
1- Un bon nombre de « jeunes » des « cités» ont des façons de parler que les « gens » ont du mal à comprendre. Les gens sont agacés par ce parler-là.
Les jeunes en question se comprennent très bien entre eux, même lorsqu’ils n’habitent pas la même banlieue. Mais ce n’est pas seulement parce qu’ils parlent vite « à l’envers » qu’on ne les comprend pas. Sinon, tout le monde pourrait très vite s’entrainer à parler « verlan » (on peut mettre en verlan les fables de La Fontaine, sans problème. Quand j’étais gosse, je parlais « javanais » ; ça consistait à rajouter « av » à toutes les voyelles. Sans problème. C’est mécanique, et très vite on prend de la vitesse.)
Or voici (ci-après) un échantillonnage de mots en usage dans les « cités ». On peut compter dans la liste ceux qui sont « à l’envers » et faire le pourcentage. Le rappeur auteur du dictionnaire ayant été supporter de Sarkozy, on ne me soupçonnera pas de parti-pris. J’ai cru d’ailleurs comprendre que son choix politique ne l’a pas trop servi. Ce rappeur, comme beaucoup d’autres, n’échappait pas aux sirènes du blingbling et aux mythes libéraux venus des États-Unis. Le ghetto a des vertus, mais des vertus qui s’enseignent. Bambaataa le fondateur de la culture hip hop en est certainement tout marri. « Peace, unity, love an having fun » … and having flouze aussi. Tout le monde comprend ça ; et paix à ç’lui qui le dira.
Ici, comme partout dans toute l’histoire du monde, quand on espère retourner la société comme une chaussette, l’envers vaut l’endroit. La révolution à peine finie, les généreux se font bouffer par les cyniques et les égoïstes. Je ne célèbre donc pas l’utopie des ghettos. Mais pas non plus l’innocence de ceux qui les ont laissé tomber et laissé pourrir.
Le dialecte des cités
Les mots qui suivent sont ceux du « dico de Doc Gynéco ».
« Abusé, accro, à donf, ap, archouma, arrache-toi, assoc’, auch’, aya, babtou, baltringue, baston, bastos, beat, bébar, bédave, bédo, béton, beu (beu-her, beu-beu), beur, bicrav, bitch, biz, blaze, blème-pro, blondin, blunt, bouffon, boules, bouyave, braco, brolic, caillasse, caillera, cake, carotte, chan-mé, chatte, check, chelou, chichon, chiré, chrome, chtar, ci-mer, clique, clown, couille, crack, dawa, djoko, dope (pedo), double zéro, dynam’, enfoiré, engrainer, familia, fe-meu, fer, flow, fly girl, foncedé, fourrer, freestyle, gamin, gang, garre-ba, gazer, ghetto, go, goumer, graines, grec, gros, guez, guignolo, hala, kalouf, hasch, iench’, ieuv’, junk (ki-jon), keuf, keum, kif, lance-bas, lascar (scarla), live, locks, love, mercos, merguez, mille-fa, mytho (tho-mi), ne-chié, négro (nègre, greune, neg’), ouf, pain, pécho, pépère, pé-ta, pipe (pipeau, pipeauter), pivert, placard, po-po, posse [possi], puissant, que-cla, queud, racli (raclo), rate, râteau, re-frè, relou, représenter, reur-ti, rigolo, sauss, scarlette, schmidt, schnek, sin-cou, sket-ba, skunk, starche, sucette, sur( …), surin, tapin, tar-pé, tasspé, tcherno, teau-cou, testos, tête-à-tête, te-trai, teu-shi (teu-teu, teush), thon, tié-quar, ti-peu, tiser, tox, tranquille, tricard, underground, véner, vé-sau spatial, vlo, wesh wesh, xe, yes, yo, zetla, zonblou, zone, zonzon, zoo, zoulette, zoulou. »
Trois extraits de ce « dico du doc ». On y voit fonctionner dans la nuance la « langue des cités »
«
- NEGRO (NEGRE. GREUNE. NEG’)
- Homme noir. De nos jours, il est possible qu’un jeune Blanc dise à son ami, blanc aussi, « eh, Négro, on fait quoi ? » de la même façon qu’il dirait « eh, mec, que fait-on? ». Le politiquement correct voudrait que le terme « nègre » soit péjoratif, comme il l’était à l’époque du racisme d’État. La rue a décidé que c’était OK, du moment que le locuteur n’est pas animé de sombres arrière-pensées : si un lepéniste débarquait dans mon quartier en donnant du « salut les Négros », je ne suis pas sûr que ça le ferait tout de suite. p. 108
- OUF (TRUC DE )
- Tout a changé le soir de la première du Loft (édition n° 2, 2002) : dès ce fatidique soir d’avril, grâce à la susnommée Angela, l’expression « truc de ouf » est passée dans le domaine public. Tous les trucs de ouf préalables à cette date sont désormais considérés comme caducs, nuls et non avenus. Exception recevable pour le morceau du 113, Truc de fou, mais c’est bien parce que les rappeurs de Vitry ont évité le verlan. Sinon, le mot « ouf » tout seul (verlanisation de « fou », faut-il le préciser) peut être avantageusement complété avec « dans la tête ». Comme dans le rap J’pète les plombs, qui adapte littéralement l’expression américaine « insane in the brain » en «ouf dans la tête ». Cypress Hill/Disiz La peste, même combat. Truc de ouf, non ? p. 109
- TEAU-COU
- Vous allez me dire: mais Bruno, pourquoi mettre ce mot de verlan basique dans ton dico ? Et je vous répondrais: ça fait moins cuisine. Le fait d’entendre « teau-cou », ça fait tout de suite arme de défense (ou d’attaque) là où « couteau » ça fait « passe-moi le couteau, je vais découper un bout de pizza ». p. 145
»
— le dico de Doc Gynéco
Aussi, revenant à la linguistique, je n’accepterai pas non plus que l’on tire la conclusion facile que le verlan est une sorte d’argot ; ni plus ni moins ; et qu’il passera comme les autres ; qu’il n’y a pas de quoi fouetter un chat. Car même l’argot des pires bandits dans les films ne déplait pas autant que celui-là ; expliquez-nous ça. Même l’accent déplait. L’accent « parigot » est pittoresque et charmant, mais l’accent des cités, pouah ! Ce n’est donc pas le verlan qui pose problème, c’est ceux qui ne le supportent pas.
Il importe donc d’être scrupuleux.
2- Les « grands » parlent cet argot, mais parlent évidemment aussi « français » (l’accent toutefois est plus difficile à dissimuler, ce qui n’arrange pas les affaires quand on cherche du boulot.)
Les « petits », eux, par contre, peuvent répéter obstinément un mot sans savoir qu’il sera mal compris, et surtout mal pris. S’ils font ça à l’école, c’est certainement ennuyeux pour eux.
Par contre, les jeunes des classes moyennes trouvent ça « super cool » et adoptent les mots, les expressions et l’esprit canaille. Les vertueux s’indignent, mais le libéralisme a eu ça de bon, au moins, il a laissé la bride sur le cou à la liberté des mots. Ce langage a franchi la rampe.
… Il est donc grand temps de remettre du bon ordre là-dedans et d’oublier Jacques Lang, pensent les réalistes. Nous entrons dans des temps républicainement incertains.
3- Cependant, l’immense majorité des supposés « bon-françaiseurs » ne parlent pas non plus le « bon français » ; ça devrait les rendre indulgents et modestes. Ex : « On mange quoi, ya pu d’pain ? - ch’ais pas. » ; « at ta l’heure. » (Colin et Maudui). C’est bien pire que des mots à l’envers ; ici, c’est la grammaire qui est menacée.
On a beau rappeler les lois concernant le langage qui permettent de tout comprendre, rien n’y fait.
Rappelons-les quand même (car je ne m’adresse pas spécialement aux …disgracieux de l'âme, mais aux militants divers. Ils ont mille autres chats à fouetter, mais il faut aussi qu’ils prennent le temps de s’occuper de ça, sinon on est perdu : les « jeunes » veulent le « respect », et même parfois ils en abusent, « humains, trop humains »).
Ce qui va suivre peut être le résumé de tous les chapitres précédent ; on peut le tirer à part, en faire un tract à distribuer :
4- Les Québécois parlent français. Ils se battent assez pour ça. Avec un accent et des expressions ravissantes qui les font encore plus aimer. Mais au Québec même, les puristes n’apprécient pas, et ils font la guerre à leurs compatriotes.
Mais c’est pas tout. Au Québec, le peuple parle un étrange patois qu’on appelle le « joual » (ça veut dire « cheval », c’est dire le sens péjoratif). Ce joual est absolument incompréhensible pour nous, et il est évidemment honni par les patriotes québécois de la francophonie. On est exactement dans le même problème ; sauf que quand il y a eu la « révolution tranquille » du Québec, tout le monde restait Québécois, personne n’était menacé d’être reconduit en Normandie.
5- Continuons la récitation de la théorie linguistique : « Toute langue change à tout instant » (Martinet).
Tout le monde sait cela aujourd’hui. Et que le français vient du latin, plus précisément du « bas latin », c’est à dire d’un « latin populaire » déjà transformé. L’espagnol, l’italien aussi viennent du latin, et d’innombrables dialectes, patois, langues régionales qui ont eu moins de chance. On dit : le français est un dialecte qui a réussi .
L’association Université pour tous d’Orly a publié en 2001 un petit livret qui explique très bien cette histoire. Extrait :
« 17 octobre 1793 - Le français est déclaré langue officielle de la République.
1794 - L’abbé Grégoire dépose devant l’assemblée nationale son Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française.
D’après son estimation, en 1790, sur 25 millions de Français, l’idiome national est parlé par seulement 200 000 personnes comme seule et unique langue, trois millions le parlent correctement, tout en étant bilingues, six millions l’ignorent complètement, le reste des Français en ont une connaissance plus ou moins grande. »
Remplacer les langues régionales multiples par le français pur et dur et républicain a été le projet audacieux des révolutionnaires pour unifier le pays sans qu’il soit besoin d’un roi. Ce projet a été poursuivi opiniâtrement pendant deux siècles : il faut comprendre la République et les républicains.
Mais … comme toutes les langues changent inéluctablement, le français continue dans nos oreilles et sous nos yeux (merci la pub !) à changer. Tout le monde peut se donner la peine d’observer ce phénomène.
Le vocabulaire change, notamment par emprunt à d’autres langues. Pour l’instant, c’est surtout l’anglais (c’est à dire l’américain, car l’anglais … a changé en Amérique). On sait pourquoi l’américain est si envahissant. Tout le monde proteste, mais se laisse aller. Raffarin : « Chacun doit bien faire son job. » (dans le Monde du 19 02 03)
Heureusement, le vocabulaire change encore chez nous pour d’autres raisons et grâce à d’autres emprunts. Par exemple… au « verlan ». Ainsi, « Beur » est dans le Larousse de poche 2002. Avec toutefois quelques réserves bizarres : « on rencontre le féminin beurette » et « l’adjectif est invariable en genre, « la culture beur ». (On espère une réaction féministe).
La grammaire change aussi, quoique plus lentement. On la corrige beaucoup à l’école. C’est normal, les enseignants sont payés pour entretenir en état de marche le « français officiel ». Ils peuvent s’y prendre de différentes façons, mais l’obligation est prioritaire. Ils ont en effet du souci à se faire : le moindre laisser-aller a des effets en cascade. Ainsi, en dehors de l’école, plus personne n’emploie la négation « ne ». C’est à cause de ce petit changement de rien du tout que, pour des raisons phonétiques automatiques, « je ne sais pas » devient « ch’ais pas ». Mais le résultat est qu’à l’oral, désormais, on distingue « je ne sais pas » de « je n’ai pas » seulement par « ch » et « j’ » (« ch’ais pas » - « j’ai pas » [chèpa – jèpa]) …
Et ainsi de suite. On comprend que les enseignants s’arrachent les cheveux.
À part l’enseignement, cette évolution est-elle dramatique ?
Ça dépend.
Une langue sert à communiquer. Quand on utilise des mots qu’on a appris ailleurs (le vocabulaire américain de l’informatique ou celui du chaubiz), on sait bien, même si c’est la mode, qu’il ne faut pas en abuser, sinon on parle tout seul. Mais un mot différent par-ci par-là passe très bien grâce à ce qu’on appelle en linguistique « la fonction métalinguistique ». Un mot étrange que vous connaissez maintenant parfaitement.
« Comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous pratiquons le métalangage sans nous rendre compte du caractère métalinguistique de nos opérations. Chaque fois qu’(on) juge nécessaire de vérifier qu’(on) utilise bien le même code, le discours est centré sur le code ( …). « Je ne vous suis pas – que voulez-vous dire ? » demande l’auditeur. ( …)(ou bien) le locuteur, par anticipation, s’enquiert : « Comprenez-vous ce que je veux dire ? ».
Je cite Jakobson, l’éminent linguiste, qui illustre parfaitement, avec la modestie d’écriture des plus grands, ce qu’il explique. Autrement dit, entre gens bien élevés, quand on ne comprend pas un mot, on se le fait expliquer, il suffit de demander.
Généralement, tout le monde arrive à se comprendre. Les mots nouveaux rentrent dans la danse sans faire d’histoire, et y restent s’ils plaisent ou s’ils sont utiles. Ils poussent un peu tous les autres mots alentour, il y a quelques effets « en cascade », mais l’équilibre finit toujours par se rétablir. C’est ainsi que la langue change, sans jamais cesser de fonctionner (vous savez maintenant la phrase par cœur ; ou alors, j’ai perdu mon temps).
Par contre (c’est là où la science neutre et objective doit céder la place à la politique), quand des groupes humains se séparent, le changement continue, mais chacun de son côté. À force, les deux façons de parler divergent tellement qu’il n’y a plus de communication possible. Les raisons peuvent être géographiques. Il arrive qu’elles soient sociales, dans un même pays ; c’est plus grave. C’est là où je veux en venir.
Pour commencer à sortir de l’obscurantisme en la matière, il y a deux notions préalables à admettre et assimiler, qui devraient être aussi banales dans la culture générale que : « la terre tourne autour du soleil » ou « les microbes transmettent des maladies ».
1ère notion : « toute langue change à tout instant » ; il en résulte que quand des groupes humains sont isolés ou s’isolent (jadis de quelques kilomètres, aujourd’hui de 300m, d’une cité d’HLM à une autre en accession à la propriété ; pour ne rien dire des néo-urbains pavillonnaires périphériques), leurs langues divergent. Ce qui présente des inconvénients évidents. C’est pourquoi les « sauvages » étaient souvent polyglottes. Comme les émigrés. Éventuellement, il existait une langue générale particulière permettant à ceux qui bougeaient sur un plus vaste territoire de communiquer quand même. Les linguistes l’appellent véhiculaire. Les langues locales étant dites vernaculaires. Aujourd’hui, l’anglais est la langue véhiculaire de la terre entière, et on peut toujours édicter des lois pour tenter de l’arrêter (loi Toubon) ; comment arrêter le franglais des banquiers ?
Et demain ? Celle des affairistes chinois ? Les nouveaux « corbeaux et vautours ».
Réponse : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » !
Ces savoirs de base rappelés concernant le libéralisme économique mondial et la bêtise universelle que personne ne peut arrêter, il faut se rappeler aussi que dans des pays unifiés par un pouvoir central, roi ou république, la volonté a toujours été de marginaliser, voire de liquider, comme dans la France jacobine, les vernaculaires au profit d’une langue nationale unique. À coups de bonnets d’âne ou de guerres ethniques, et c’était pas joli du tout. À l’inverse, le retour aux langues régionales est un luxe tardif, un peu hypocrite, des pays riches.
La tentation reste donc grande d’arrêter une bonne fois l’évolution, qui sans arrêt refabrique de la diversité entre les régions, les groupes sociaux et les générations. Mais c’est encore plus difficile parce que …
2e notion : quand la langue évolue, ce n’est jamais sans raison.
« Les oscillations de la parole, qui construisent l’histoire de la langue […] ne sont aucunement un lieu d’anarchie. » (Hagège, « L’homme de paroles » p. 284)
Les « fautes » sont le plus souvent parfaitement intelligibles ; elles ont du sens et obéissent à des règles ; ce n’est pas du langage dégradé retournant à la barbarie, mais les « têtes chercheuses » de l’innovation nécessaire.
Seulement voilà, chacun, « oscillant » selon des lois naturelles, le fait à l’unisson du groupe social auquel il appartient et dans lequel il communique. Il en résulte qu’il n’en a pas conscience. Il remarque par contre les « fautes » des voisins. C’est eux qui « parlent mal ». C’est du racisme social ordinaire. Les voisins peuvent d’ailleurs retourner la critique. Les jeunes acteurs du film « Petits frères » (de Jacques Doillon, en 1998) trouvaient, eux, que leur metteur en scène parlait « en vieux français ». Mais il faut être bien naïf, impertinent et dé-scolarisé, avoir attrapé la grosse tête des vedettes et ignorer les lois de la sociologie de Bourdieu pour oser le dire.
Il n’y a que le linguiste qui peut observer ces contradictions sans s’affoler. Lui, constate le bon fonctionnement des lois naturelles chez les sauvageons et diagnostique leur bonne santé linguistique. Leur bonne volonté républicaine est une autre question. Mais confrontée à celle des futurs fascistes, y a pas photo.
Nous pouvons affronter les oscillations de nos paroles sans nous affoler, à condition de distinguer les problèmes. Sinon, à chaque instant, en fonction de nos intérêts, nous mélangerons tout et nous régresserons dans nos préjugés. Distinguons le problème des gros mots, impolitesses, impertinences, insultes et provocations du problème classique de « niveaux de langue » : vulgaire, familier, soutenu, recherché … ; le problème du français dit standard (véhiculaire) du problème des patois anciens et nouveaux ; le problème du rapport des propos à des réalités différentes, du problème du sens précis des mots utilisés dans le système véhiculaire ou dans un patois particulier …
« Maman, s’il te plait, laisse-moi un peu tranquille » égale « Tu m’emmerdes, casse-toi (pov conne) » égale « Tu m’importunes, je te prie de t’ôter de ma vue ». On peut prévoir néanmoins (le locuteur, n’en doutons pas, le prévoit aussi) qu’en dépit de la différence de style, les deux dernières phrases auront un effet « illocutoire performatif » (lexique) identique et exactement inverse de ce qui est demandé : deux baffes, privé de dessert ou de vacances à Megève. Mais si le destinataire n’est pas maman, mais un copain, tout change.
C’est le genre d’analyse qu’il faut faire à propos des graffitis sur les murs. Quelle est la force illocutoire de « nique la police ». Dans un jeu de rapports de force constant avec la susdite, je n’en sais rien. Mais je sais par contre qui si, par supposition, il était écrit à la place : « Mort aux vaches et vive l’anarchie » (Brassens 1953 …), tout le monde pourrait s’endormir tranquille ; celui qui a écrit ça est complètement inoffensif. Pourtant, « mort », c’est pire que « nique ». (Enfin je trouve.) Tout le monde sait que le « mai 68 » des banlieues, que certains annoncent, serait hélas tout autre chose que la soi-disant révolution des gavés-frustrés du 68 historique. Un message, disent les linguistes, ne prend tout son sens que dans « l’énonciation ». Et moi, depuis mon pavillon de Choisy, comment puis-je mesurer le caractère prémonitoire des graffitis ?
Par contre, grâce à la décrispation linguistique autodidacte que je me suis donnée, je peux profiter pleinement, pour l’instant, de tous les gens que je côtoie, quelle que soit la soi-disant richesse ou pauvreté de leur vocabulaire. Parce que je sais, par théorie et par expérience, et donc par goût, que parmi les citoyens en France, il y en a qui, semblables dit-on à Racine, expriment splendidement leurs tragédies avec 1500 mots, et d’autres dont le disque dur contient tous les « trésors de la langue française » et qui ne s’en servent jamais guère plus que pour commenter les cacahuètes de l’apéritif.
Il y a un remède simple aux jérémiades sur la misère du français, c’est de parler pour de bon. Quand la communications s’établit utilement, les lois linguistiques se mettent automatiquement à fonctionner, qui organisent ou réorganisent le langage nécessaire. C’est ainsi que la langue française se portera bien.
Et si l’on veut réunifier la communication, il n’y a pas trente-six solutions ; il y en a deux :
1- On interdit les façons de parler qui ne sont pas brevetées par le gouvernement. C’est ainsi qu’on a procédé (ainsi qu’il est expliqué plus haut) pour « anéantir » les langues régionales (mais, apparemment, ç’a été plus facile à décréter qu’à réaliser, malgré les bonnets d’âne et les coups de règle sur les doigts, puisqu’on parle encore breton, occitan et corse)
2- On communique fraternellement, ainsi que nous l’explique Jakobson. Quand on a vraiment des choses à se dire, on y parvient toujours.
On peut même s’offrir le luxe alors de parler des dialectes différents en adoptant en plus une langue commune (« véhiculaire »). Les humains sont naturellement polyglottes. Ils cessent de l’être dans les situations d’extrême isolement, ou au contraire quand leur pays domine et qu’ils sont trop vaniteux pour se donner la peine de comprendre les autres (si on y réfléchit bien, ça revient au même : dans l’isolement, on devient con.)
Mon opinion politique
Il n’y a plus besoin en France de coups de règle sur les doigts pour entretenir en état de marche une langue commune. Les cours de récréation et la télévision font ça très bien. Les façons différentes de parler s’éloignent et se rapprochent dans un mouvement sans fin, c’est la vie même. Ainsi, l’évolution peut continuer tranquillement. Même TF1, ou ARTE à l’opposé, font entendre du verlan, et tout le monde suit le film. Nous avons même eu un président (à quelque chose malheur est bon) qui très très libéral en prenait souvent à l’aise avec le français soutenu. De toute façon, le libéralisme, dans ce domaine, ne l’avait pas attendu pour briser les tabous dans la publicité. Où est donc le problème ?
Il est dans l’existence même de ces quartiers ghettos où le jeunes tournent en rond et se désespèrent. Les « gens » en ont peur et ont bien raison, car ces jeunes aussi ont bien raison d’être en colère. Mais ce n’est pas un problème linguistique. C’est la fracture sociale qui crée les problèmes linguistiques, et non l’inverse. En plus, on connait le remède : travailler. Et parler. Tous ensemble, ouais (ou « oui ») !
Lexique
Illocutoire
« […] On qualifie d’illocutoire tout acte de parole réalisant ou tendant à réaliser l’action dénommée : par exemple, la phrase " Je promets de ne plus recommencer " réalise en même temps l’acte de « promettre. »
Performatif
« […] On qualifie de performatif ceux des énoncés illocutoires qui signifient qu’on essaie d’imposer par la parole un certain comportement. »
(Dictionnaire Larousse de linguistique)
Les fonctions du langage
selon Jakobson
La description ci-dessous a été adoptées par tous les linguistes :
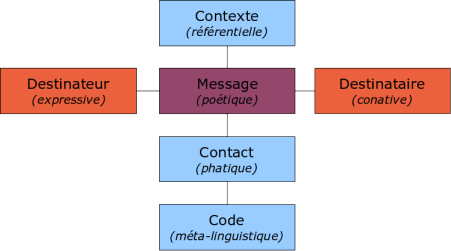
La fonction expressive : elle est centrée sur le sujet qui parle : sentiments, émotions, mimiques, etc.
La fonction conative : cette fonction permet au destinateur d’agir sur le destinataire (inciter à écouter, à agir, à émouvoir).
La fonction phatique : cette fonction est relative au contact. Elle permet de provoquer et de maintenir le contact.
La fonction métalinguistique : cette fonction s’exerce lorsque l’échange porte sur le code lui-même et que les partenaires vérifient qu’ils utilisent bien le même code. Cette fonction consiste donc à utiliser un langage pour expliquer un autre langage.
La fonction référentielle : cette fonction permet de dénoter le monde qui nous entoure, c’est le référent, c’est-à-dire «de quoi il s’agit».
La fonction poétique : elle ne se limite pas à la poésie seulement, car tout message est expressif. Cette fonction se rapporte à la forme du message dans la mesure où elle a une valeur expressive propre.
C’est une étudiante de l’uqàm, Université du Québec, à Montréal, qui nous offre ce résumé de Jakobson (chapitre XI, "linguistique et poétique", de son livre "Essais de linguistique générale"). Pour plus d’explications (car ces notions ne sont pas évidentes), wikipedia, le schéma de Jakobson.
Mesure de la quantité de vocabulaire dans les « quartiers »
C’est ce vocabulaire qu’on a souvent stigmatisé en le déclarant d’une pauvreté abyssale
Je donne d’abord un exemple personnel.
J’ai recensé les mots que connaissaient de jeunes rappeurs concernant la danse hiphop (d’après une liste d’enquête universitaire). Combien ?
68
… sur 400 mots supposés être leur vocabulaire de base.
Il reste 332 mots pour les autres usages de la vie.
Pour une compréhension complète des discours scandaleux tenus sur les « jeunes » des « quartiers » à propos de cette question (scandaleux parce qu’ils n’ont pas été tenus par des ignorants), consultez donc sur internet (il y a tout sur internet, plus personne n’a le droit de rester ignorant), sur le site réseau scientifique TERRA (Travaux, Études, Recherches sur les Réfugiés et l’Asile) l'article, La « mauvaise langue » des « ghettos linguistiques » : la glottophobie française, une xénophobie qui s’ignore
Lecture, petits frères :
- Nos petits frères
« Ils sont à Pantin, à deux pas de Paris. Ils ont 10-14 ans, ils sont black, feuj, rebeu. Ils savent se procurer des petits guns. Ils taxent des chines, des vélos, des pizzas, de l'argent, une robe de mariée, un âne. Ils jouent aux gendarmes et aux voleurs, avec de vrais gendarmes et de vrais voleurs. La cité, déserte d'adultes responsables, est un terrain de jeux violents ou tendres, à la croisée des brutalités des grands et des sentiments enfantins. Noir ghetto et vert paradis.
(…) Ils manquent de thunes mais pas de mots. Ils empruntent à toutes les langues disponibles les vocables de leur français interculturel : argot, arabe, berbère, gitan, créoles caribéens, langues africaines, slang... Ils travaillent ces lexèmes par inversions verlanesques, syncopes, apocopes, aphérèses, redoublements hypocoristiques et autres procédés classiques.
(…) Tellement loin de nous, tellement près. Leur genre de vie est à des années-lumière du nôtre mais leurs réactions, leurs sentiments, leurs peurs, leurs rêves, leurs espoirs sont les nôtres. À l'inverse d'un documentaire objectivant les différences, enfermant l'autre dans son étrangeté, le film de Doillon, le regard de Doillon va chercher dans l'autre celui qui m'est le plus proche, celui qui me ressemble, moi.
Des jeunes sauvage, dont il importe d'abord de se protéger ? Ou bien plutôt, nos petits frères. »
— Pierre Encrevé (linguiste), extrait du dossier de presse. Politis n° 543 , 8 avril 1999
Pour éviter la ritaline
[modifier | modifier le wikicode]
, tranquille !...
Du bon usage … de la norme
Conseils aux parents (ils le valent bien).
Faute de pouvoir conclure nettement cette affaire, où tant de questions essentielles s’entremêlent, essayons du moins d’y apporter quelques nuances pratiques. Il faut « dans le doute s’abstenir » (c’est à dire, c’est clair, respecter l’ordre en place) ; le but du combat se réduit à tenter d’élargir l’horizon : nous ne sommes pas des enfants. Mais, le cas échéant, nous en avons dont l’avenir est prioritaire. Nous devons, pour eux, adopter un comportement de sagesse. De toute façon, lorsque l’on sait, plus rien ne peut être comme avant ; et l’essentiel, quand il s’agit de l’éducation des enfants, c’est toujours l’amour qu’on leur porte.
Un premier acte d’amour est de tout relire, sagement, consciencieusement, avec discipline, pour être absolument convaincu que les pouvoirs du langage sont grands. Nous en avons fourni (ch 9) une preuve incontestable puisque les ordinateurs les plus perfectionnés peinent à devenir des « lecteurs moyens ». Alors, exigeants mais cools, chers parents.
1 — norme et nomenclature
Pour bricoler à la maison, chacun possède certainement un ou deux marteaux, un gros, un petit, qui suffisent à toutes les tâches. Mais si l’on rend visite à tel ou tel artisan, on observera avec curiosité toute une collection de marteaux, soigneusement rangés au-dessus de l’établi, de toutes formes et de toutes dimensions. Sont-ils là pour faire bien dans le décor ? Certainement pas. Ils sont indispensables pour les finesses du métier. Par contre, non seulement ces marteaux seraient inutiles au bricoleur, mais celui-ci serait bien en peine d’en trouver l’usage approprié. Il pourrait même les trouver tout à fait malcommodes pour ses petits travaux domestiques.
Pour le travail intellectuel, le travail du cerveau sur la réalité symbolisée, la précision des mots est indispensable. Vous en savez maintenant assez en linguistique pour comprendre qu’un « phonème » n’est pas un « son » et qu’un « monème » n’est pas un « mot ». Dans une discussion serrée, il faut s’assurer qu’on « parle la même langue », c’est à dire que les paroles, qui se rencontrent, qui se confrontent et se proposent de s’accorder vraiment pour permettre une action précise, obéissent au même « code linguistique ». Il ne faut pas employer un « faux code », explique le linguiste Prieto. Mais la responsabilité en incombe au locuteur, pas à celui à qui il s’adresse (Luis Prieto - « pertinence et pratique » p55,56). Quand on sort des pures raisons théoriques, et même de la politique, c’est tout simplement courtois.
Mais ceci compris et admis, vous admettrez aussi que la précision du vocabulaire procède de la connaissance précise des choses et non l’inverse. À condition, évidemment, que l’on veuille que les mots servent à quelque chose et pas seulement à passer des examens. La question n’est donc pas de priver les écoliers de « leçons de vocabulaire » … si elles sont faites de telle façon que leur esprit restera disponible pour comprendre un jour avec précision, pour ne pas se faire blouser, ce que sont les « produits warants à barrière désactivante ».
Les leçons de vocabulaire
Rappel.
Référent : « on appelle référent ce à quoi renvoie un signe linguistique dans la réalité extra-linguistique telle qu’elle est découpée par un groupe humain. » DLL
D’où trois types de leçons :
1.1 — désignation
| Désignation | + | ← | chaise | (Les croix sont supposées être des objets concrets du monde réel) |
| + | ← | papa | ||
| + | ← | facteur | ||
| + | ← | etc. |
La réalité, pour l’enfant est énorme ; il distingue les objets distincts, mais en vrac. On l’aide à s’approprier ces choses au plus vite en les désignant (les détails, on verra plus tard!).
1.2 — affutage
Le problème est d’analyser la réalité par l’action et par la pensée de plus en plus profondément pour pouvoir effectivement agir dessus. Il faut des mots précis pour travailler commodément et efficacement : « + » c’est le machin qui sert à … quand le … etc. Il s’appelle « x ».
1.3 — verbiage
Un mot est isolé ; on ne fait rien qu’en parler ; puis on apprend la définition.
« 1 » relève du bon sens et est pratiqué quotidiennement partout. Mais on comprend pourquoi il est si commode de prétexter « 2 » pour pratiquer « 3 » à l’école. L’école, telle qu’elle est actuellement organisée, est éloignée de la réalité. Or l’enfant, avant 12 ans, ne peut penser le monde de façon hypothétique (cf Piaget, ch 8). Par conséquent, la leçon de vocabulaire peut très bien consister à faire du vent avec la bouche à propos d’une queue de cerise. Apprendre des listes de mots sur de fausses situations, ce n’est pas apprendre le français, c’est préparer des citoyens de pacotille. On n’applique pas le vocabulaire au roulor. Mais un coup de peinture peut accroitre la valeur marchande d’un produit médiocre. Avant que ça s’écaille.
Cependant, l’opération bavardage inutile à propos de quelque chose dont on ne sait rien et sur laquelle on ne peut rien de plus après qu’avant n’est pas sans intérêt en tant que jeu sur le code (comment vas-tuyau de poêle). Dans une bonne ambiance familiale, cela peut développer le gout du langage. Et alors ce « jeu » peut continuer à l’école pour ceux qui sentent la connivence profonde entre cette école et leur milieu.
Cette petite fille, devant son livre d’images, ne voyait pas quoi pouvait être, à côté d’un bonhomme à bonnet pointu, ce cylindre à toit pointu flanqué d’une croix.
« C’est un moulin, lui dit-on.
- ?
- et le monsieur qui est devant, c’est le meunier.
- Ça y’est, je sais, s’écria la petite fille : « meunier tu dors ton moulin va trop vite ». »
Elle « savait » : l’affaire était close et enregistrée sur le disque dur.
Mais une fois, j’en avais un en rééducation (pas un bon : il n’arrive pas à lire meunier et ne connait pas le mot moulin) qui croyait que ces machins à ailes, c’étaient des ventilateurs pour rafraichir les gens l’été au paradis des vertes campagnes … Il rêvait le poète !
(lisez tout de suite le texte de Colette ci-après : cette grande écrivaine rêvait aussi quand elle avait huit ans )
Vous avez déjà compris, dans les chapitres précédents, comment se fait l’apprentissage « naturel » de la langue « maternelle » : le système est là, dans lequel baigne l’enfant. C’est le « bain de langage ». Mais ce système n’est pas une abstraction, il est fait de gens parlant, en chair et en os, gentils ou méchants, gentils et méchants, patients et/ou impatients (tour à tour et/ou tout à la fois), que le petit enfant supportera si on l’aime …suffisamment (Winnicott), et qui lui apprendront à parler, cahincaha, moitié soumis, moitié actif, sans règles de progression autres que celles que son esprit choisira et qu’on n’explique pas très bien encore. Et pourtant des savants étudient le mystère méticuleusement (cf dans La Recherche de mai 2012, l’article consacré à Anne Christophe qui s’y consacre depuis plus de dix ans) :
Plus tard, chaque mot se présentera à son esprit d’être pensant miraculeusement enveloppé de cette extraordinaire luminescence de nuances et de sous-entendus acquis au fil des ans et des expériences vécues, qui fait le plaisir du langage. Pour rire, bagarrer, se moquer, bercer, aimer ou chanter …
Donc, pour la norme, en famille, pas de souci. (Sauf situation exceptionnelle, mais qui ne concerne jamais le langage en tant que tel, ni ses moyens spontanés d’apprentissage, mais ce qu’on appelle le « contexte affectif »). Au contraire, de la désinvolture et quasiment du j’m’enfoutisme. Car rien n’est pire que d’essayer, pour améliorer le rendement et la qualité, de procéder méthodiquement : les bébés flairent l’anxiété à 1000m, et c’est le meilleur moyen de les bloquer.
… À moins d’être vraiment convaincu des vertus de l’imparfait du subjonctif dans la conversation courante, mais ça ne s’improvise pas.
Et, à l’école, l’enseignant ne sera pas coupable non plus si le rêveur ne devient pas ingénieur en éoliennes. L’enseignant n’est maitre ni des programmes ni des traditions. D’abord, il doit faire face pour que la classe, jour après jour, tout simplement tienne debout. C’est la question primordiale. Croyez-moi, il faut un sacré savoir-faire et une fameuse collection d’outils. Ne cassez pas la boutique du bon artisan (cf le texte de Bachelard d’introduction) qui se débat dans la crise comme il peut et en fonction de ce qu’il est et de ce qu’il arrive à comprendre. Il le fait tout seul. C’est bien là le scandale essentiel : il n’y a pas de formation continue.
Il ne la réclame pas trop non plus. Mais c’est un autre problème. Politique.
2 — Norme et système de la langue
Ne cassez pas la boutique de l’instit, mais vous pouvez du moins, en d’autres occasions, faire de la linguistique amusante en famille. Les « bonnes fautes » sont un sujet en or.
Voici un exemple. Un enfant dit « J’écrive mon nom ». C’est une faute, mais une faute qui traduit sa connaissance des lois de la langue. Il transforme le verbe "écrire" en verbe régulier à partir de ce qu’il entend à l’école :
- vous dessinez → je dessine
vous écrivez → j’écrive
- vous dessinez → je dessine
(Il s’inspire aussi peut-être d’une autre information reçue à la maison : « il faut que j’écrive à la tante Ursule »).
Mais vous de même vous préférez les verbes du premier groupe réguliers. C’est à cause de cette tendance que vous dites peut-être « solutionner » au lieu de « résoudre » (qui, comme vous le savez, n’est pas facile à conjuguer). « Solutionner » est réputé pas très français. En tout cas, vous préférez « tomber » au verbe « choir » ; imaginez aujourd’hui « Ciel ! J’ai chu », au lieu de « Zut ! chuis tombé ».
Au lieu de vous désespérer, émerveillez-vous plutôt des « fautes » de vos chérubins. Ils secouent le cocotier et veulent faire le ménage. Ils oublient, évidemment, la plus haute complexité nécessaire, mais nos « fautes », à nous, que sont-elles ? Est-ce une expression de la santé de la langue, de la vigueur populaire opposée à la sénilité des cuistres ? Ou est-ce aussi l’ignorance de la complexité ?
Prenons un autre exemple adulte :
| boire | croire |
| il boit | il croit |
| ils boivent | ils croivent (pas correct → ils croient) |
Cette régularisation analogique du verbe croire est fréquente et semble logique puisqu’elle permet de distinguer à l’oral un pluriel d’un singulier. En réalité, pourtant, la langue parlée a supprimé ailleurs largement cette distinction. Les « modernes » verbes du premier groupe se soucient comme d’une guigne de la distinction singulier/pluriel, et vous allez voir pourquoi : grâce au système du sujet surajouté en cas d’ambiguïté.
Le système oral de conjugaison est le suivant : 1ère personne du singulier : /j’manj/ (je mange) 2e : /tu manj/ (pour d’autres verbes, t suffit, ex /t oubli/) 2e polie : /vou manjé/ 3e : /i ou (é ou a) manj/ 1ère pluriel : /on manj/ 2e : /vou manjé/ 3e : /i ou (é ou a) manj/
La 2e du singulier polie et la 2e du pluriel, dans les situations réelles de communication, ne peuvent se confondre, car la politesse exige, au moins, qu’on s’adresse en face à celui qu’on respecte.
Par contre, la 1ère du singulier et la 2e du singulier doivent se distinguer à l’oreille (par j/t)
ex : j’étale la colle, t’appuie sur le papier.
Quant à la 3e personne du singulier et la 3e personne du pluriel, c’est selon. S’il n’y a pas de confusion possible, l’absence de distinction est économique, mais, s’il y en a une, facile : on rajoute un nom sujet.
/i manj a la cantine/ mes enfants /i manj a la cantine/ mon grand /i manj a la cantine/
On voit que cette conjugaison-là n’est pas exactement celle qu’on serine à l’école, et que « /i/ (il-ils) n’est pas exactement ce qu’on appelle un pronom sujet. Ou plutôt, si « /i/ » donne effectivement une indication sur le sujet, « /é/ » (ez) de « /vou manjé/ » (vous mangez) en donne également une puisque, à la cantine, le maitre pourra dire :
/vou manjé/
mais aussi, impérativement :
/manjé/ ~ /manj/
Alors, /é/ (ez), pronom sujet du verbe manger ? Pourquoi pas. En tout cas :
« /mon frèr i manj à la cantine/ »
Qui est-ce qui mange ? C’est « mon frère », pas de doute : « mon frère », sujet du verbe. Et « /i/ » qui colle à mange (même lorsqu’on l’a transformé en « il » pour faire plaisir à la maitresse) ? Pas forcément. Que c’est donc compliqué tout ça, et où sont les fautes ? Le système oral de conjugaison du français populaire est tout à fait fonctionnel et cohérent, mais qu’en faire dans le système qui doit être enseigné ?
Dans la conjugaison scolaire, il existe aussi un temps très ennuyeux qu’on appelle paradoxalement le passé simple par comparaison formelle avec le passé composé, mais vous appréciez l’ambiguïté du vocabulaire employé ; « composé », comme chacun sait, « du participe-passé-du-verbe-que-l’on-conjugue-et-d’un-auxiliaire-être-ou-avoir-au-présent ». Ça, c’est « meunier tu dors », mais, pour déclencher la moindre bouffée poétique, il faut vraiment avoir l’imagination fertile.
Dites-nous quelle raison peut pousser un enfant (et même un adulte un peu critique) à penser le verbe en deux mots dans « j’ai chanté » et en un dans « je chantai ».
J’ai chanté « débutaison » Je chantai « terminaison »
Cf Règle : Terminaison …tu as chanté tu chantas il a chanté il chanta
Si, il y a une raison, une seule. On peut dire :
« j’ai bien chanté, j’ai assez chanté »
et pas « je chant’bien ai, je chant’assez ai »
Diable ! Et quelle peut être la raison de cette belle raison effectivement incontournable, mais rigoureusement formelle et mécanique à première vue ? Disons que la solidification du temps « passé composé » peut demander encore un peu … de temps. À moins qu’il y ait des raisons plus subtiles autour de la « récupération » du participe-passé en tant qu’adjectif ; et ces raisons se contredisant, et suscitant des discussions passionnées entre les linguistes (cf ch 7bis), ouh la la, c’est chaud, n’y touchons pas.
En tout cas « simple », quelle plaisanterie pour un enfant ! D’autant qu’il ne l’emploie jamais le passé simple, ni personne autour de lui, ce qui ne l’empêche pas de vivre.
En réalité, le passé simple existe bel et bien et est utile dans le système de la langue. C’est le temps des récits, des belles histoires que l’on raconte, des contes, des aventures (cf Benveniste, « problèmes de linguistique générale », ch XIX « Les relations de temps dans le verbe français »). Pour que le merveilleux s’accomplisse, une histoire ne doit pas être située par rapport à ceux qui parlent. Il faut de la « distanciation ». C’est pourquoi « nous allâmes » et « vous allâtes » ne servent presque jamais, car ni vous ni nous ne « sommes dans le film » ; les premières et deuxièmes personnes sont totalement tombées en désuétude et font rire.
Le fond de la question est que même un petit enfant peut assimiler le passé simple, à condition que ce soit bien lui qu’on lui enseigne et pas sa caricature. Le passé simple ou tout autre « signifiant de distanciation ». On peut même faire l’hypothèse que s’il n’existe pas en grammaire, il apparaitra en lexique (voir ch 4). Il existe, c’est le célèbre « il était une fois » ; mais il faut avoir l’imagination bien accrochée pour que, ce signal de départ donné, on continue le voyage imaginaire sans autre aide. Une culture orale vivante, populaire, se redonnerait sans doute les moyens (lexicaux ou grammaticaux ; peut-être le passé simple) de soutenir l’art partagé du conte. Ce n’est hélas chez nous que de la socio-linguistique fiction, le cinéma a tout remplacé, et il faut être con pour lire quand on a la télé. (Je ne ris pas : moi non plus je ne lis plus, sauf des textes politiques et des revues scientifiques.) Par contre, dans les pays où la culture orale est restée vivante, les conteurs ont toujours des trucs pour entretenir et la distance et l’attention (c’est le « et cric et crac » des Créoles).
Quoi qu’il en soit, le passé simple ne peut avoir sa place dans le système de la langue du petit enfant que si l’on trouve … le temps de lui raconter des contes (si nécessaires par ailleurs à son épanouissement psychologique - Bettehleim l’a magnifiquement expliqué). S’il connait, mais « pour de vrai », cette forme verbale, il sera, par magie, transporté avec armes et bagages dans un univers aussi nécessaire pour lui que l’univers réel, car il faut rêver.
Bien entendu, ceux qui n’entendent pas de contes au berceau, puis doivent, à la maternelle, désespérément les chercher à cache-tampon sous plus d’un tiers de mots incompréhensibles (en plus du passé simple), ils dégagent en chute libre. Ils n’ont plus, pour se rattraper et se refaire un teint d’aurore aux doigts de rose, que la bordure du trottoir des leçons de conjugaison pendant cinq ans de « grande école ». Le remède est à coup sûr pire que le mal.
Cette langue normée en soi-disant bon français, qu’on fait semblant de leur enseigner, ils ne la comprendront jamais (ou bien quand ? Et avec quelle peine et quelle ankylose résiduelle ?) Ils la subiront, c’est tout. Il semble alors parfois, bien que l’espèce humaine ait la peau dure, qu’on débouche sur une paupérisation absolue du langage.
En attendant, parlons, parlons …
3 — norme et jeu sur les registres
Comparez entre elles les 3 expressions suivantes :
« Merde ! Je me suis cassé la gueule. »
un éventuel et délicieusement puéril :
« J’ai poumé » (de poum, pa terre)
et « J’ai turlututu. »
Rien que des incorrections, mais de significations tout à fait différentes. L’une, c’est ce qu’André Still, dans son livre « Dieu est un enfant », appelait « le gros bout de la langue ». Et il remarquait que n’importe quelle langue ou patois a son « gros bout ». « Sangredieu, j’ai chu. » appartenait au gros bout du langage des mousquetaires. L’autre est adorable et respecte la loi linguistique des verbes du premier groupe. C’est un néologisme aussi efficace, du point de vue de la communication, que, par exemple « j’ai positivé », mais évidemment impossible dans la bouche d’une grande personne. La dernière, si elle était énoncée, relèverait de troubles mentaux graves nécessitant des soins psychiatriques intensifs. À moins qu’il ne s’agisse d’un étranger auquel on fournirait le recours métalinguistique normal : que voulez-vous dire ? Vous vous trompez de mot.
C’est à dire qu’il y a incorrection et incorrection. Il y en a qui déraillent complètement du système de la langue, que personne n’admettra (encore que les poètes … !? -ch 4, le poème de Michaux ; par contre Arthur H exagère un tantinet ; mais si la musique est bonne …). Il y en a qui respectent les lois du système, mais que souvent on n’admettra pas non plus, pour diverses raisons.
Il n’y a pas une seule variété de langue française. Avec les mêmes lois, on peut fabriquer des sauces de goûts très différents, que l’on ne servira pas à n’importe qui et n’importe où. Autant il semble inadmissible de mettre sur des incorrections d’origines très différentes la même étiquette « c’est laid », autant il faut admettre que les variétés signifient quelque chose. Le choix d’un registre de paroles est, en soi, un signifiant qui a un signifié social. En théorie, donc, la maitrise de sa langue ne consiste pas à s’interdire des registres, mais à savoir s’en servir à propos.
Par malheur, prétendre enseigner cette liberté à l’école élémentaire n’est pas une opération facile. On se heurtera d’abord aux préjugés, et aussi à la donnée psychologique déjà évoquée que l’enfant n’aime pas, lui non plus, évoluer dans l’incertitude. Le monde doit être pour lui méchant ou gentil, bien ou mal, noir ou blanc. Évidemment, pour ceux dont le langage est entièrement « mal », l’issue est incertaine, ou plutôt trop certaine dans 80% des cas.
Ce qui nous amène à ce qui se cache d’essentiel derrière ces considérations sur la norme et que, même à gauche, on ne perçoit pas très bien parce qu’on est, à juste titre, obsédé par l’idée qu’il faut, à tout prix, faire accéder les enfants aux registres supérieurs, au haut de gamme, aux « niveaux de langue » de l’élite intellectuelle, lesquels sont (ne faisons pas de racisme social à rebours) adaptés à leur propres besoins de communication.
4 — norme et haut niveau
On a beau n’être pas du tout convaincu qu’il faille une certaine langue pour certains niveaux de pensée, on a beau pouvoir affirmer sans crainte que toute langue déborde de richesses et peut produire à l’instant les moyens indispensables à la pensée, que la langue, par définition, est un outil souple et polyvalent à la mesure du cerveau de l’homme, lui-même sans limite connue (c’est prouvé par les dernières recherches qui concluent à la « plasticité cérébrale » jusqu’à un âge avancé), ça ne change rien au fait que, dans nos sociétés, ce n’est qu’avec un certain code qu’on peut avoir accès directement à certains contenus.
Ce code, d’autre part, en raison du type de « pratique langagière » de ses propriétaires, est sans doute plus stable (sans être pour autant moins vivant) que le ou les codes populaires. Les bourgeois intellectuels, dans leur travail quotidien, doivent en effet converser, en quelque sorte, avec des interlocuteurs du passé, auteurs d’ouvrages de référence encore utiles aujourd’hui pour faire les bons choix. Je dirais volontiers que, tout simplement, leur synchronie est plus étalée dans le temps.
La « langue soutenue » (« langue dominante »), en tant que parler synchronique, est donc objectivement supérieure à celle des « prolétaires », … que j’appelle ainsi faute d’un mot plus précis (langage, langage !). Le prolétariat d’antan, en effet, est pulvérisé, et chacun de ses grains de poussière s’isole dans ses rêves égoïstes et vains qui ne mènent à rien, sinon au front national. C’est pourquoi il faut que les « prolétaires » recommencent à parler ensemble, c’est urgent. Et sachent donc déjà - condition nécessaire - qu’il peuvent le faire. C’est pourquoi j’écris ce livre. Pour les militants qui survivent dans le tsunami.
Car réifier le « bon français », c’est confondre, évidemment, les lois d’une langue et la forme qu’elle prend ici ou là. Si je dis : « le tire-fort est nase » ou « la conjoncture est exécrable », j’emploie pareillement un nom sujet, un verbe d’état et un adjectif. Quant au vocabulaire, si « conjoncture » est improbable sur un chantier, il n’est pas absolument certain qu’une personnalité sache ce que c’est qu’un « tire-fort ». Cette personne, à priori respectable, n’a vraiment pas besoin de se charger la mémoire de cet objet ; pas plus que du prix du ticket de métro, question saugrenue et démagogique qu’on lui posa un jour, et bien propre à provoquer l’éloignement méprisant.
Ce que vous aurez compris en me lisant, c’est que la belle langue intellectuelle (et bourgeoise) n’est pas du tout surnaturelle, mais elle n’est pas non plus l’inverse, creuse, ridicule et méprisable. Elle permet de discuter de choses qui peuvent nous retomber sur le nez. Sur le nez des bourgeois aussi du reste - voir le texte sur les prédictions économiques.
La langue bourgeoise intellectuelle est bonne et belle pour ce à quoi elle sert et parce qu’elle obéit … aux lois naturelles. La langue des hautes couches n’est qu’une langue vivante semblable aux autres, mais bien vivante, et c’est pour cette raison qu’elle est forte dans son système social. Les élites, justement, ne parlent plus le latin, il y a belle lurette. Elles y tiennent à leur français, à leur pratique langagière. Leur français est un outil de travail efficace et souple, constructeur et diffuseur d’idées, rompu aux combats et agile au plaisir. Le grand bourgeois intellectuel parle en effet comme il respire. Il ne fait que ça et avec ça il dirige. Il travaille sans arrêt.
Mais pour les « petits instruits », les « bons usages » langagiers sont l’aspirine de la résignation intellectuelle. Ils offrent ainsi aux dominants le luxe du pilotage automatique de la population. Pourquoi s’en priveraient-ils ? Il faudrait seulement, prudemment, dans leur propre intérêt, qu’ils ne nous méprisent pas au point de « revaloriser » l’obscurantisme primaire, lequel, dans le désarroi d’un monde sans dieu et sans syndicat peut déraper sur n’importe quoi.
Conclusion :
L’école, avec les moyens qu’elle a, ne peut être que systématique ; pardonnez-lui ! Elle n’a pas les moyens d’une déontologie scientifique. Mais ce devrait être une raison essentielle et urgente pour que les enseignants s’imposent au moins le respect sourcilleux du référent.
Pardonnez quand même!
L’école élémentaire ne devrait être que le lieu de la logique concrète et de l’instrumentation sans prétention. On peut vivre ça du moins à la maison ; mais sans garantie pour polytechnique.
Un petit livre à offrir
Si vous avez de grands enfants, je vous recommande de les vacciner contre les idées reçues ; afin qu’ils sachent résister par eux-mêmes ; au moins hésiter avant de les transmettre à leur tour.
Offrez-leur « Le français sur le bout de la langue ». C’est un tout petit livre écrit exprès pour eux, édité par les Édition du Moutard ( [www.lemoutard.fr] ).
Henriette Walter, dont je vous ai conseillé des lectures, professeur de linguistique et membre du conseil supérieur de la langue française « a accepté d’être la conseillère scientifique de cette publication ».
Lexique
Pragmatique
« L’aspect pragmatique du langage concerne les caractéristiques de son utilisation (motivations psychologiques des locuteurs, réactions des interlocuteurs, types socialisés de discours, objet du discours, etc.) par opposition à l’aspect syntaxique (propriétés formelles des construction linguistiques) et sémantique (relation entre les entités linguistiques et le monde).
(DLL- dictionnaire de linguistique Larousse.)
L’approche pragmatique des faits de langue
« cherche à modifier le résultat de l’analyse sémantique par la prise en considération d’éléments extérieurs au texte analysé.
L’exemple classique, « pouvez-vous me dire l’heure qu’il est ? » est une question qui, au sens propre, appelle une réponse par oui ou par non. Les conventions sociales, qui déconseillent les formes trop impératives du type « dites-moi l’heure qu’il est ! » conduisent tous ceux qui entendent cette question à en modifier le sens, sans même qu’ils s’en rendent compte et à l’interpréter comme une manière polie de demander l’heure » (extrait du texte de La Recherche ch 9).
La pragmatique ouvre à la compréhension de la complexité réelle du langage. Elle permet de régler son compte au réductionnisme des cuistres, un réductionnisme « fort »(cf Atlan, lecture), trop fort, qui assène des vérités générales et définitives là où il ne peut y avoir que des vérités relatives et provisoires.
Mais pour les vrais scientifiques, par contre, quel casse-tête ! Le champ de recherche s’ouvre pourrait-on dire à l’excès. Les savants sont eux aussi réductionnistes, c’est à dire que, pour être minutieux, ils délimitent leur objet, puis vont jusqu’au bout de leurs hypothèses. Ils sont réductionnistes, mais par vertu, pour les besoins de la cause. Quoi qu’il en soit, et sans demander aux pragmaticiens que, pour nous faire plaisir à nous, ils mordent le trait (il faudra eux-aussi qu’ils délimitent), on peut attendre d’eux qu’ils éclairent l’horizon élargi des véritables pratiques langagière.
Lecture
Éloge du parleur moyen
Le philosophe Atlan (par ailleurs éminent chercheur scientifique) confirme dans cette page tout ce que j’ai pu lire ailleurs et vérifier dans ma vie avec mes amis de toutes conditions (et que j’essaie ici de transmettre avec ma compétence d’écriveur moyen) sur la richesse et la complexité irréductible de tout langage naturel.
On ne conclura pas de ce texte que quelques mots suffisent pour tout comprendre et tout expliquer (en lisant Atlan on s’apercevrait très vite du ridicule de cette petite idée). C’est tout à l’inverse. Mais à petit niveau comme à haut niveau, les lois sont les mêmes. Le scandale qu’il faut encore et encore dénoncer, c’est celui qui consiste à réduire l’usage qu’ont des mots les simples gens (ou les fameux « jeunes » qu’on désigne ainsi – ah le pouvoir des mots ! - avec des pincettes) à un système étriqué, « artificiel et formel » que même les ordinateurs bientôt vont dépasser ; mais, pour l’instant, ils n’y arrivent pas. Le langage des exclus est sans doute inapproprié à la réussite sociale, mais c’est une tout autre question. « Respect ! ».
«
la réalité sans être irrationnelle déborde le rationnel. D’où le vague et l’indéterminé qui caractérisent notre usage des mots dans notre langue de tous les jours. Ce vague, loin de n’être qu’une faiblesse ou un manque de rigueur comme on le croit souvent en prenant pour modèle un langage formel ou mathématique, est dans ce cas une source de richesse.
C’est la même richesse que celle de nos capacités linguistiques qui nous font sans cesse créer des significations nouvelles grâce au jeu que permet un certain vague et une certaine « dose » d’indétermination dans l’usage métaphorique des mots. C’est notre capacité de tolérer ou plutôt d’utiliser ce vague et cette indétermination dans les significations du discours qui nous permet de renouveler sans cesse notre façon d’utiliser le langage quand nous sommes confrontés à des situations nouvelles et de nouveaux cadres de référence. Et c’est cela qui distingue notre langage naturel des langages formels artificiels, que nous fabriquons avec la logique pour que des machines programmées puissent les utiliser. (Peut-être pourrons-nous faire des machines capables elles aussi d’inventer des significations nouvelles: comme nous l’avons vu, elles y arriveront probablement en étant capables elles aussi d’utiliser le vague et l’indétermination des significations qui leur seront données au départ [8.108].) C’est cette utilisation du vague que Wittgenstein découvrait en parlant de la « façon bizarre [8.109] » par laquelle nous comprenons la signification d’un mot avec l’infinité de tous ses usages potentiels quand nous le saisissons instantanément comme dans un éclair (as a grasp in a flash). Et, dans son analyse des Philosophical Investigations, Saül Kripke souligne à juste titre la relation entre capacité de comprendre la signification d’une procédure potentiellement infinie à partir d’un nombre fini d’exemples, et la sorte de vague (the vagueness) ou d’indétermination dans la façon dont cette extension à l’infini se produit [8.110]. Ce serait cela la « façon bizarre » dont parle Wittgenstein, bizarre, bien sûr, aux yeux d’un logicien pour qui les significations du langage ne pourraient être conçues que sous la forme de représentations en nombre forcément fini, par des états mentaux [8.111]. Ainsi, cette sorte de vague et d’indétermination n’est pas un manque de rigueur, mais le ciment fluide qui nous permet de vivre en recevant notre nourriture de divers champs qui ne se recouvrent pas et où les critères du vrai (et du bon et du beau) sont parfois contradictoires. C’est notre capacité à faire avec le vague qui nous permet de coexister dans l’ambiguïté de la métaphore et de la multiplicité des significations. Et c’est cette coexistence, qui est en fait un va-et-vient permanent d’un cadre de référence à un autre, qui permet l’apprentissage et la découverte du nouveau.
»
— Henri Atlan, « À tort et à raison. Intercritique de la science et du mythe ». p. 421, 422
Éloge du parleur rêveur
Presbytère, nom commun masculin
«
(À huit ans,) j’étais curé sur un mur.
Le mur, épais et haut, qui séparait le jardin de la basse-cour, et dont le faîte, large comme un trottoir, dallé à plat, me servait de piste et de terrasse, inaccessible au commun des mortels. Eh oui, curé sur un mur. Qu’y a-t-il d’incroyable?
J’étais curé sans obligation liturgique ni prêche, sans travestissement irrévérencieux, mais, à l’insu de tous, curé. Curé comme vous êtes chauve, monsieur, ou vous, madame, arthritique.
Le mot «presbytère» venait de tomber, cette année-là, dans mon oreille sensible, et d’y faire des ravages.
« C’est certainement le presbytère le plus gai que je connaisse … » avait dit quelqu’un.
Loin de moi l’idée de demander à l’un de mes parents : « Qu’est-ce que c’est, un presbytère ?»
J’avais recueilli en moi le mot mystérieux, comme brodé d’un relief rêche en son commencement, achevé en une longue et rêveuse syllabe … Enrichie d’un secret et d’un doute, je dormais avec le mot et je l’emportais sur mon mur. «Presbytère ! » Je le jetais, par-dessus le toit du poulailler et le jardin de Miton, vers l’horizon toujours brumeux de Moutiers. Du haut de mon mur, le mot sonnait en anathème : « Allez ! vous êtes tous des presbytères ! » criais-je à des bannis invisibles.
Un peu plus tard, le mot perdit de son venin, et je m’avisai que « presbytère» pouvait bien être le nom scientifique du petit escargot rayé jaune et noir … Une imprudence perdit tout, pendant une de ces minutes où une enfant, si grave, si chimérique qu’elle soit, ressemble passagèrement à l’idée que s’en font les grandes personnes…
- Maman ! regarde le joli petit presbytère que j’ai trouvé !
- Le joli petit… quoi ?
- Le joli petit presb…Je me tus, trop tard. Il me fallut apprendre - « Je me demande si cette enfant a tout son bon sens… » - ce que je tenais tant à ignorer, et appeler « les choses par leur nom … »
- Un presbytère, voyons, c’est la maison du curé.
- La maison du curé… Alors, M. le curé Millot habite dans un presbytère ?
- Naturellement. .. Ferme ta bouche, respire par le nez … Naturellement, voyons…J’essayai encore de réagir… Je luttai contre l’effraction, je serrai contre moi les lambeaux de mon extravagance, je voulus obliger M. Millot à habiter, le temps qu’il me plairait, dans la coquille vide du petit escargot nommé « presbytère… »
- Veux-tu prendre l’habitude de fermer la bouche quand tu ne parles pas ? À quoi penses-tu ?
- À rien, maman…… Et puis je cédai. Je fus lâche, et je composai avec ma déception. Rejetant le débris du petit escargot écrasé, je ramassai le beau mot, je remontai jusqu’à mon étroite terrasse ombragée de vieux lilas, décorée de cailloux polis et de verroteries comme le nid d’une pie voleuse, je la baptisai « Presbytère », et je me fis curé sur le mur.
»
— COLETTE, « Le curé sur le mur », La Maison de Claudine, 1922.
Américain ou chinois ?
[modifier | modifier le wikicode]
où l’orthographe éclaire la langue immobile ;
immobile enfin !
… Et pourtant elle tourne.
L’américain était so good …
Heureusement, le chinois est peut-être un idéal orthographique.
Nous arrivons au bout du voyage.
Au bout du langage ? Sur sa plus haute cime ?
Pour la langue orale, on n’était pas au bout de ses misères, mais on avait quand même repris quelques couleurs. Et comme au plus haut niveau on s’encanaillait, on pouvait profiter un peu de ce bénéfice secondaire de l’ordre « libéral ». Pour l’écriture, par contre, rien à faire, c’est bétonné.
Alors, n’oubliez surtout pas le monde merveilleux de l’oral, changeant, coloré, surabondant de richesses, parfois dangereux et problématique, mais vivant. Un monde dont les savants avouent qu’ils ne font qu’entrevoir les lois les plus essentielles, et dont ils se gardent, par conséquent, de présenter des simples aperçus comme des vérités intangibles et sacrées. Chers camarades, profitez de la liberté des paroles échangées entre amis véritables, en vous tenant éloignés des cuistres insupportables. C’est une morale provisoire, pas citoyenne du tout. Mais, paradis ou boule de cristal, personne n’ose affirmer, aujourd’hui, que la vie ici-bas a un sens précis et limpide. Pourtant, c’est cette vie et pas une autre, autant la prendre au mieux. La langue peut être un plaisir. Plaisir et nécessité, l’un n’exclut pas l’autre :
- soit qu’on la pratique (poésie, théâtre, débats philosophiques et politiques …),
- soit qu’on l’étudie pour elle-même, comme le moteur de sa voiture, pour s’épargner des frais de garagiste ; ou comme un violon d’Ingres (et je serais grandement gratifié si j’avais glissé cette idée saugrenue dans vos têtes).
Saugrenue … et subversive ; car, un jour, avec voix au chapitre. Il faut s’entrainer.
Parce que nous, nous ne rêvons pas de démocratie autogestionnaire pour rire. Comme chacun sait, le communisme a échoué ; mais, comme le capitalisme nous conduit à l’abime, que celui qui voit une autre alternative que la citoyenneté participative … l’écrive. Pour les urgences du temps présent, la langue ne peut pas devenir un privilège. Il faut répondre aux exigences sociales et techniques et ce ne peut être au prix d’une régression anthropologique qui nous ramènerait en deçà des débuts de l’humanité (cf lecture « les indiens blancs », où l’on voit que, sur le plan du langage, ces soi-disant sauvages étaient plus civilisés que nous).
Ça va être dur, très dur le dernier chapitre.
N’espérez surtout pas planter le drapeau noir sur le dictionnaire. Quant à y mettre le bonnet rouge, comme s’en vantait le père Hugo, l’histoire vous a rendus à juste titre méfiants. Mais c’est pas une excuse. La dialectique, c’est le dépassement des contradictions, pas leur mort ( je reste marxiste). Les contradictions, ça a la peau dure, l’utopie ne les digère pas. Pour vous dire d’emblée que l’orthographe française n’est pas près d’être simplifiée substantiellement ; autant vous prévenir tout de suite. Donc, il faut l’apprendre. Ou ruser avec. Car quand je vous aurai exposé toutes les bonnes et mauvaises raisons qu’on invoque pour ne pas y toucher, vous vous sentirez tout de même un peu plus légers. Non, les fautes d’orthographe ne rendent pas sourd.
1ère (mauvaise) raison :
C’est un monument historique
∼ Bravo ! Splendide ! Il faut surtout le conserver intact ; et organiser les visites. On pourrait en tirer des devises ; faire des charters de Chinois : nul doute qu’ils apprécieraient.
2e raison (agaçante mais discutable) :
C’est « une politesse ». Citation d’Alain, célèbre philosophe de l’instruction publique de la 3e république, mise en exergue au « code orthographique et grammatical » de Thimonnier qui fut grand prêtre et prophète de « l’orthographe raisonnée » dans les années 70 ; et dont les idées n’ont pas pris une ride chez les gâteux. Pour ce qui concerne la raison morale, l’opinion est discutable ; voici donc la citation d’Alain in extenso : « L’ordre humain se montre dans les règles, et c’est une politesse que de suivre les règles, même orthographiques. Il n’est point de meilleure discipline »
∼ Oui, M.Thimonnier. Entendu, M.Thimonnier. Adieu, M.Thimonnier (comment, on n’a pas renouvelé les fleurs sur votre tombe ? Je proteste : vos idées étaient exécrables, mais votre « code orthographique » particulièrement pratique et facile à consulter -on peut l’acheter sur internet)
Mais attention ! la politesse est une chose, la politique responsable en est une autre. « Il ne faut pas affaiblir l’interdit », ç’a été dit à l’occasion des élections à propos du cannabis. Les moyens d’application de la discipline, cependant, font la différence. Au Far West, on pendait haut et court ; en Chine moderne, on met une balle dans la tête. En France, au début du XXIe siècle, on se demande si la loi sur les mineurs ne doit pas être révisée. Il faut toujours avoir les moyens de sa politique et la fin justifie toujours les moyens. Mais on a toujours en France le droit de voter. Rappel : c’est pas aux « salauds » que je m’adresse (Qu’est-ce qu’un salaud ? « C’est un égoïste qui a bonne conscience » - Comte-Sponville), mais aux éternels militants d’un monde meilleur.
3e raison (insignifiante) :
C’est un « système »
(toujours Thimonnier. Mais il n’y a pas que lui. Paix à son âme !).
∼ Ah ! ces grands mots pour gouverner à droite. Il faut répondre par d’aussi grands mots ; c’est pourquoi j’ai essayé de vous les faire connaitre.
Le code orthographique et grammatical est un système, certes, mais est-ce un système fonctionnel ? Hé, hé !
Pour fonctionner, il fonctionne, ça c’est indubitable. Voyez la démonstration :
Il existe un système et tout le monde doit y être dressé. Quand on y a été dressé, tout changement produit un trouble et évidemment des difficultés. Donc, le système actuellement imposé est fonctionnel.
C’est l’histoire même de l’expérience sur la grenouille conditionnée à bondir au coup de sifflet. Quand on lui a coupé toutes les pattes, elle ne bondit pas du tout. Donc, quand on coupe les pattes d’une grenouille, elle devient sourde.
Des « systèmes » de ce tonneau-là, on peut évidemment en inventer des tas et des tas qui fonctionnent aussi bien, dont la fameuse machine à double échappement et arbre à cames en tête pour décortiquer les cacahuètes de l’apéritif. Tous les savants Cosinus en ont plein la tête des systèmes comme ça. Et qu’est-ce qui leur manque donc ? Comment ça marche ? Non : à quoi ça sert ? Personne n’a encore démontré que notre orthographe était plus fonctionnelle que par exemple celle des Italiens. Mais enfin, dans le doute, abstiens-toi. Si elle était fonctionnelle, alors on regretterait de l’avoir perdue et on risquerait d’avoir à en inventer une autre. Pire ? Brr ! Gardons-la.
Pire, ce n’est pas une idée folle. Pour communiquer vite fait bien fait avec le minimum de geste et d’espace, on invente (« à la base », rien à dire, c’est jeune et populaire) le sms et l’argot internet, salmigondis phonologique, syllabique, morphémique et iconique qui tend, lui, « fonctionnellement », à se codifier. Imaginons qu’il devienne une compétence exigée dans le labeur tertiaire concurrentiel … (nous suggérons plutôt une actualisation de l’alfonic - voir plus loin.)
4e raison (discutable, mais pertinente) :
Raison qu’on pourrait ramener à la raison précédente, mais qui, en elle-même, est beaucoup plus modeste : C’est efficace pour ce qu’on veut faire avec.
| « Montagne Deux alpinistes tuées par des chutes de pierres Deux alpinistes, âgées de 28 et 49 ans, ont été tuées par des chutes de pierres, samedi 29 juillet, dans le massif du Mont-Blanc, vers 3800 mètres d’altitude. Les deux femmes, encordées, redescendaient de la dent du Géant… » – Le Monde , mardi 1er aout 2006 |
« la Défense La plus forte concentration de salariées d’Europe « La hâte quand on arrive ici, c’est de repartir » Près de 20.000 femmes, sur 40.000 salariés, viennent travailler quotidiennement à la Défense. Elles n’ont qu’une hâte : en repartir. Le gouvernement envisage d’aggraver les choses en doublant le nombre de bureau, … » – l’humanité , jeudi 16 novembre 1978 |
∼ C’est tout à fait vrai. Observez (ci-contre) ces deux articles de journaux qui informent d’un fait notable. L’information est d’importance puisqu’il s’agit pour l’un de « femmes en lutte », pour l’autre de femmes « alpinistes » et non de quelconques travailleur(euse)s ou sportif(ve)s. |
Il n’est pas évident qu’une lecture rapide du titre des articles vous ait immédiatement alerté(e)s. Ça voudrait dire, pauvres ignares, que le code orthographique n’aurait pas fonctionné pour vous à ce degré de précision. C’était tellement probable que, dans le corps de l’article, les journalistes ont jugé nécessaire de « rajouter du lexique » (et non de la grammaire – revoir ch.4) pour bien préciser qu’il s’agissait de femmes. Il y avait des milliers de lecteurs(trices) à qui ce détail ne devait surtout pas échapper pour la conduite des luttes sociales ou féministes, et les journalistes, qui connaissent leur monde, ne pouvaient pas l’oublier.
C’est à dire que la langue écrite, avec ses ressources multiples (ah ça, elle n’en manque pas!), s’est mise au service des hommes ou femmes intelligent(e)s qui ne confondent pas la fin et les moyen et qui, pour vivre, savent faire feu de tout bois.
L’orthographe permet même de rire ; avec cette pub de la SNCF sur sa « nouvelle carte de fidélité voyageur » : « Multipliez les hâlés retour »
Les linguistes ne sont pas en peine de trouver d’innombrables faits, beaucoup plus complexes, qui prouvent que l’orthographe, malgré ses difficultés, est un système en effet, précis et efficace pour l’usage essentiel qu’on en fait : communiquer à distance un ensemble complet et clos d’informations à l’usage de gens qui ne pourront réclamer, et pour cause, en cas d’ambigüité ou d’obscurité, aucun renseignement complémentaire. Là est la fonctionnalité véritable. Si on n’a pas bien compris, il suffit de relire attentivement : on a, sous les yeux, tout ce qu’il faut pour comprendre. On peut tourner et retourner les titres des articles ci-avant dans tous les sens, les trouver, selon son humeur, super astucieux ou tirés par les cheveux, en tout cas, c’est une merveille de concision et de précision. Il faut donc admettre l’efficacité d’un petit « e » pour délivrer en aussi peu de place autant d’informations.
… À condition de savoir les règles d’accord. Mais, répond-on, il n’y a qu’à les apprendre.
5e raison (contestable, mais scientifiquement envisageable) :
Raison qui engloberait alors, péremptoirement, les deux précédentes) : Que ça vous plaise ou pas, c’est une structure.
Il se serait produit, pour l’écriture, ce qui est la loi fondamentale de toute langue : sans s’en rendre compte, par tâtonnements multiples, en fournissant éventuellement et avec naïveté de pseudo-explications, les générations « d’écriveurs », pourtant infiniment moins peuplées que les générations de « parleurs » (car tout le monde parle, mais peu de gens écrivent) auraient quand même, « naturellement », réussi à fabriquer une véritable structure linguistique adéquate aux besoins d’une société. C’est la thèse longuement argumentée qui apparait dans un petit livre de vulgarisation que maintenant je peux vous recommander aussi car vous n’êtes plus naïfs (« orthographier » - Michel Fayol, Jean-Pierre Jaffré – PUF). Voici une citation qui résume parfaitement la thèse rigoureuse qu’il n’est pas permis d’ignorer : « oral et écrit coopèrent pour permettre un maximum de variation sémantique dans un espace minimal »(dernières pages du ch.6). Je ne me permettrai pas de développer davantage car vous savez maintenant parfaitement ce que cela signifie. Et vous avez déjà le droit de poser la question encore plus fondamentale : pour quelle société ?
5e raison bis (à faire se dresser les cheveux sur la tête) :
C’est désormais la structure dominante, stabilisée, définitive, parfaite, et éternelle puisque parfaite, correspondant à l’état actuel de développement de la civilisation.
Évidemment, l’écriture ne pouvait pas être la structure des structures au temps où l’écriture n’existait pas (encore qu’il existe des philosophes idéalistes pour penser que tout est … écrit d’avance). Mais, d’un strict point de vue synchronique, des savants linguistes croient pouvoir prouver que les lois les plus générales d’une langue de culture sont désormais dans l’écrit. Ce serait un changement qualitatif inversant les données jusqu’alors admises d’une langue vivant d’abord des communications orales d’un peuple.
Nous laissons les savants linguistes à leurs savants débats, et nous revenons à l’observation terre à terre des effets produits sur nous. Car, en tout état de cause, rien n’a été conclu ; la plupart des autres savants linguistes, avec des nuances diverses, soutiennent toujours la thèse de la prééminence de l’oral, sans nier ce qui est spécifique à l’écrit. Les exemples que j’ai fournis tendraient en effet à prouver qu’il y a des lois particulières à l’écrit, des lois particulières à l’oral et des lois communes. J’essaie de résumer dans le schéma ci-après.

Il faut bien prendre conscience que ce schéma n’est pas un vague résumé de querelles byzantines. L’idéologie dominante correspond au dessin n°3. Cette idéologie s’exprime comme une évidence dans nombre d’outils pédagogiques. Ainsi dans ce « petit guide de la grammaire », déjà signalé, qui se vend sur les autoroutes, on écrit : « Du temps où les règles de grammaire n’étaient pas encore totalement fixées, le vieux français jouissait d’une certaine liberté de ton. » Mais il y a pire, et plus hypocrite. Thimonnier, ce vieux réac de Thimonnier distinguait la syllabe orale de la syllabe écrite ; « Ma méthode de lecture syllabique » (Hatier) condescend seulement à informer l’apprenti (page 9), par une petite note en bas de leçon appelée « astuce » (?), qu’« on ne prononce pas toujours le e quand on parle : un ch’val, la lun’. Mais on l’écrit toujours. » C’est quand même mieux que « la tu lipe de Valérie ». Mais qu’est-ce qui commande ? non mais des fois ! …
Cette doctrine eschatologique de « l’être devenu » et de « la fin de l’histoire », qui, à l’évidence, satisfait l’âme de ces pédagogues, est acceptable philosophiquement ; elle est peut-être vraie « pour de vrai » politiquement ; mais, morbleu, palsambleu, scrogneugneu ! qu’on annonce la couleur de sa conception du monde. Il y en a d’autres. Pas moins anxiogènes d’ailleurs.
6e raison (incontournable, et plus terre à terre … et pas moins anxiogène) :
L’unité nationale
Vous savez que « ne pas avoir d’accent, pour « eux », c’est en avoir ». Et je ne vous parlerai même pas des Québécois et des Gabonais. Pour ne brimer personne, en ces temps de renouveau des régionalismes, il faudrait, si on désirait écrire phonétiquement, autant d’éditions de journaux et de livres qu’il y a de régions, et même de quartiers. On conçoit que, devant ce tintouin, on préfère couper court et dire « pas touche ! C’est sacré. Retire ton béret et dis bonjour à la Grande Dame (l’Académie) ».
On ne va pas dire non plus : conformez-vous au parler des catégories sociales dominantes. Ça ferait peu démocratique. Surtout si c’est « la bourgeoisie intellectuelle parisienne » ; là ça foutrait en l’air tous les schémas d’analyse politique classiques de gauche.
N’abordons surtout pas ces questions. Tout ce qui a un peu le sens de l’Etat et de la survie nationale répète : « c’est sacré » (version laïque : « c’est beau »). Mais comme personne n’est à l’abri du changement linguistique, on est inexorablement conduit à « décrocher » l’écrit des parlers réels (de tous), au risque d’en faire ce que Martinet appelait une « langue liturgique ».
… Vous venez, n’est-ce pas, de voir réapparaitre le désir de latin à vocation universelle (je vous disais, dans l’introduction, que le plan du livre n’était pas au hasard). Celui-ci étant hors de question (encore que quand s’était amorcée la réaction anti-laxiste, il soit revenu très fort), nous aurions, plus banalement, un code écrit jouant le même rôle dans la Francophonie, une langue de la culture générale et des discours essentiels. La langue de la Loi. Langue qui a mis longtemps à affuter et polir ses rouages, mais désormais parfaitement au point, etc, et qu’on décide de fixer une fois pour toutes afin qu’on ne perde pas son temps à ergoter sur des formes vivantes et capricieuses. Ainsi on peut penser que si la réforme de 90 passe doucement dans les mœurs, c’est surtout parce que personne ne se souvient qu’elle a eu lieu : personne n’en réclamera une autre.
Ce qui justifierait, d’un autre point de vue, la théorie d’une structure dominante du langage surgie du progrès humain comme forme définitive et désormais immuable des langues nationales ; avec effet en retour inévitable (faisons confiance aux puristes) sur l’oral sommé de se conformer à l’écrit. Ceci dans un esprit libéral : « le pe tit beu rre » est la forme canonique, « le p’tit lu » l’expression de la liberté. Merci Madame Tatcher !
Je pense personnellement que ce n’est pas par rapport à la langue « en soi » qu’il faut poser les problèmes, à chaque coup on est piégé par les réactionnaires, mais par rapport aux pratiques réelles qu’en ont les hommes. On peut devenir bilingue ou multilangue. Si l’espèce est vraiment pourvue d’une machinerie à digérer les langues dès le naissance, il serait surprenant qu’elle ait été réglée pour les caprices orthographiques. Par contre, les sourds et muets ont développé entre eux une langue des signes qui fonctionne très bien ; apprise sans école et parfois contre l’école ; ce n’est donc pas la forme orale qui est décisive.
Une langue vivante nationale doit-elle nécessairement être orale ? C’est la grande question théorique qui mérite d’être posée. Mais, pour y répondre, il faut affronter le fait incontestable que certains arrivent facilement à être bilingues ou multilingues (y compris orthographiques) et tant d’autres pas. On peut donc légitimement penser, avec les psychanalystes, que la question essentielle est nichée dans les « blocages psycoaffectifs », c’est à dire pour moi, selon la conception du monde à laquelle j’ai toujours droit (à condition que je reste paisible), « en dernière instance », dans les rapports sociaux, « l’inconscient de l’inconscient de la psychanalyse » disait Clousquard. Je pense alors que si la communication écrite était démocratisée pour de vrai, on pourrait même se passer des psys sur ce sujet : le code écrit finirait par évoluer pour optimiser l’orthographe active (cf Gruaz et Chervel ci-après). Mais c’est une pure fiction.
Pour s’en convaincre, il faut se préoccuper des fonctions sociales du langage (pas seulement des célèbres fonctions de la communication interindividuelle explicitée par Jakobson). Les linguistes les ont un peu mises à part parce que, en science, il faut définir précisément son objet d’étude et ne pas parler de tout à la fois.
Mais ces fonctions sociales sont précisément celles qui empêchent la parole, bien davantage que les « maladies » qu’on détecte au niveau des individus et qu’ensuite, si on en a les moyens publics ou privés, on soigne au moyen de toutes sortes de thérapies, après avoir établi une nomenclature descriptive de plus en plus détaillée des troubles (voir dys et a lexi, praxi et graphie sur internet). Bon voyage dans ces soins médicaux sans doute utiles ; mais aussi dans l’énorme querelle entre les psychanalystes, les comportementalistes et les organicistes pour savoir lesquels conviennent le mieux.
Pendant ce temps, les fonctions sociales du langage sont à l’abri de la curiosité citoyenne. Je les rappelle donc, elles sont trois :
- la véhiculaire dont nous venons de parler ; sans doute la plus essentielle ;
- la savante, celle qui exige une précision parfaite des mots et des discours (mais tout le monde, dans son domaine de spécialité, devient savant);
- la disciplinaire .
On ne peut pas les écarter d’un geste de colère, parce qu’elles sont nécessaires dans toutes les sociétés connues. Quand il s’agit de la paroles pharaonique gravée sur les murs des temples devant lesquels on se prosterne, cela relève du rôle d’opium du peuple bien connu, qui n’empêche pas de parler chez soi à la veillée. Mais quand, paradoxalement, après le triomphe de la démocratie élective et les incontestables bienfaits de l’instruction publique, ça perturbe jusque dans les détails de la vie le pouvoir universel de parler, on se doit de réagir et d’interroger les lois obscures (et cependant évidentes) qui permettent cette monstruosité.
Et comment agir ?
Pour ce qui concerne la langue orale, il suffit de lui redonner le gout de vivre. Mais l’écriture, ne pourrait-on pas au moins la simplifier ? À ce qu’on sache, ni les Turcs ni les Italiens ne sont des débiles mentaux.

Il faut dénoncer l’incroyable arnaque de l’emploi du mot « usage » à propos de l’écrit. On ne peut mieux le faire qu’avec ce petit dessin paru dans une publication de feu l’Airoé, l’association qui défendait la réforme de 90.
Et ensuite affronter la complexité du dossier (comme le fait le livre « orthographier »), mais avec une boussole idéologique : la distinction lumineuse que nous propose Chervel entre l’orthographe active et l’orthographe passive.
Je vote pour l’orthographe active et les simplifications « drastiques » qu’elle exige afin que la communication écrite ne soit plus à sens unique dans la société. Je n’aurai donc aucun scrupule si des simplifications substantielles fabriquaient quelques imprécisions. Selon mon idéologie, c’est celui qui écrit un message qui en a la responsabilité ; c’est à lui de rajouter du contexte s’il pense qu’il y a un risque de confusion (cf Luis Prieto). Si, dans la mosaïque finale d’une orthographe simplifiée, on alourdit un peu la communication subtile, je pense que la civilisation pourra supporter au regard du gain de réciprocité tranquille. Ce serait un système tout aussi fonctionnel que celui qu’on a, mais pour une autre société.
Une société égalitaire l’aurait sans doute déjà inventé sans même sans préoccuper. C’est donc une pure fiction. Mais ça vaut la peine à la fois d’être lucide et de rêver pour ne pas mourir idiot. D’autre part et désormais, dans une société démocratique, le moindre espoir de progrès et de justice passe par la lucidité collective. Donc, poursuivons. Mais pour cela il ne suffira pas d’être rationnel, il faudra mettre sur la table les choix idéologiques.
Alors …
yaka … sortir par le haut
Par le haut ! Voici une excellente idée ; nous t’écoutons.
Si on le voulait, on pourrait sans aucun doute construire, en chaque citoyen, cette capacité de prendre la parole orale ou écrite en « bon français » qui est le rêve, à un moment, de chacun et la promesse répétée des Républiques. Ce pourrait être le projet ambitieux des nations de la Francophonie et, pour l’humanité, s’il réussissait (la situation étant peu ou prou la même dans de très nombreux pays dans d’autres langues) un nouveau « pas » en avant, aussi important peut-être que celui qui a consisté à envoyer naguère des hommes sur la Lune.
Gardons cet exemple comparatif.
Quand le gouvernement des États-Unis eut décidé de réaliser l’exploit, pour damer le pion aux Soviétiques, il ne donna pas pour mission à des savants et des techniciens rassemblés à la hâte, de récupérer ici et là quelques tuyaux de poêle et surplus de la guerre précédente, de bricoler avec une sorte d’astronef de science fiction, le bourrer de pétards de feu d’artifice (pour que ce soit plus beau aux actualités télévisées) et d’allumer la mèche un beau soir de juillet au moment du creux politique.
Le premier travail consista en ce qu’on appelle une « étude de faisabilité ». C’est à dire que des gens très compétents travaillèrent d’arrache-pied pour simplement dire si c’était « faisable » d’aller sur la Lune, et à quel cout final estimé. Puis on mit sur pied une organisation de plus de 300000 personnes, la NASA (incroyable entreprise d’État au royaume du libéralisme), armée d’ordinateurs jusqu’aux dents et appuyée sur toute l’industrie américaine ; qui réussit finalement l’entreprise.
Dans notre affaire, la question posée est : est-il possible d’équiper chaque nouveau petit Français et francophone du XXIe siècle en « français correct » et en orthographe infaillible ?
C’est quand même moins difficile d’être « élitaire pour tous » que d’aller sur la Lune.
Non ? Vous n’êtes pas convaincus …
Reste alors la liberté d’entreprendre. C dans l’air.
L’alfonic sur smartphone.
L’alfonic, inventé par Martinet, est une écriture rigoureusement phonologique qui avait deux objectifs :
- Le premier, d’offrir une écriture pratique (démotique) aux usagers. Il n’était pas question que ce code substitutif remplace l’orthographe officielle, mais il pouvait rendre service.
- Le second d’être un outil pédagogique pour permettre, dans l’univers clos et intime de la classe, l’expression écrite au plus vite.
L’alfonic révèle concrètement les rouages phonétiques du polysystème de l’écriture, mais en aucun cas ne traite celui-ci par le mépris : tout texte écrit, pour être présenté à l’extérieur de la classe, doit être réécrit en langue officielle. Bonjour le travail de correction ! Mais écrire, par contre, pour un enfant, n’est plus une tâche terrifiante, c’est très vite un plaisir. « Lire, lire, lire » entend-on dire partout avec des trémolos de compassion ou d’indignation civique. Mais le travail républicain, c’est lire et écrire. En fait, comme l’alfonic est aussi, par définition, un excellent outil de renforcement de la méthode syllabique, si ceux qui ne jurent que par elle ne l’ont pas adopté, c’est parce qu’ils ont autre chose en tête.
Malheureusement, Martinet ayant inventé son alfonic à partir des contraintes du clavier des machines à écrire de son époque, on n’a pas cessé de lui reprocher les petits accommodements qu’il avait dû proposer pour avoir un son <-> une touche. Le pire, c’était x = [e] ; ce x allait perturber tout l’avenir orthographique. Évidemment ! …
L’informatique permet d’inventer aujourd’hui pour les portables les quelques signes qui manquaient. Pour remplace les digrammes on, an, in, ch, ou, voici ce qu’on peut proposer en s’inspirant du clavier TLF (ch 7.1) de 28 signes (le ng de parking en moins).
On, an, in, ch, ou >>> õ, ã, ĩ, h, û (on peut en choisir d’autres).
Et pendant qu’on y est, camarades informaticiens, voudriez-vous bien aussi remplacer l’accent aigu choisi par le TLF pour l’archiphonème de é-è par un ē « accent plat », comme l’avait souhaité Madame Catach.
Voici ce qu’un libre créateur en informatique peut certainement nous proposer, sur la base du clavier azerty pour ne pas trop dépayser ses camarades :
| a | z | e | r | t | y | u | i | o | p | û |
| s | d | f | g | h | j | k | l | m | ē | |
| w | v | b | n | ã | ĩ | õ |
Évidemment, la proposition n’est pas sans présenter des difficultés. Il faut être lucide ; pas de miracle en vue : ĩ ēlēfã sa trõp … sa ou ça ? Qu’est-ce qu’on en fait de « sa » trompe ?
Mais avec les outils informatiques, comment se débrouillent les Japonais et les Chinois pour « idéographer » ? (voir « lexique » ci-dessous) On peut faire confiance aux géniaux informaticiens occidentaux pour faciliter les traductions orthographiques sur smartphone de cet alfabé (dans les limites « pragmatiques » - voir le chapitre 9). La dictée vocale sur smartphone a déjà réglé le problème.
Par ailleurs, les chercheurs d’Érofa publient le bilan de leurs travaux pour une simplification raisonnable de l’orthographe française. Ainsi, des convergences se précisent, non centralisées, non étatisées, … libres. Vive la liberté ! Le but n’est pas de remplacer l’écriture du français par un système phonétique, mais de mettre les « Petites Poucettes » (et aussi les « Petits Poucets » !), tous ensemble ouē, sur le chantier de la communication langagière démocratique.
Débrouille en attendant
Mais débrouille solidaire. Car, dans l’idéologie dominante : liberté (concurrentielle) → charité (aide aux devoirs et tutti quanti).
Égalité → solidarité.
Solidarité au sens du dictionnaire (cf ch 9bis). Les dominants (et ceux qui les admirent) détestent la solidarité. Par contre, ils aiment beaucoup la charité, ça coute moins cher que la sécu.
On a le droit, avec ses amis, en république (surtout libérale), de ruser avec l’orthographe sacrée.
D’abord en utilisant au mieux les correcteurs orthographiques. Il faut connaitre à la fois leurs immenses capacités et leurs limites. Il faut se méfier surtout des homographies que l’ordinateur est incapable de repérer ; mais on n’est plus obligé de classer dans sa mémoire les fioritures de chrysanthème, à moins de les trouver belles.
Il faut apprendre aussi à apprivoiser quelques règles grammaticales terrifiantes en osant les regarder dans les yeux (ce que propose la partie « règles » d’orthograve par où vous êtes sans doute passé avant d’affronter la « politique »).
Ou encore, tirer profit des déconvenues de ceux qui hier encore disposaient de secrétaires et qui doivent désormais affronter directement le clavier ; ils se payent des « cotchs » pour éviter le pire. L’un de ces coachs a écrit un excellent livre rempli de trucs et bouts de ficelles. Dans le genre, on n’a jamais fait mieux ; les astuces débordent de partout. On pourrait même croire que c’est limite pour la mnémotechnie ; les vieux instits ayant déjà choisi depuis longtemps le juste nécessaire (« je m’aperçois qu’apercevoir … »). Mais ce coach n’est pas stupide non plus : il explique à ses ouailles que les mots à mémoriser, il faut les choisir selon l’urgence du boulot. Il s’agit de gagner du temps et de la peine. Au boulot ; pas dans « l’école libératrice » ! L’idéologie sous-jacente est modernement cynique, mais l’outil est utile aux faiblards de l’hippocampe ; y compris pour ses conseils psychologiques sur le fonctionnement du cerveau ; un jour peut-être ils serviront à l’école :
« La mémoire fonctionne quand nous mettons une réalité derrière et lorsque nous rions. »
Bernard Fripiat, coach d’orthographe (99 questions à mon coach d’orthographe, éditions DEMOS 2008, p 114)
Donc, rions, rions … Après s’être fait flageller, cessons de nous flageller nous-mêmes.
Et organisons de vraies solidarités. Les ateliers d’écriture en font partie. C’est un excellent outil. À condition qu’ils soient vraiment respectueux, pas en quête de « talents » cachés. Le n°243 de septembre 2017 de la revue Quart Monde en parle dans un dossier intitulé « Les mots » :
« L’expression personnelle et collective passe par les mots, même pour ceux et celles qui ont peu fréquenté l’école ou en ont gardé de mauvais souvenirs. Pour les réconcilier avec le verbe, oral et écrit, rien de tel que l’atelier d’écriture. L’atelier postule d’emblée que nous sommes tous et toutes capables d’écrire, comme l’ont montré des groupes d’éducation nouvelle. Je cite Michel Neumayer, qui affirme lors des Premières rencontres nationales des ateliers d’écriture :
« Si je me place du point de vue de la citoyenneté, il apparaît que le risque est grand d’une société à trois vitesse, où se côtoieraient :
- Ceux qui ne savent ni lire, ni écrire
- Ceux qui ne savent que lire
- Ce que d’autres, qui savent lire et écrire, écrivent !
Cette coupure, cet éclatement du lien social, confirme qu’à l’échelle de la société tout entière persiste le refus de considérer que tous les Hommes sont égaux : ils le sont en droit certes (c’est inscrit dans la Constitution), mais le sont-ils de fait ? »
[… dans les ateliers d’ATD Quart Monde] les personnes les plus éloignées du système scolaire, les moins à l’aise avec les subtilités grammaticales et la complexité de l’orthographe peuvent s’exprimer, dans un climat d’écoute bienveillante, sans jugement. »
— Marie-Noëlle Hopital, Quart Monde. n°243 de septembre 2017. « Les mots » p 26 et 27
LEXIQUE
Types d’écriture
En interrogeant l’histoire humaine, on peut distinguer deux grands types d’écriture :
1- les écritures idéographiques centrées sur la première articulation
(chaque « idée » → un signe – idéogramme-)
2- les écritures dites alphabétiques centrées sur la seconde articulation
(chaque phonème de la langue → un ou plusieurs signes)
1- Les idéogrammes sont des signes écrits qui, comme leur nom l’indique, traduisent une idée, directement. À l’origine, il y a des pictogrammes, c’est à dire de petits dessins représentant de façon stylisée, mais cependant ressemblante, la chose évoquée.
Par exemple (inventé) :
![]() signifiera « maison », mais aussi, car il y existe des idées abstraites qu’il faut aussi écrire : « habiter, abriter … » voire, dans un sens encore plus figuré, « protéger, etc ».
signifiera « maison », mais aussi, car il y existe des idées abstraites qu’il faut aussi écrire : « habiter, abriter … » voire, dans un sens encore plus figuré, « protéger, etc ».
L’idéogramme, par commodité d’écriture, pourra se transformer en signe abstrait, dans lequel il faudra beaucoup de bonne volonté pour reconnaitre le pictogramme d’origine. En fait, pour celui qui apprend, il n’y a plus conscience d’une ressemblance. Le signe n’est plus « motivé » par cette ressemblance lointaine. Il est devenu arbitraire.
![]() Par exemple (inventons toujours) → ∧ → ∨ →
Par exemple (inventons toujours) → ∧ → ∨ →
Une écriture idéographique comporte nécessairement un grand nombre de signes. Problèmes informatiques à part, les mots écrits chinois ne devraient pas, à priori, être plus difficiles à apprendre que les monèmes également arbitraires de l’oral. Mais les monèmes de l’oral (leurs sons et leurs règles de combinaison), sont, si l’on peut dire, déjà acquis quand on commence à y réfléchir ; la petite enfance, jour après jour, a été consacrée à les assimiler. Dans les écriture idéographiques, il faut vraiment tout reprendre à zéro au moment de l’apprentissage.
Les Chinois ont la plus grande peine à apprendre leur écriture idéographique, et de nombreuses tentatives ont été faites pour y substituer une écriture alphabétique (le pinyin). Mais la nation chinoise conserve son écriture traditionnelle, embellie par l’art et chargée de culture ; aussi parce qu’elle est véhiculaire, elle est la langue commune aux différents peuples formant la Chine. Si∧ représente l’idée de maison, le signe pourra toujours être dit dans une langue quelconque d’un bout à l’autre du pays, il n’y aura qu’une édition du petit livre rouge (ou de tout autre couleur de saison). Ainsi, la diversité linguistique se révèle toujours être un luxe … et un risque politique dans un pays unifié.
2- Le écritures centrées sur la 2e articulation opèrent un retournement radical puisque, délibérément, au risque de diversité galopante, elles acceptent de se mettre sous la dépendance de l’oral. Le monème d’une idée n’est pas un autre monème, de forme (de signifiant) radicalement différent de celui de la langue maternelle parlée, mais une certaine copie de ce dernier. Ceci selon des modalités très diverses dans l’histoire.
Les Égyptiens adoptent, au milieu d’un système idéographique, d’astucieuses charades, puis l’équivalent d’un alphabet (déjà le plurisystème !).
Les Phéniciens, en tant que commerçants pratiques, inventent un système phonologique ultra simple qui ne note que les consonnes (leur langue s’y prêtait, comme encore l’arabe aujourd’hui ; mais Thimonnier n’aurait pas aimé).
Il résulte de ces innovations une simplification de l’écriture. Plus l’écriture colle à l’oral, plus elle est simple à apprendre (c’est une lapalissade), mais plus il est difficile aussi de lui donner un rôle véhiculaire stable. C’est dans le cadre de cette réalité « politico-linguistique » qu’il faut placer le débat sur l’orthographe, où les choix faits par les uns et les autres, lucides ou pas, traduisent d’abord des options idéologiques dans l’exigence absolue du compromis.
- Démotique
- Ce mot doit entrer maintenant dans le lexique des réflexions et discussions :
PLI2016 : « adj. Et n.m. (du gr. Dêmos, peuple). 1. Se dit d’une écriture cursive de l’ancienne Égypte (VIIe s. av. J.-C.-Ve s. apr. J.-C.), dérivée de l’écriture hiératique. »
Il y a donc près de 3 millénaires que la question démo...cratique du langage écrit se pose. Évidemment, on ne confondra pas le temps des pharaons et le nôtre, quoique l’esprit pharaonique soit toujours d’actualité. Mais, jusqu’au bout, soyons de sang-froid et pragmatiques. Voyons, par exemple, comment les Japonais traitent le problème. C’est assez surprenant, et sans doute très sage dans l’état actuel des rapports sociaux à peu près universels.
Les solutions de l’écriture japonaise
Les Japonais ont trois sortes d’écriture :
- le kanji. C’est « l’écriture chinoise ». On ne va pas parler de l’histoire du Japon et de ses relations avec la Chine, pas toujours faciles, c’est le moins qu’on puisse dire. C’est peut-être pour ça que les Japonais ont une écriture spéciale pour les mots étrangers :
- le katakana. Comparons avec chez nous : le foot arrive, c’était il y a longtemps déjà. On a supporté (peut-être pour être poli et ne pas passer pour xénophobe) oo à la place de ou … Et puis, plus tard, pas d’Angleterre mais des Etats-unis, sont arrivés : cool, look, zoom, … pool (chouette, on ne va pas confondre avec poule ! Il y a toujours une belle explication chez nous pour expliquer les merveilles de l’orthographe.)
Les Japonais sont très polis aussi. Plus que polis : ils offrent respectueusement aux mots étrangers une écriture particulière.
Mais voici plus important pour réfléchir à nos problèmes. En kanji , les caractères représentent des idées (c’est pourquoi on les appellent idéogrammes) et, dans ces signes, il n’y a aucun indice de sons. Quand je vois écrit ornithorynque j’arrive quand même à dire le nom de cet animal ; rien de tel en kanji japonais. Il y a plusieurs milliers d’idéogrammes pour pouvoir tout exprimer. C’est pourquoi un jour les Japonais, (ou plutôt, semble-t-il, les femmes japonaises *) ont fait adopter - les hiragana, une écriture syllabique. Rien à voir avec la méthode syllabique de chez nous (b,a,ba) ; c’est direct aux syllabes : ba → un signe, bi → un autre signe, bou → un autre, tou → un autre, etc. Beaucoup de signes syllabiques, bien plus que les lettres de notre alphabet. Mais quand même pas innombrables, environ une soixantaine, parce que leur langue orale est formée sur l’assemblage simple consonne-voyelle.
Et alors, quand on les connait, on peut écrire tout ce que l’on a à dire. Ainsi les enfants, dès l’apprentissage, écrivent autant qu’ils lisent. Et les adultes aussi, sans crainte de se faire moquer à cause des fautes d’orthographe. Dans la réalité, il vaut mieux savoir écrire en kanji pour montrer qu’on est cultivé. Au Japon aussi, l’orthographe sert à la distinction. Mais pas à annihiler pour la vie la parole écrite de millions de gens.
* Alors que chez nous les Académiciens décidaient, au 17e siècle, que l’Académie « désire suivre l’ancienne orthographe qui distingue les gents de lettres d’avec les ignorants et les simples femmes ». L’histoire est lourde de sens.
LECTURES de désespoir et d’espérance
Pour mémoire, l’inénarrable
Thimmonier
« Depuis une trentaine d’année, la crise orthographique s’est aggravée de telle sorte qu’elle menace dangereusement l’intégrité de la langue. Or il n’y a théoriquement que deux remèdes : soit réformer notre système d’écriture, soit réformer la manière dont on l’enseigne. Mais, quelle que soit la solution qu’on envisage, il faut nécessairement s’appuyer sur une étude objective du système. »
— Thimmonier, Code orthographique et grammatical p. 12,13 - 1970
1970 ! … et « depuis une trentaine d’années » ; c’est dire où on en est ! …
Soufflons un peu. Respirons profondément. Ménageons notre psychosomatique. Retrouvons des êtres humains véritables, généreux et éclairés.
Claude Gruaz
Il tient le flambeau de l’espoir d’une réforme approfondie de l’orthographe dans l’association érofa qu’il a fondée après la fin de l’Airoé. Il a fait paraitre en 2014 un livre à la fois très accessible et très précis. Même pas cent pages qui expliquent tout ce qu’il faut savoir !
En prenant parti, mais sans polémiquer.
Car il faut poursuivre le débat scientifique (qui peut nous dépasser un peu) ; et aussi s’engager sur les enjeux sociaux. Pour nous, militants, les enjeux sociaux sont le plus important, mais la vérité scientifique est incontournable. Il faut la connaitre pour affronter les difficultés.
« L’orthographe française a régulièrement évolué jusqu’au XIXe siècle. La Restauration et le Second Empire en ont quasiment arrêté la progression. Le mythe de l’orthographe s’est alors installé et perdure encore aujourd’hui. Mais l’orthographe de Napoléon III (plus précisément celle de son époque, car l’empereur n’avait pas fait moins de soixante-quinze fautes à la dictée de Mérimée) peut-elle être celle du XXIe siècle ?
(…)
Soyons convaincus que personne ne pourra empêcher l’évolution de l’orthographe. Ou bien elle se dispersera en de multiples variantes incontrôlées, ou bien elle se renforcera en respectant les règles fondamentales de son système, aujourd’hui perturbé par les multiples exceptions qui n’ont pour effet que de nuire à sa connaissance, tant en France que dans les autres pays. »
— Claude Gruaz, L’orthographe vivante, p14,15
pour une évolution raisonnée
Que devez-vous savoir ?
Comment enseigner ?
Quelles mises en œuvre ?
— Nathan
André Chervel
« l’orthographe en crise à l’école ». 80 pages ! Après les avoir lues, pareil, vous saurez tout.
En plus, « le droits d’auteur de cet ouvrage sont intégralement versés à l’organisation humanitaire Inter Aide (www.interaide.org) qui soutient l’aide à la scolarisation des jeunes enfants dans les pays en voie de développement. »
«
L’ORTHOGRAPHE EN CRISE À L’ÉCOLE
Et si l’histoire montrait le chemin ?Avec la lecture, nous intégrons donc une compétence passive de l’orthographe, qui ne nous permettra peut-être pas de « mettre l’orthographe » et d’éviter les fautes quand nous écrirons, mais grâce à laquelle nous sommes en mesure d’identifier immédiatement les mots comme français ou non. Appelons-la l’ « orthographe passive », comme on parle du vocabulaire passif pour tous ces mots que nous comprenons parfaitement sans jamais les utiliser nous-mêmes à l’oral. Certains réussissent à « activer » sans grande difficulté leur orthographe passive et l’on dit alors qu’ils ont l’orthographe « naturelle » puisque l’apprentissage de la lecture a suffi pour leur faire mémoriser les formes et les règles. Mais au niveau des larges masses d’élèves, il est admis depuis le XVIIIe siècle que l’orthographe passive ne suffit pas pour écrire correctement et qu’il faut la compléter par un deuxième apprentissage de l’orthographe, qui sera donc l’orthographe « active ». »
— André Chervel, Et si l’histoire montrait le chemin ? p. 11
Était-ce vraiment la peine que je me défoule sur tant de pages ? Si ni Gruaz ni Chervel ne vous convainquent, alors il faut vraiment désespérer.
Conclusion
[modifier | modifier le wikicode]
« Ce fleuve intarissable aux mille méandres de la vie, où baignent tant d’hommes véritables, n’a pas encore débouché sur la scène des médias »
Cardinal Etchegaray, à l’assemblée plénière de l’épiscopat français de 1979
… C’est le moins que l’on puisse dire ! Heureusement qu’il y a l’éternité !
Par conséquent :
- Mis à part l’intérêt que j’espère avoir suscité en vous pour la linguistique,
- mise à part la culture, denrée gratuite, si on trouve encore la force et le temps d’aller la glaner, et mieux d’y participer,
- mis à part quelques rudiments de connaissance qu’il ne faudra pas surestimer, car la linguistique est une science de plus en plus compliquée,
c’est un curieux « discours » que je vous ai tenu, hargneux, désabusé, sans certitudes.
- Pour ou contre la norme ?
- Pour ou contre l’orthographe ?
- Et surtout, quelle école ?
« Active », moderne, ouverte, mais incertaine ? …
Ou se cantonnant, lamentablement, mais surement, dans ce qu’elle sait faire ?
Je ne répondrai pas, parce que je ne sais plus rien de ce qui est politiquement possible. Et je retourne au « nous de modestie ».
Un fait n’en demeure pas moins : après 100000 ans d’humanité où parler était chose « naturelle », voilà que, dans tous les pays « civilisés », les êtres humains se demandent « ce que parler veut dire » … et se mettent à balbutier à la seule pensée que, pour avoir l’air civilisé, « il faut se représenter mentalement le mot écrit ».
Le recours à la science s’impose.
Mais la science ne répond pas. Elle se déclare tragiquement en panne de réponses. Ce qu’elle sait, c’est qu’elle sait … beaucoup de choses, mais pas assez pour répondre à cette humble question.
Dans cette situation, si on laisse faire le cours … naturel des choses, il va falloir attendre les calendes avant d’avoir le droit d’ouvrir la bouche.
Bien entendu, les grandes âmes ne manquent pas pour parler à notre place, d’être « la voix de ceux qui sont sans voix ». Mille mercis, mais halte là ! C’est nous qui vivons notre vie. Et, du reste, leurs bonnes intentions sont désormais dérisoires, le mal galope bien au-delà de la revendication politique.
Il y a d’autres moyens de communication entre les hommes que le langage : les gestes, les regards, les modes, la musique, le sport … Cela même mériterait d’être mieux pris en compte. C’est la seule manière souvent de montrer qu’on existe. « Un pot de géranium sur le bord de la fenêtre » (Bonaffé, psychiatre, «En cette nuit peuplée ») ; ou une bonne grève qu’on n’attendait pas.
Mais, à un moment nécessaire, tout ce qui est essentiel passe par le langage. Le langage est reflet et moyen de la vie, et condition sine qua non de tout destin individuel.
Or, dans les modernes sociétés de classes, le verbe n’est plus chair ; il est insaisissable, et néanmoins omniprésent. « Ça » parle partout … « par la bouche des autres ».
On l’a vérifié tout au long du XXe siècle, le contrôle de tout ou partie de la vie sociale n’exige pas forcément une connaissance archiprécise des causes et des effets. Il y a la nécessité et le hasard, une vraie part d’incertitude dans le quotidien politique. Le pouvoir n’est pas forcément machiavélique. Il peut vouloir être débonnaire et pragmatique. Mais soudain, sans crier gare, quand les réalités pressent, il devient odieux, voire enragé. Du bois dont on fit les flutes, on voit surgir les gourdins. Cela, c’est l’histoire qui nous l’apprend et c’est à quoi pensent désormais les citoyens du « peuple de gauche » à chaque fois qu’il faut choisir et mettre un bulletin dans l’urne.
Les gros bataillons du peuple de gauche n’accèdent pas à la scène des médias, mais, en démocratie, ils peuvent voter. Il en résulte que ce monde en crise oscille sans fin de droite à gauche, mais ne bouge pas. Car si le malheur n’est pas le fait d’un oppresseur totalitaire, il ne peut être que l’œuvre du destin. On ne peut rien contre le destin. On n’a que ses yeux pour … rêver.
Or, à la télé, quoi qu’en disent les puristes, les maitres du langage ne font pas de fautes, ou comme ça, en passant, avec désinvolture, en comble d’élégance, comme les marquises qui se mettaient une « mouche » sur le minois pour souligner leur beauté. Ainsi, même les fautes, ici-bas, sont un luxe, un signe extérieur de richesse.
Ils ne font pas de faute, pardi ! Ils sont la norme. Nous avons expliqué ça.
Jadis, le belle langue c’était le parler du roi. Depuis deux siècles, c’est celui des bourgeois. Voici venu celui des nouveaux petits bourgeois (on doit dire « les couches moyennes - supérieures », les « bobos » quoi !). La langue coule toujours des sources les plus vives de la société. Il en résulte un air de liberté.
Mais en dessous (en dessous de tout), la « classe ouvrière », il parait quand même qu’elle existe ; il y a même des pays où on l’a vue refaire « irruption sur la scène politique » … Pourvu que ce ne soit pas trop à l’extrême droite, tellement elle se sent mal dans les « classes populaires » un peu trop basanées à son gré. La classe ouvrière-populaire est placée devant un affreux dilemme : ou bien elle se proclame en auto-gestion linguistique, comme elle l’était de fait jadis sans le savoir. Elle ne se fait pas de mouron et jacte à sa guise, en y prenant bien du plaisir ; mais ainsi faisant, ni elle ni ses enfants n’accèdent jamais aux fins boulots ; c’est smic et chomdu menaçant à perpète. Ou bien elle maitrise « l’hyper-correction » elle aussi ! Alors qu’à côté les rappeurs basanés, qui eux aussi ont de l’ambition, arrivent parfois, avec leur affreuse « langue des cités », à percer le couvercle.
Nous pouvons bien alors conserver l’hypothèse d’une langue supérieure indispensable aux idées subtiles et savantissimes, ce n’est pas cette langue qui est en question, c’est la pratique d’une langue possible ici et maintenant.
Il faut examiner concrètement la situation concrète : ce n’est pas la langue en soi, la pure idée, le mirobolant humanisme qu’on enseigne à la masse des enfants du peuple, mais la manière de faire briller ses boutons de guêtres pour la revue de détail du nouvel ordre commercial compétitif de la société de classes. Cela, le peuple justement l’a bien compris, après les illusions soixante-huitardes, et, depuis, il veille au respect des leçons essentielles, les plus tatillonnes et les plus formelles. Être petit chef et pas manœuvre, ça se mérite. On va à l’école pour ne pas être ouvrier.
« La langue est fasciste » a déclaré un jour un penseur de renom. Nous n’irons pas jusque là. Nous hésitons devant l’outrance, même par citation interposée. Disons simplement que la langue est nécessairement ce qu’elle doit être dans une société tout à la fois unifiée et éclatée, conservatrice et évolutive à toute vitesse.
Et au risque de décevoir encore plus, voire d’apparaitre contradictoire, nous dirons qu’on n’est pas près de pouvoir se passer de sa fonction « disciplinaire ». Car rien n’est pire que la chienlit ; après c’est toujours la dictature directe. Comprenons-nous bien, nous n’avons jamais porté une critique gauchiste.
Il n’y a plus de communisme nulle part à l’ordre du jour. Le communisme, c’est fini en tant que projet humainement accessible.
Le communisme est mort, vive le socialisme … à « visage humain ». On est pour ! Mais ce n’est pas pareil du tout. C’est un régime de dosages subtils et de compromis interminablement négociés.
… Négociés ? Vous avez dit négociés … avec la langue de Thimonnier et des anges gardiens de Julien Lepers ?
En république, avant tout choix politique, il faudrait pouvoir parler de tout, afin que chacun comprenne bien à quoi s’attendre. Et là est le hic : pour parler, il faut, dit-on, savoir parler ; le chien de la linguistique politique se mord la queue. Nous sommes bien aux racines (conscientes et inconscientes) des mystifications entretenues sur la langue et désormais bien repérées (la science sert quand même à quelque chose). Et la conclusion qui s’impose est une aporie parfaite.
Quand un enfant part à l’école, il a, dans son cartable, son bâton de maréchal. Il n’y a pas une maman qui se respecte qui ne le vérifie chaque matin. Les maitres et les maitresses, eux, en quelques semaines, savent très bien qui a le plus de chances d’entrer un jour à polytechnique (il n’y a pas besoin de tests compliqués) et qui lavera les vitres et torchera les vieux qui pourront se payer une maison de retraite. Pour ces enfants-là, il vaudrait bien mieux qu’on ne mette pas à profits et pertes les cinq heures de gymnastique. Malheureusement, il faut aussi faire beaucoup de dictées, et c’est la mère qui viendra rouspéter si on manque de régularité dans le culte orthographique.
C’est ainsi. Aussi longtemps qu’il faudra des balayeurs, mais que chaque soir le « cerveau disponible » sera absorbé par la télé, la langue aura des ratés … ses ratés. Ceux-ci bien sûr ne parlent plus. On finit par oublier qu’ils existent. Eux-mêmes en doutent.
La société duale prend et reprend ainsi sans fin tournure.
En démocratie, on ne peut être plus royaliste que le roi. La petite propriété du beau langage normé est, par consensus national, reconnu « droit inaliénable et sacré ». Dans « l’égalité des chances », pour y accéder, il y en a qui sont « plus égaux que d’autres ». Tout le monde le sait. Mais tout le monde a le droit de rêver.
Avons-nous toutefois le droit d’informer ?
En attendant les nouveaux lendemains qui parlent et chantent au « soleil de la diversité » et dans tous les registres sans énerver personne, il nous semble opportun de poser des questions nouvelles, peut-être pas décisives, mais certainement pas superflues. Nous les résumons maintenant en termes de manifeste, car nous n’écrivons pas « pour passer le temps ».
La parole est une nécessité vitale, un besoin à satisfaire, comme celui du pain et celui des roses. Le silence, le renfermement sur soi rendent fou. Ces maux absolus doivent être de toute urgence combattus par des « mesures appropriées ». « Il faut prendre des mesures ». Celles dont nous héritons, et qui ne sont pas sans intérêt (et, pour preuve, le pouvoir libéral n’a pas complétement réussi à les « détricoter »), relèvent du secteur de l’hygiène mentale. Cette politique qui consiste à faire taire les gens en masse, à les aliéner, à les stresser, à laisser galoper leur déprime, puis à les soigner par le trop couteux langage psychiatrique freudien qui ne peut plus être que le supplément d’âme de la ritaline, cette politique de gribouille demande … quelques soins urgents.
Mais « en même » temps », cacher la réalité des « signes sociaux » dans le langage, c’est leurrer.
Le système des registres de paroles servira encore longtemps, même quand on le brouille (« il faut tout changer pour que rien ne change »), à « distinguer » les hiérarchies. La société, inégalitaire depuis les temps pharaoniques, prévoira toujours des signes de reconnaissance qui ne sont plus chapeaux à plumes et pourpoints de soie, mais n’en seront pas moins efficaces pour marquer les différences entre les citoyens. C’est désolant, mais c’est inévitable, les choses étant ce qu’elles sont et aussi longtemps qu’on ne risquera pas de voir les rêves égalitaires sombrer dans de pires barbaries.
Donc.
Que l’on maintienne et entretienne en état de marche la belle langue académique est une nécessité civique que l’ouvrier comprendra : on ne casse pas les machines. Le jeune rappeur de banlieue le comprendra aussi si on lui dit qu’il ressuscite, lui, la poésie.
Mais que l’exigence débouche sur cette réalité terrifiante d’un peuple entier qui n’a plus l’usage de la parole, qui s’interdit à lui-même de l’avoir pour cause d’auto-dépréciation, c’est pire qu’un scandale, c’est un crime. Un crime contre l’humanité qui sera lourd de conséquences, car la nature de l’homme c’est d’être un être parlant, l’être de l’homme, c’est de parler. L’être humain est un « parlêtre » ou il n’est pas.
Pour avancer, pour dépasser l’absolue contradiction, il faut d’abord débarrasser la voie publique des discours-ventouses sur le bon français qui ont pour but essentiel de cacher la vérité sur la fonction disciplinaire nécessaire aussi longtemps que l’humanité doit se contraindre à rester inégalitaire pour subsister.
Le combat est nouveau, c’est à dire qu’il continue.
La langue y est un enjeu. Nous faisons donc, à propos du langage, une analyse de classe incongrue, insolente et dangereuse (puisqu’un mythe dénoncé n’est déjà plus un mythe). Mais nous sommes déjà rassurés quant aux conclusions pratiques. Compte tenu des contingences reconnues (et bien reconnues hélas, c’est pas pour rire!), elles sont d’un grand conformisme immédiat :
- Pas de subversion de la culture : c’est réservé aux artistes et autres virtuoses du chalumeau à rabouter les signifiants.
- Pas de contestation des cadres moyens : on garantit leur patrimoine pour qu’ils ne laissent pas couler la boutique quand les riches se débinent. On a besoin d’eux dans l’économie sociale.
Nous nous prononçons pour l’ordre et la loi, l’orthographe en acier nickelé, des commissions de censure langagière à la télé et Thimonnier au Panthéon. Nous nous prononçons pour le code officiel, la langue d’État impérative dans tous les examens.
Nous sommes pour tout l’ordre nécessaire. C’est à dire tous les ordres nécessaires ; mais l’ordre « véhiculaire » rigoureusement distinct de l’ordre « disciplinaire » et de l’ordre « savant ».
Tournons-nous alors de notre bord, à gauche pour bien le nommer. Si l’on prétend entretenir l’esprit de revendication (partant l’inflation), voici des propositions raisonnables et constructives : pour que les intellectuels cessent de produire sur ces questions autre chose que des souvenirs personnels, exigeons au CNRS une équipe de trente linguistes, psychologues, neurologues et mathématiciens chargés de commencer l’étude de faisabilité d’une véritable réforme de l’orthographe (grammaire comprise) et de son apprentissage efficace.
Et en attendant la percée scientifique, hors des lieux publics et des salles d’examen, qu’on dise aux scribes de mettre un peu d’eau dans leur vin. Toute parole suppose une langue et toute langue est infiniment plus riche que ce que peuvent en imaginer les cuistres. Les Français parlent français, il est urgent de le leur dire. À 17h, après le turbin, tout le monde cause. On s’écoute. Poliment.
Quant à la langue, notre opinion, fondée sur un peu de linguistique, est qu’il n’y aura jamais de souci à se faire pour elle. La langue vit quand les homme vivent. À vrai dire, c’est un vrai chiendent. C’est même ça qui exaspère les jardiniers. Il faut sans doute jardiner, mais de grâce, de façon moderne, écologique, pas à coups de désherbants !
Alors, dernière revendication, les jardiniers, à l’école ! Et pas une fois tous les dix ans.
Dans la société réelle, et pas dans l’utopie désaffectée, ces mesures sont le seul espoir valable ; parce que la parole est une condition nécessaire évidente de l’autogestion (alias coopération, alias économie sociale et solidaire). Il faut que les militants de la justice et de la dignité puissent s’appuyer sur les savants et sur des militants pédagogiques respectés pour imposer qu’on change dans l’aliénation ce qui peut l’être, non le véhiculaire, non le disciplinaire, non le savant, mais le faux sacré. C’est ce que les maitres et petits maitres des signifiants ne veulent surtout pas, car « la croyance est au fondement du ministère ».
Mais nous sommes au pays de la liberté.
Et on passe direct à l’action revendicative :
Chapitre final . Action
[modifier | modifier le wikicode]Non, c’est pas comme feu « la lutte ».
D’abord, on ne peut pas espérer qu’il y aura une fin à cette lutte-là, pas plus qu’aux autres. Ce sera d’autant plus difficile de convaincre « le peuple tout entier » qu’elle est nécessaire, aussi nécessaire que celles qui semblent visiblement plus urgentes pour sortir du merdier.
Pour exemple de ce qu’il est possible de faire (avec un peu, beaucoup, de courage) : « dicollecte », un site de travail collaboratif pour le dictionnaires orthographiques du correcteur Hunspell, sous licence GPL, utilisé par LibreOffice, Thunderbird, etc.(On remarquera le dessin de Vidberg).
Pour conclure ce livre militant, voici deux tracts. Car tu dois mener toi-même la lutte pour le droit à la parole, y compris écrite ; ce ne sont pas les « scribes et pharisiens hypocrites » qui le feront pour toi.
Apprentissage de la lecture, réforme de l’orthographe : la première question est toujours d’actualité, l’autre devrait l’être.
- Le premier tract concerne la fameuse querelle des méthodes d’apprentissage :
globale ↔ syllabique … les deux mon capitaine !
- Le deuxième interroge la perfection supposée incomparable de l’orthographe française (et ses merveilleux effets sur l’intelligence … Nous construisons l’Europe, n’est-ce pas : parles-en à des Italiens, en les plaignant qu’à cause de leur écriture rudimentaire ils sont un peu tous bas de plafond … Et puis cours vite.)
Que ces deux résumés ne te dispensent donc pas de lire et relire le reste du livre. Surtout s’il te vient l’idée saugrenue de t’« engager » aussi sur ces dossiers. Et sache alors que tu auras bien d’autres choses à lire. Mais tu n’auras pas forcément besoin d’acheter : on trouve tout sur internet.
Voici les deux tracts annoncés. Bonne route.
| Tract 1 |
« L’orthographe est un polysystème »
Dans l’écriture du français, beaucoup de lettres servent à représenter les sons de la parole, mais pas toutes.
ex … « dans » [d] [an] (s)
D’une façon générale, il y a toujours assez de lettres (ou combinaisons de lettres, comme an, on, in, ou …) pour faire « entendre » les mots les plus compliqués.
ex : chrysanthème > [c] (h) [r] [y] / [s] [an] / [t] (h) [è] [m] (e)
Parfois on hésite parce qu’une lettre peut représenter plusieurs sons (ex : rhume, rhum), ou on hésite sur le rôle qu’elle joue avec ses voisines (ex : chorale, charité) .
Il n’y a pas souvent de règle claire et précise pour choisir ; comme c’est le cas pour « s entre deux voyelles » qui marche à 95% : poisson, poison, chanson …
Mais, malgré toutes les complications et exceptions, ces « indices de sons » permettent de comprendre un texte en passant par l’oral, en s’aidant du sens général de l’histoire (exemple célèbre chez les linguistes : Les poules du couvent couvent). C’est une bonne chose quand on débute, à condition de ne pas être asphyxié par un vocabulaire et des tournures de phrase trop inhabituels. Ensuite, plus on lit, plus on se familiarise avec les « lettres qui ne font pas de bruit »; au point qu’elles deviennent alors utiles pour reconnaitre la « figure des mots » d’un coup d’œil ; c’est comme la longueur du nez ou la couleur des yeux pour les visages humains. Chez les lecteurs très entrainés, cette reconnaissance « globale » visuelle semble dominer ; en réalité, les recherches actuelles l’ont prouvé, le cerveau, à une vitesse inimaginable, utilise tout ce qu’il a emmagasiné, les sons et les images, le « global » et le « syllabique » ainsi que le sens général de la phrase s’il lui est intelligible, pour « lire » chaque mot. Donc, l’orthographe est très utile pour lire.
Pour écrire, c’est une autre histoire. À chaque son, à chaque syllabe, on se demande quelle écriture choisir. En plus, il faut mettre la marque de tous les raisonnements grammaticaux (s, nt …).
ex : Il coupe le pin.
Ils coupent le pin.
Ils coupent le pain.
Les admirateurs de l’orthographe expliquent qu’il faut « en rajouter » à l’écrit parce qu’on ne dispose pas des recours de la conversation directe. On ne peut pas téléphoner à l’auteur du texte s’il y a un doute sur le nombre de coupeurs et sur ce qu’ils coupent. On pourrait tout aussi bien dire que c’est à l’auteur de prévoir les risques de confusion et de rajouter à priori des détails explicatifs. On peut dire tout ce qu’on veut : pour l’instant, il utilise l’orthographe telle qu’elle est pour délivrer économiquement son message. L’écriture est économique parce qu’elle est riche. Enrichissez-vous !
Le débat pédagogique principal n’est donc pas global ou syllabique. Avec ce faux débat, on nous mène en bateau, ou plutôt en balançoire. Il est évident que la lecture rapide « globale » ne peut exister que chez des lecteurs experts. L’apprentissage de l’écrit par l’écrit prive l’apprenti de ces « indices de sons » dont, plus tard, sans doute, il se servira moins ; mais, pour l’instant, il n’en est pas là. Cependant, les mauvais lecteurs, qui ne sont pas allés au bout de l’apprentissage soi-disant syllabique, ânonnent (on voit leur lèvres qui bougent), ce n’est pas juste non plus qu’ils restent coincés là. L’apprentissage souhaitable est donc complexe, et il dépend aussi des différences individuelles et sociales (c’est prouvé). En fin de compte, les instituteurs n’étant pas stupides, la méthode globale a été rarissime. En réalité, les méthodes majoritaires étaient « à point de départ global », c’est à dire qu’on utilisait un certain nombre de mots appris pour étudier comment s’écrivent les sons dedans ; puis ça devenait … syllabique. On pourrait affirmer tout aussi bien que les méthodes syllabiques sont responsables du désastre constaté. C’est pour y remédier qu’on cherchait tous azimuts … On tourne en rond.
Le vrai débat est ailleurs.
On vient de voir qu’il est plus facile de lire que d’écrire sans faute (c’est à dire, justement, pas en phonétique). Un vague souvenir de la « figure des mots » aide à les reconnaitre ; par contre, pour écrire, le vague souvenir ne suffit pas, et le b,a,ba fera faire des fautes.
ex : rubarbe, eh non, rhubarbe !
Le débat caché est le suivant : lecture et écriture ou lecture puis écriture ?
Faut-il que les enfants apprennent d’abord à lire (avec le b,a,ba , c’est en effet suffisamment efficace très souvent ), puis à écrire (en apprenant l’orthographe respectueusement) ?
Si on a affaire à des élèves confiants et pas contestataires, à chaque jour suffira sa peine. Ils apprendront à lire « comme les bébés apprennent le jambon », par petits bouts (est cité ici un laudateur de la méthode syllabique). Au fil des jours, des mois et des années, bienheureux et disciplinés, ils arriveront à déchiffrer (chacun à son rythme), puis à assimiler les lettres muettes et les choix multiples, puis les règles d’accord. Ils sauront lire, et, un jour peut-être, ils écriront sans fautes tous les mots magnifiquement compliqués qu’on leur aura fait adorer. Mais, quand après b,a,ba ils découvrent bain et baignoire, il y en a qui se révoltent (parfois silencieusement si la discipline est vraiment très forte ; mais c’est pas meilleur pour la santé mentale).
On a donc aussi le droit de penser et de dire, en république, qu’il faudrait plutôt choisir, comme principes pédagogiques, l’intelligence et le respect avec la discipline. Pour l’intelligence, il ne s’agit certes pas de tout apprendre pêle-mêle, mais simplement de ne rien cacher, dès le début, de ce qu’est l’écriture « pour de vrai ». Ceci, évidemment, par les méthodes actives, pas par des discours. On y parvient en faisant écrire autant que lire. Le but étant que tous osent écrire plus tard en sachant se débrouiller seuls avec les difficultés orthographiques (notamment en utilisant le dictionnaire).
Comment conduire cette pédagogie sans crouler sous les corrections ? C’est la question syndicale dont la réponse ne coute pas trois sous. Car, bien entendu, il n’est pas question de laisser paraitre en public des textes avec des fautes. Il faut respecter l’orthographe puisque les Français refusent de la simplifier. Pour l’instant, on n’a pas trouvé la solution économique. Mais à priori, il ne faut pas moins de science pour instruire les enfants que pour fabriquer des voitures.
Aux citoyens de choisir.
| Tract 2 |
| La réforme nécessaire de l’orthographe … … ne tombera pas du ciel Vous voulez qu’on vous explique ? |
— sciences et avenir, avril 2001 |
Résumé historique.
En 1990, une réforme modérée, très modérée, avait été acceptée. Vous en avez peut-être entendu parler. Mais surtout de la levée de boucliers qu’elle avait suscitée.
La réforme de 90 a poursuivi cependant son chemin, cahincaha. Encore heureux que l’Académie n’en ait pas tiré la conclusion que, puisque « l’usage » n’approuvait pas assez vite, il fallait tout supprimer ! Elle nous avait déjà fait ce coup-là.
Il ne faut rien lâcher. Et on a besoin de vous pour ça. C’est « l’Usage » qui commande, qu’ils disent. L’usage de qui ? Si vous êtes au courant, vous savez à qui vous adresser.
Procédons par ordre : d’abord, défendez la réforme de 90, appliquez-la, même si un cuistre ignare, au détour d’un bois, vous montre du doigt, courage ! C’est un bon petit tien avant les autres que tu auras si tu y mets … du tien ; et parle-s-en à ton voisin.
On peut consulter les règles et la philosophie de la réforme de 90 sur les sites de l’[orthographe-recommandee.info] et de [renouvo.org] et, pour ce qui concerne les mots modifiés, ils sont à peu près tous aujourd’hui dans les dictionnaires.
Cependant, le résultat le plus grave des tergiversations, notamment dans l’Éducation nationale, c’est qu’on a complètement oublié comment la réforme de 90 avait pu naitre. Ce qui fait qu’on pourra dire que « l’usage » a fait ses choix. En réalité, l’usage, pour l’écriture, justement, c’est les dictionnaires. Beaucoup de linguistes qui y travaillent étaient convaincus, mais ils ne voulaient pas ruiner leurs boutiques. Alors, ils ont procédé à l’adoption « avec des ruses de Sioux ». Merci beaucoup, mais ça prépare mal la suite.
« Modérée », elle l’était, la réforme de 90, c’est le moins que l’on puisse dire. Suscitant de ce fait un reproche paradoxal : elle ne valait pas le coup. Il en a toujours été ainsi du réformisme : c’est toujours trop ou pas assez. Justement, les linguistes du CNRS, dirigés par Nina Catach, qui l’avaient élaborée et qui avaient milité pour la faire accepter par les autorités, avaient l’esprit politique ; c’est exactement pour ça qu’ils avaient été prudents. Mais c’étaient aussi, à l’époque, des citoyens optimistes, ils espéraient qu’on continuerait à réfléchir, et à agir. Ils ont mené cette action bénévolement, pendant des années, dans une association, l’AIROÉ, qui a fini par disparaitre. Le pire, le plus injuste, c’est parce qu’ils s’y sont disputés.
Une nouvelle association laboure actuellement opiniâtrement la complexité, sans objectif de réforme immédiate :
ÉROFA , Études pour une Rationalisation de l’Orthographe Française d’Aujourd’hui , [erofa.free.fr]
Cette association a publié plusieurs études proposant des règles sans exceptions (les exceptions sont la torture raffinée de l’orthographe actuelle). Ces études ont porté sur « le X final », « les consonnes doubles après E », « les consonnes doubles féminins et dérivés », « les lettres grecques », « l’accord du participe passé » ; et là, ç’a été difficile mais l’expérience passée a rendu sages les protagonistes. De toute façon, ce sont des propositions soumises aux … usagers.
Par conséquent, un « Dictionnaire de l’orthographe rationalisée du français » vient de paraitre en 2018 : « les consonnes doubles, le X final, les lettres grecques ou similaires ». Un dictionnaire politique, avec évidemment toutes les explications nécessaires. Pour agir. Ce dictionnaire est en vente dans les librairies, sur internet, sur commande aux éditions Lambert Lucas (lambertlucas@free.fr). Prix : 45 €.
La simplification de l’orthographe doit devenir une revendication populaire. Il n’y a plus aucun espoir de progrès humain qui puisse venir autrement que d’en bas.
À vous de jouer, chers indignés !
Sommaire, lexique, lectures
[modifier | modifier le wikicode]Lexique Lectures Introduction
Bachelardch1 - structure
- diachronie, synchronie
- créativité
- oppositions (+ code, canal, bruit)
Benveniste
Poirot-Delpechch2 - pertinence
- métalinguistique
- classement des mots
- langue : vernaculaire, véhiculaire
- que disent les dictionnaires ?
Jakobson
Buffon
Philippe Jacquin : les Indiens blancsch3 - signe, indice, icône, symbole, signal
- pictogramme, idéogramme
- arbitraire
- lexique, syntaxe
- sémiologie
Chomskych4 - signe ; signifiant, signifié
- référent
- arbitraire (2)
- connotation, dénotation
- valeurs
Jakobson
Henri Michaux et Arthur Hch5 - distinctif
- pertinent
- discret
Bourdieu
Michel Serresch6 - parole, langue – performance, compétence
- énonciation
Hagège
Jakobson
Bourdieu
Meschonnic
Vaugelas
Sauvageotch7 - variantes
- délimitation des phonèmes
- nombre de phonèmes d’une langue
- variantes et accents
Martinet
Jakobsonch7 bis - l’arbitraire arbitraire
- réforme et/ou rationalisation
Henriette Walter
Clément Marot
Vellouch8 - sémantique
- syntaxique
- paradigmatique
- syntagmatique
Sauvageot
Peytard et Genouvrier
Oswald Ducrot
grammairien d’autoroutech9 - génératif, grammaire générative
- universaux linguistiques
La traduction automatique (La Recherche, octobre 85)ch9 bis
Alain Reych9 ter - norme
- registres, niveaux de langue
Bourdieu
l’économie en 2007ch10 - illocutoire
- performatif
- les fonctions de la langue (référentielle, expressive, poétique, conative, phatique, métalinguistique)
- mesure de la quantité de vocabulaire
Pierre Encrevéch11 - pragmatique
Atlan
Colettech12 - types d’écriture
- démotique
Thimonnier
André Chervel
Claude Gruaz